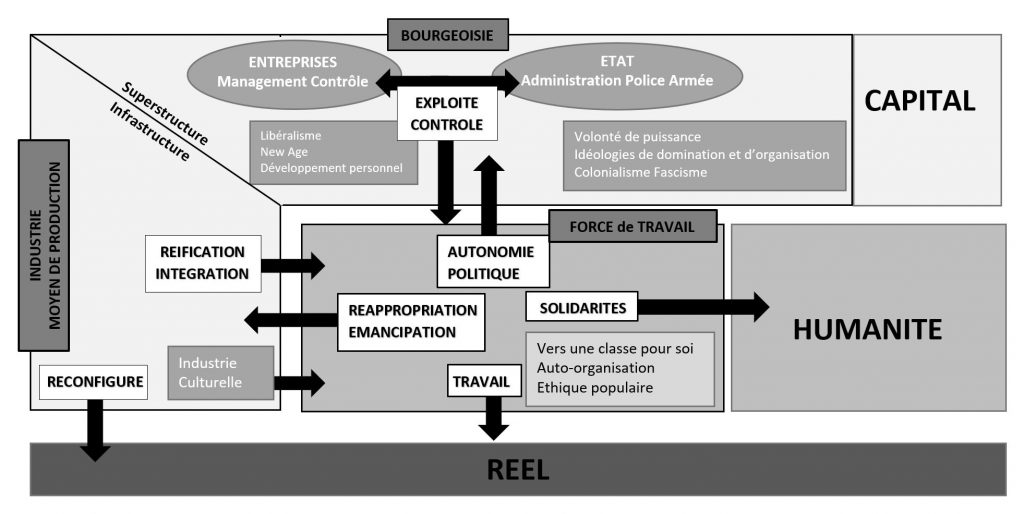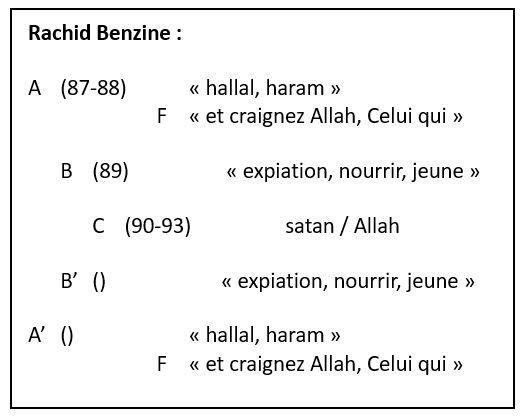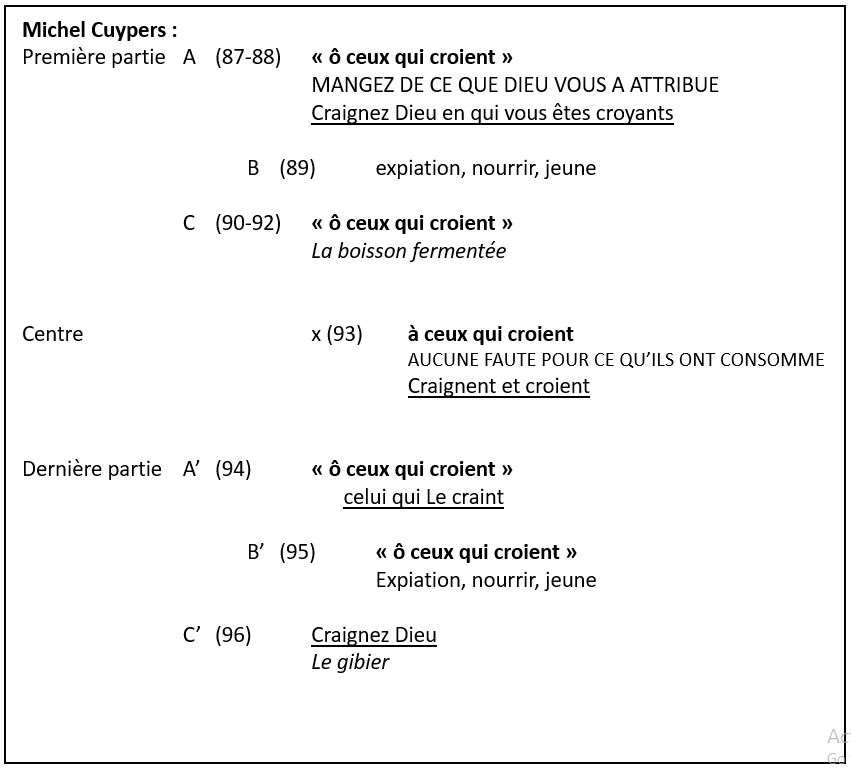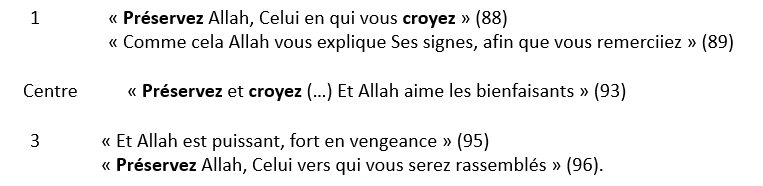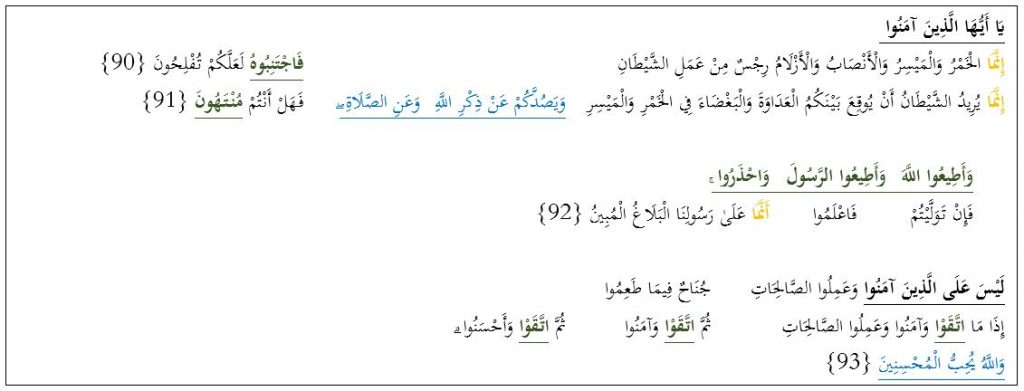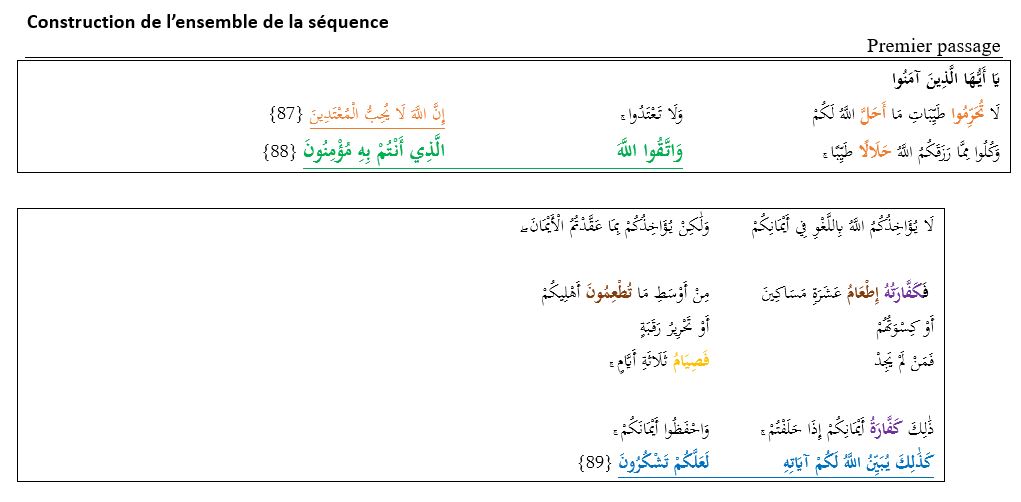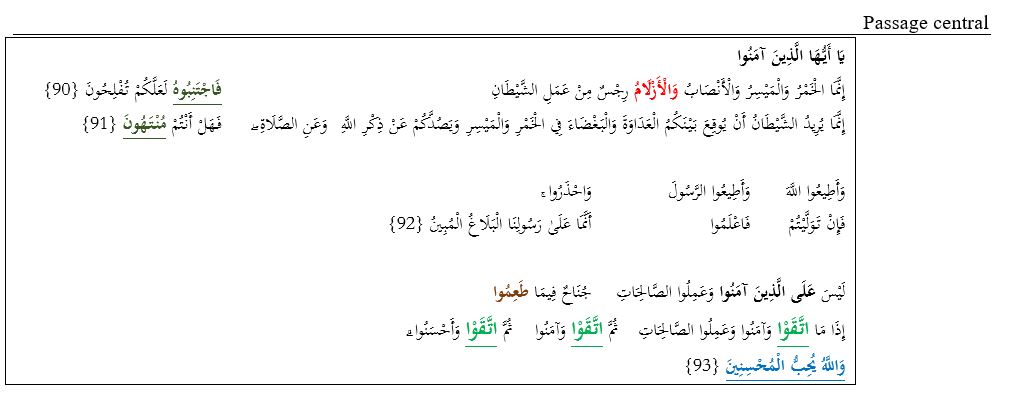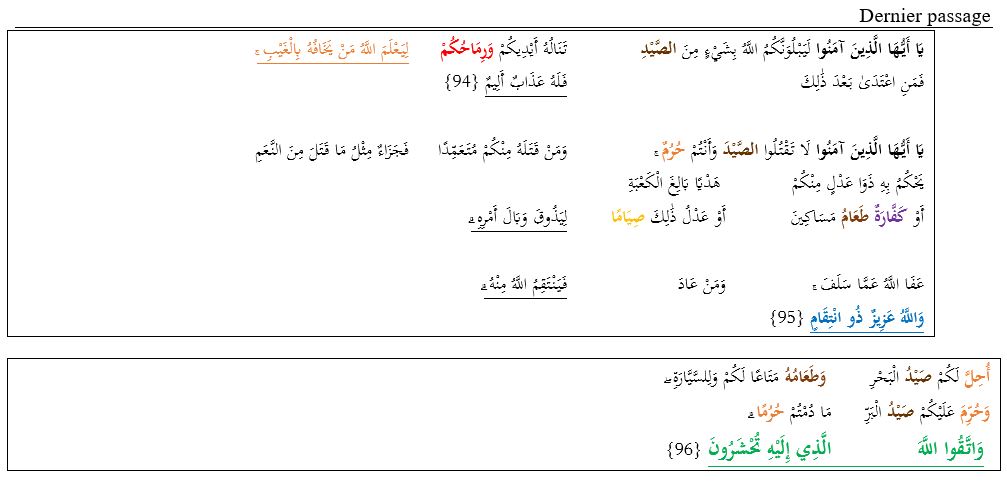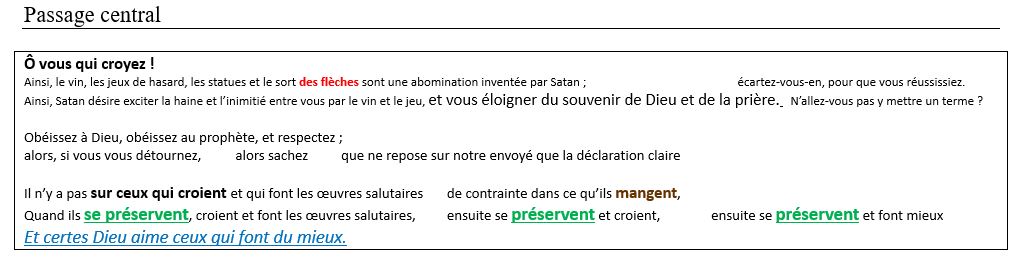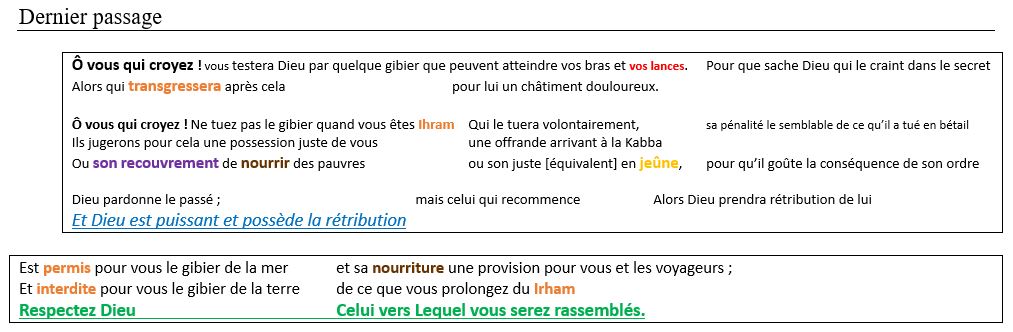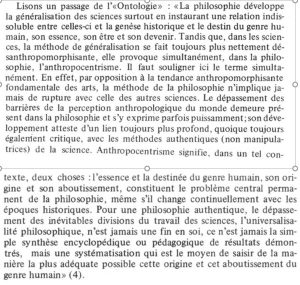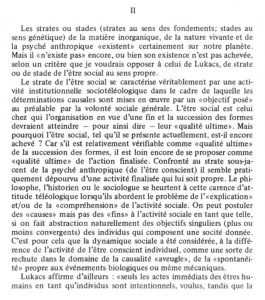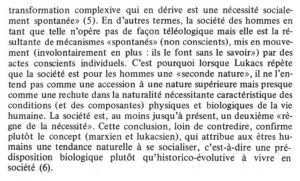Ce texte est une revue du livre Juifs et anarchistes – Histoire d’une
rencontre, consultable sur
https://www.cairn.info/juifs-et-anarchistes–9782841621613.htm#
Texte lu sur le site http://www.socialisme-libertaire.fr/2017/12/questionnements-sur-juifs-et-anarchistes.html
Nous
apprecions la sensibilité de l’auteur, et son soucis de justice. Sans
toutefois toujours le suivre, quand il s’inquiète, légitimement, mais
peut-être un peu trop, sur le risque d’antisémitisme dans les mouvements
de lutte pour la Palestine.
C’est
pour nous dans ces mouvements et dans la pratique que se dégrossissent
les perceptions faussées de l’antisémitisme par la compréhension des
enjeux réels de l’occupation. En particulier les dangers idéologiques
nationalisme, et la violence du colonialisme. Qui permettent de saisir
que rien ne lie le judaïsme ni les juifs à l’occupation, mais que l’état
sionisme tend plutot vers un fascisme de type européen.
Les assemblées juives sont toujours pleines à craquer – d’hommes, de femmes, d’enfants et de landaus. L’instinct grégaire de ma race lui a permis de survivre à toutes les horreurs qu’elle a pu endurer. Par ailleurs, qu’adviendrait-il du progrès si les juifs n’étaient pas là ?
Emma Goldman, « The Joy of Touring », Mother Earth, vol. 3, 1906
Dans les années qui
précédèrent la Grande Guerre, les anarchistes juifs formèrent, à
Montréal comme à Londres, le gros des groupes libertaires. En témoignent
les écrits d’Emma Goldman et de Rudolf Rocker.
Chevauchant les
sphères du politique, du culturel, du religieux et de l’ethnique, la
conjonction de ces deux termes – anarchiste et juif – ne va pas, on
l’imagine, sans poser question. De qui parle-t-on, en fait : des juifs
anarchistes ou des anarchistes d’origine juive ? On peut constater qu’il
n’existe plus, aujourd’hui, de groupes se réclamant à la fois de ces
deux dimensions. En Israël, par exemple, lesdits « Anarchistes contre le
mur » ne le sont que par défaut. Désignés ainsi par les médias dans un
but évident de les discréditer, ces militants radicalement engagés
contre ce mur ont accepté le qualificatif sans vraiment savoir,
semble-t-il, ce qu’il recouvrait. En ce sens, on ne peut que saluer la
publication en français des actes du colloque « Anarchistes et juifs »
tenu à Venise en mai 2000 -– même amputés des témoignages relatifs à la «
double identité » .
J’avoue d’emblée que la lecture de ce livre a
provoqué en moi un certain nombre de questionnements à propos des liens
existant entre anarchisme et judaïsme, et donc entre politique,
culture, religion et ethnie [1]. Pourquoi ? Certainement parce que je
suis personnellement – et profondément – impliqué par cette thématique
[2]. Anarchiste depuis quelques décennies, je cherche, en effet, à
détecter, à mettre à jour et à comprendre ce qui fait lien – ou, selon
les moments historiques, absence de lien – entre ces deux domaines
apparemment si différents que sont l’anarchisme et le judaïsme.
Si
ces questionnements tiennent bien évidemment à l’existence même de ce
livre, ils naissent également des nombreuses béances qui m’apparaissent à
sa lecture. Entendons-nous bien : il ne s’agit pas ici d’instruire un
quelconque procès, mais plutôt de tenter de combler des trous ou de
pallier des manques. Ces manques, je sais qu’ils se manifestent dans le
milieu anarchiste, dont ce colloque – et donc ce livre – est une
projection.
Il est, par exemple, significatif que les dimensions
tant sociale que politique de la religion juive – par ailleurs quasiment
caricaturale du point de vue du respect des rites – soient ici
complètement passées sous silence. Au même titre que l’étroite parenté
qu’on peut constater entre la conception révolutionnaire anarchiste
traditionnelle et le messianisme juif, cet aspect du lien religieux
possible entre anarchisme et judéité méritait d’être examiné à partir de
certains textes bibliques. Par ailleurs, des questions aussi
importantes que celle des femmes, des juifs séfarades, des Arabes, du
nazisme et de la Shoah sont, pour certaines, à peine ébauchées et, pour
d’autres, carrément absentes. Sans parler de la question de
l’antisémitisme en milieu anarchiste, tout juste effleurée, et de celle
du monothéisme, jamais traitée.
Je ne sais s’il me sera possible
de combler ces béances, mais j’ai besoin de le tenter. Pour mettre à nu
certaines questions que je juge essentielles. Si l’époque de symbiose
entre anarchistes et juifs est passée, les liens qui structurèrent cette
« double identité » continuent de susciter, au présent, de nombreuses
interrogations. Sur les juifs se définissant comme libertaires, mais
aussi sur les libertaires dans leurs rapports aux juifs.
Ce questionnement, qu’il faut affronter dans toutes ses dimensions, n’est évidemment pas simple. Il peut même être douloureux.
De la Torah à l’anarchie : vers la société idéale
Nous
partirons d’une double constatation : non seulement cette symbiose
entre judaïsme et anarchisme a existé, mais il existe encore une
certaine fascination du courant anarchiste pour l’univers juif. Comment
expliquer, alors, que des tenants d’un anticléricalisme parfois forcené,
d’un athéisme affirmé, d’une philosophie si ouvertement opposée à tout
substrat ethnique aient pu maintenir des relations si privilégiées avec
une catégorie d’individus qui, nolens volens, se réclamaient, à la fois,
d’une origine ethnique et d’une religion ?
Pour tenter de
répondre à cette question, il faut sans doute en revenir aux origines.
Dans une des contributions de cet ouvrage, consacrée à la communauté
juive anarchiste en Argentine [3], les auteurs rapportent l’opinion de
Higinio Chalcoff : « Nombre d’entre nous ont eu une formation anarchiste
par l’intermédiaire de l’éducation religieuse, en tant que nous
trouvions dans l’anarchisme une vision plus large de l’humanisme de la
tradition juive » (p. 177). Il y aurait donc un arrière-fond anarchiste
dans la Torah [4]. Pour incongrue qu’elle soit, cette hypothèse mérite
d’être vérifiée à partir des textes bibliques, en particulier pour ce
qu’ils disent de l’organisation sociale et de l’État.
Dans une des
rares mentions que cet ouvrage fait de cette importante question, Furio
Biagini [5] évoque – sans trop s’y arrêter, cependant – cette année «
sabbatique » qui contribuera à conférer au judaïsme un évident caractère
émancipateur. Pour Furio Biagini, cette année « sabbatique » annonce la
libération du travail, de la même façon, ajoute-t-il, que le « jubilé »
[6] de la tradition chrétienne – « tout autant révolutionnaire »,
d’après Biagini – « rétablit l’égalité sociale » (p. 21). C’est
évidemment trop court pour être compris.
Récit des origines et loi
de base d’une religion ritualisée à l’excès, la Torah consacre une
grande partie de ses textes à l’organisation sociale du peuple juif. La
Bible juive – ce que les chrétiens appellent l’Ancien Testament – a été
rassemblée et publiée probablement vers 480 avant notre ère. Il s’agit
d’une collation de différents écrits provenant de diverses traditions
et, évidemment, d’une multiplicité d’auteurs. Parmi ces textes, le
chapitre 25 du Lévitique pose, en termes précis, les bases de
l’organisation sociale du groupe qui se reconnaît comme étant le peuple
juif.
On y trouve ceci : « Tu ensemenceras ton champ, pendant six
ans tu tailleras ta vigne et tu en récolteras les produits [Lv 25:3-].
» Et les versets suivants précisent : « Mais en la septième année la
terre aura son repos sabbatique, un sabbat pour Yahvé : tu
n’ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne [Lv 25:4-],
tu ne moissonneras pas tes épis, qui ne seront pas mis en gerbe, et tu
ne vendangeras pas tes raisins, qui ne seront pas émondés. Ce sera pour
la terre une année de repos. [Lv 25:5-] » En cette septième année, dite «
sabbatique », il faudra donc se nourrir sur les récoltes des années
précédentes. Au bout de sept fois sept ans, quarante-neuf ans donc,
viendra l’année des Expiations, proclamée sainte et saluée par le son du
chofar, cet instrument à vent fabriqué dans la corne d’un bélier. Le
Lévitique précise alors : « Vous déclarerez sainte cette cinquantième
année et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays.
[Lv 25:10-] »
En cette année-là, les esclaves redeviennent libres,
les terres acquises reviennent à leur propriétaire originel – Dieu – et
on n’achète que les récoltes [7]. Comme toute parole divine, celle-ci
exige d’être observée sous peine de sanction. Pour le cas, énoncée au
chapitre 26 du Lévitique, elle n’est pas mince : « Si vous rejetez mes
lois [Lv 26:15-] […] je me tournerai contre vous et vous serez battus
par vos ennemis. Vos adversaires domineront sur vous et vous fuirez
alors même que personne ne vous poursuivra. [Lv 26:17-]. […] Vous
mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles.
[Lv 26:29-] » Et ainsi de suite. Cette menace est récurrente tout au
long de ce que les chrétiens appellent l’Ancien Testament.
Dans la
pensée rabbinique postérieure à la grande dispersion du premier siècle
de notre ère, la portée concrète de ce texte se vit minimisée par les
exégètes du fait que les juifs étaient alors un peuple sans territoire.
Lorsqu’il accéda à la territorialité, avec la fondation de l’État
d’Israël, on souligna son anachronisme au prétexte que les juifs
n’étaient plus une communauté d’agriculteurs et de bergers. Il n’empêche
que ce texte est porteur d’une authentique promesse de libération
sociale dont la force d’évocation perdure et qu’on ne peut évacuer aussi
facilement.
De l’État, du messianisme, de la révolution
L’abandon
progressif de ces préceptes va s’accompagner d’un changement de statut
du peuple juif, originellement organisé en tribus placées sous
l’autorité de juges : les anciens. Les textes racontent que, ne
supportant plus cet état de fait, les juifs cherchèrent à devenir – déjà
! – un peuple comme les autres, régi par un roi. Si l’on ne peut parler
de désir d’État au vrai sens du terme, la différence est mince. Saül,
premier roi d’Israël, fut désigné par Samuel, prophète et dernier juge,
qui s’adressa au peuple en ces termes [8] : (IS fait référence à Isaïe,
donc cela s’écrit 1S) « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur
vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses
cavaliers, afin qu’ils courent devant son char [1S 8 :11-] ; il s’en
fera des chefs de mille et des chefs de cinquante, et il les emploiera à
labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de
guerre et l’attirail de ses chars [1S 8 :12-]. Il prendra vos filles,
pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères [1S 8
:13-]. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de
vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs [1S 8 :14-]. Il prendra la
dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses
serviteurs [1S 8 :15-]. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos
meilleurs bœufs et vos ânes, et s’en servira pour ses travaux [1S 8
:16]. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-mêmes serez ses
esclaves [1S 8 :17-]. »
Cette prophétie, qui aurait pu être
énoncée par n’importe quel anarchiste, préfigure exactement ce qu’il en
adviendra du devenir du peuple juif. Mais, parallèlement à ce rejet de
l’organisation traditionnelle et à l’instauration de la royauté –dont la
Bible, que d’aucuns finiront par prendre pour un livre d’histoire, sera
la mémoire événementielle –, se fera jour une autre tradition, de
contestation de l’ordre établi. Montant de ces périodes troublées, la
longue plainte des prophètes – prédisant, de façon répétée, les malheurs
qui s’abattront sur le peuple élu s’il ne change pas – ouvrira,
paradoxalement, la perspective de possibles temps meilleurs et donnera
naissance à ce messianisme juif si caractéristique [9].
«
L’esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé m’a donné l’onction ;
il m’a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs
meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la
délivrance [Is 61 :1-], proclamer une année de grâce de la part de Yahvé
et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les
affligés [Is 61 :2-]. » Le messianisme juif trouve son origine textuelle
dans ces versets d’Isaïe [10], qui font référence à cette « année de
grâce » déjà évoquée. Il s’agit là d’un message prophétique en direction
des pauvres. Si le mot Messie n’apparaît pas littéralement dans cette
traduction française de la Bible de Jérusalem, il est contenu dans
l’idée d’« onction » [11]. Parallèlement à l’affirmation du retour du
messie apparaît l’autre face du discours prophétique, sa dimension
révolutionnaire : l’appel à la repentance d’Israël.
L’imprécation
d’Osée – « Le pays se prostitue, il abandonne l’Éternel [Os 1:3 -] »
[12] – ou celle de Jérémie – « Mon héritage, vous l’avez changé en
abomination. [Jr 2:7 ] » [13] – reviennent, en effet, comme antiennes,
dans tous les discours prophétiques, qui dénoncent l’injustice – et
l’incroyance – des royaumes de Juda et d’Israël, en même temps qu’ils en
appellent à la justice sociale et à cette « année de grâce », annoncée
par Isaïe. Bien plus tard, Jésus de Nazareth fera de cette année
jubilaire un des axes de sa prédication itinérante. C’est d’ailleurs
dans une synagogue qu’il reprendra à son compte la prophétie d’Isaïe et,
ce faisant, qu’il signera son arrêt de mort pour avoir, en citant ces
paroles, demandé des comptes aux riches. Devenu Jésus-Christ par la
grâce de ses disciples et successeurs, cette figure prophétique
irriguera, de la fin de la domination romaine jusqu’au Moyen Âge tardif,
bien des révoltes contre l’injustice sociale.
Le messianisme [14]
n’est donc pas seulement l’annonce d’un retour, la croyance en un
changement à venir, il est aussi l’affirmation que, ce jour-là, tout
sera radicalement changé. En ce sens, il est indissociable de la
dimension apocalyptique de l’eschatologie juive. Si pour une partie de
la tradition juive, le Messie est le roi à venir, le fils de David, pour
une autre, il semble bien que ce soit le Pauvre. De la même façon, les
interprétations sur le moment de sa venue sont diverses et
contradictoires. Pour les uns, elle n’interviendra que lorsque le monde
sera bon et pacifié ; pour les autres, elle ponctuera une longue période
où Gog et Magog se livreront, dans un monde en proie aux pires
déferlements, une bataille sans merci. C’est à travers ce grand
bouleversement que s’accomplira la transformation de l’homme. Dans cette
perspective, le parallélisme est évident entre le messianisme juif et
un certain catastrophisme révolutionnaire qui fait de la « lutte finale »
la condition indispensable à l’éclosion d’une société nouvelle.
Convergence d’imaginaires et points de passage
Il
faut donc en convenir : sur divers points – l’aspiration à une société
égalitaire, le refus de l’État [15], le renversement radical de l’ordre
du monde –, il existe bel et bien une convergence d’imaginaires entre
les textes fondamentaux du judaïsme et la tradition anarchiste. S’ils
permettent de comprendre pourquoi tant de juifs ayant baigné dans cette
parole biblique ont opéré ce passage, ils n’expliquent pas, en revanche,
l’intérêt – indiscutable – que nombre d’anarchistes ont manifesté pour
cette étrange communauté d’hommes. On pourrait, bien sûr, trouver
quelque explication dans le statut de minorité opprimée qui était la
sienne et dans cette particulière prédisposition qu’ont les anarchistes à
accorder leur soutien aux damnés de la terre.
Il existe, par
ailleurs, dans Juifs et anarchistes, quelques références à la séduction
que le hassidisme [16] aurait exercée sur certains anarchistes. Ainsi,
dans une contribution déjà citée, Furio Biagini, pour qui le hassidisme
fut « une explosion d’énergie religieuse créatrice contre les anciennes
valeurs devenues inopérantes » (p. 26), n’hésite pas à qualifier ce
mouvement de « libertaire » (p. 30) – même s’il précise qu’il est, par
la suite, devenu « despotique » (p. 30). Daniel Grinberg [17], quant à
lui, précise que « le potentiel révolutionnaire des juifs de Pologne
s’affirme pour la première fois au XVIIIe siècle, lorsque le mouvement
messianique des hassidim trouva auprès d’eux ses partisans les plus
nombreux et les plus zélés » (p. 164). Au nombre des raisons
susceptibles d’expliquer cette particulière – et mystérieuse – séduction
que des libertaires éprouvèrent pour le hassidisme, il est probable que
joua sa dimension « utopique » [18], mais aussi le fait que celui-ci se
développa parmi les couches les plus pauvres de la population juive de
l’Est européen, entre Russie et Pologne, en pleine période de pogroms.
Ce mouvement revivaliste se caractérisa également par une forte
propension au retour sur soi – on le qualifia souvent de secte juive –
et au refus de l’assimilation [19].
Les anarchistes et le sionisme
« Mais il y a des Arabes en Palestine ! Je ne le savais pas ! »
Un proche collaborateur de Herzl [20].
« Nous
avons la nostalgie d’un Canaan qui ne nous a jamais vraiment appartenu.
C’est pourquoi nous sommes toujours à l’avant-garde des utopies et des
révolutions messianiques, toujours à la poursuite d’un Paradis Perdu »
Arthur Koestler, La Tour d’Ezra [21].
Pour
un libertaire soucieux de ne cautionner aucun dérapage antisémite, la
critique du sionisme comme idéologie nationaliste n’est jamais simple.
Elle l’est d’autant moins que la confusion des genres existe bel et bien
entre antisionisme et antisémitisme. Elle existe d’autant que les
organisations de soutien à la cause palestinienne n’ont pas toujours été
claires sur cette question et que, désormais travaillées au corps par
les fondamentalistes, elles le sont chaque fois moins. Autrement dit,
l’antisémitisme réel de certains antisionistes continue de faire
obstacle à une nécessaire réflexion critique sur le sionisme.
C’est
précisément pour répondre à cette récurrence de l’antisémitisme dans la
société occidentale, et comme son contrepoint, qu’est né le sionisme.
L’idée de créer un État propre aux juifs [22] prit forme à Bâle, en août
1897, avec le premier congrès sioniste mondial. Ce faisant, se
mettaient en place les conditions d’un conflit dont le monde n’est
toujours pas sorti .
Évoquée dans plusieurs contributions, la
question des relations entre les anarchistes et le sionisme constitue un
des aspects centraux de cet ouvrage. Ainsi, s’intéressant à la position
de Gershom Scholem, Eric Jacobson [23] insiste sur ce « lien étroit »
(p. 58) que le penseur établissait entre anarchisme et sionisme. Pour
Scholem, en effet, de même qu’il ne pouvait subsister « aucune
distinction entre l’idée prophétique de Sion dans la Torah et le retour à
la Palestine du XXe siècle » (p. 58), de même l’autodétermination du
peuple juif devait se fonder sur une synthèse entre sionisme et
anarchisme. Au risque, comme le signale justement Jacobson, de rester « à
mi-chemin » de l’un et de l’autre. Car c’est bien cette impression qui
domine chez Scholem d’un éternel partage – ou va-et-vient – entre les
idéaux anarchistes et le pragmatisme du sionisme. Jacobson, qui rappelle
que Scholem voyait dans l’anarchisme « l’unique théorie sociale qui ait
un sens – un sens religieux » [24], précise que, chez lui, ce « choix
de l’anarchie » (p. 72) ne réglait pas tout. C’est sans doute ainsi
qu’il faut entendre cette parole énigmatique de Scholem, cité par
Jacobson : « Peut-être sommes-nous anarchistes, mais nous nous opposons à
l’anarchie » [25].
Cette évidente contradiction qu’il y a, pour
un anarchiste, à s’inscrire dans un mouvement clairement nationaliste de
revendication territoriale traverse plusieurs contributions, mais elle
fait l’objet d’un traitement minimal. Au point qu’il est frappant de ne
trouver, dans cet ouvrage, aucune trace d’une opposition, fondée sur
l’affirmation des valeurs a-patriotiques propres aux anarchistes, à
l’établissement d’un État juif en Palestine.
C’est ainsi que Mina
Graur [26] rappelle que Moses Hess préconisait, dès 1862, « la création
d’un Commonwealth juif en Palestine, dans lequel les juifs auraient pu
concrétiser leurs aspirations nationales en donnant vie, en même temps, à
une société socialiste » (p. 127). Elle revient également sur le débat
qui confronta, en 1907, Mark Yarblum, un anarchiste juif, à Pierre
Kropotkine, sur la question de la constitution d’un État juif en
Palestine, en précisant que Kropotkine, bien qu’hostile au sionisme par
conviction politique, lui opposa surtout des arguments géographiques
liés « aux inconvénients climatiques du lieu » (p. 134). Curieusement,
il n’est fait aucune référence à l’existence d’une population arabe
vivant déjà en Palestine. Ni ici ni ailleurs. Comme si ce problème
n’existait pas. Et de fait, à lire Mina Graur, il ne semblait pas
exister. Pas plus qu’il n’existait pour Gershom Scholem, à lire Éric
Jacobson. Que la présence de cette population – qui n’était en rien
responsable des vagues antisémites qui s’abattirent, en Occident, sur la
Diaspora – fût, du fait même qu’elle était là, contradictoire avec la
constitution d’un État juif, est une donnée qui n’apparaît pas.
Dans
ce dispositif d’occultation, les kibboutz vont jouer un rôle essentiel.
Augustin Souchy, anarchiste de premier plan qui fit deux séjours en
Israël en 1951 et 1962, affichera un bel enthousiasme pour ces
réalisations communautaires : « Le kibboutz est ancré dans le sentiment
commun de personnes qui se réunissent volontairement pour que la justice
sociale devienne une réalité. […] Les établissements de ce type
resteront dans l’avenir les prototypes de la justice sociale » [27].
Outre
l’influence des conceptions de Kropotkine, Yaacov Oved insiste, en
effet, sur le rôle que joua Martin Buber dans « la pénétration des idées
de Gustav Landauer au sein des milieux engagés dans la construction des
kibboutz » (p. 198). De Buber, « ami intime de Landauer » (p. 198), il
dit qu’il « avait une affinité philosophique profonde avec l’anarchisme,
en particulier dans ses aspects messianiques et dans sa théorie de
l’individu en société, bien qu’il soit difficile de le définir comme un
anarchiste dans le sens classique du terme » (p. 198). Jusque-là,
l’exposé est juste, mais là où le bât blesse, c’est lorsque Yaacov Oved
reprend à son compte, sans l’étayer, l’opinion de Buber selon laquelle
Landauer aurait été, dans ses dernières années, « très proche des
milieux sionistes » (p. 198). Car il est osé, en effet, d’avancer une
telle thèse à partir du seul fait qu’il aurait été invité « à une
conférence sur Eretz-Israël qui devait se tenir à Munich en 1919 » (p.
198). Outre le fait qu’il ne put honorer cette invitation pour avoir été
assassiné, le 2 mai de cette année-là, lors de l’écrasement de la
République des conseils de Munich, son acceptation de s’y rendre ne
prouverait rien. Si l’on sait, par Buber et par Scholem [28], que
Landauer donna, sur des sujets philosophiques et politiques variés, de
nombreuses conférences dans les cercles sionistes de son époque, rien
n’indique qu’il eût manifesté, à la fin de sa vie, une particulière
sympathie pour le sionisme. À la vérité, il semble plutôt que Landauer
ne trancha pas. Comme si, vingt ans après la conférence de Bâle, cette
question du sionisme continuait de l’embarrasser. À ce silence, qui
reflète plutôt la gêne que tout anarchiste – même singulier, comme
Landauer – éprouve forcément devant une revendication de type
nationaliste, Buber donna valeur d’approbation. Sans apporter la moindre
confirmation historique sur le sujet, c’est cette thèse que reprend
Yaacov Oved [29]. Beaucoup plus prudente, la contribution de Siegbert
Wolf [30] offre, quant à elle, une vision différente. Concernant la
participation de Landauer aux activités des cercles sionistes, Siegbert
Wolf indique, en effet : « Landauer jugeait ces réunions fructueuses,
tout en étant opposé aux sionistes : il ne pouvait se représenter un
judaïsme vivant que dans la Diaspora, et ni en Palestine ni dans un État
juif il ne voyait de moment utopique […] » (p. 83). La différence avec
Buber – qui, lui, adhérait au sionisme, même de manière tout à fait
originale – n’est pas mince. Il est donc difficilement contestable de
nier que Buber, dont l’admiration pour le socialisme communautaire de
Landauer était en effet totale, se réappropria l’héritage intellectuel
de Landauer pour l’adapter à sa propre vision – au vrai sens du terme
utopique – d’une « communauté fédérale bi-nationale » (p. 84) en
Palestine où, égaux en droit, Juifs et Arabes participeraient d’un même
mouvement de « renouveau pour l’humanité tout entière » (p. 84) [31].
Si
le sionisme est né de la séculaire persécution antisémite – dont la
Shoah a constitué le point de non-retour, rendant humainement
incontestables les arguments en faveur de l’existence d’un foyer
protecteur pour les survivants –, le projet qu’il portait [32] ne
pouvait que glisser vers une revendication nationaliste et étatiste, ce
qui, du point de vue anarchiste, était difficilement justifiable. Dans
La Tour d’Ezra, Arhur Koestler témoigne de son aventure sioniste. Il y
raconte comment cet établissement fut en fait la conquête d’un
territoire et comment, la seule identité religieuse étant inopérante
pour le cas, cette conquête eut besoin d’une justification raciale. Pour
lourd de sens qu’il soit, ce glissement vers une ré-appropriation par
le sionisme du concept antisémite de race juive n’est évoqué dans aucune
contribution de cet ouvrage. Serait-ce ce qu’avaient compris ces
rabbins ultra-orthodoxes qui refusèrent cette « délivrance artificielle »
offerte par les sionistes, mais jugée contraire « au chapitre 30 du
Deutéronome » [33] ? L’anarchiste athée que je prétends être se gardera
bien de trancher un tel débat.
En revanche, le débat sur la
manière dont a été perçu l’antisémitisme et analysée la Shoah au sein du
mouvement anarchiste, francophone en particulier, mérite, lui, sinon
d’être tranché, du moins d’être examiné de près. Poser ce problème n’est
pas, à mes yeux, sacrifier à une moderne tendance à la repentance, mais
simplement constater que, dès ses origines, le mouvement anarchiste a
été confronté à cette question et qu’il ne l’a pas toujours traitée
comme il aurait dû.
Les deux formes de l’antisémitisme
Avant
d’aller plus avant, il convient de s’entendre sur ce que recouvre le
terme d’antisémitisme, en précisant que cette plaie a pris deux formes :
l’une, traditionnelle, dont les premières manifestations remontent à
avant l’ère chrétienne ; l’autre, idéologique, qui date, elle, du milieu
du XIXe siècle.
Habité d’une même curiosité malsaine pour les
juifs que Hécatée d’Abdère (IVe siècle avant J.-C.), philosophe grec
ayant vécu en Égypte, et Manéthon (IIIe siècle avant J.-C.), prêtre
égyptien, Posidonius d’Apamée (135-51 avant J.-C.), philosophe stoïcien
vivant à Rhodes, en parla en ces termes : « Les Juifs impies et haïs ont
été chassés d’Égypte couverts de lèpre et de dartres, puis ils avaient
conquis Jérusalem et avaient perpétué la haine des hommes » [34].
L’intérêt de ce texte, c’est qu’il infirme l’idée d’une concordance
mécanique entre l’antisémitisme et l’accusation de déicide, dont le
christianisme fit son fonds de commerce. La lèpre antisémite a, en
réalité, des racines bien plus anciennes et semble tenir au fait que,
cinq cents ans avant l’ère chrétienne, l’irruption du premier
monothéisme créa une authentique rupture dans l’imaginaire de l’époque.
En opposant la vérité révélée et le Dieu unique aux mensonges et aux
idoles, le judaïsme se mit à dos l’ensemble du monde antique
méditerranéen [35].
Il faudra plusieurs siècles, en effet, au
monothéisme chrétien pour qu’il s’impose à son tour. Sous l’empereur
Constantin, l’édit de Milan de l’an 313 garantit à ses adeptes une
tolérance qui équivaut à la reconnaissance du christianisme comme
religion d’État. Les juifs profiteront de cette reconnaissance, leur
monothéisme étant d’autant plus acceptable qu’il n’a pas de visée
universelle, contrairement à celui de Rome. Au cours des siècles obscurs
du haut Moyen Âge, alors que s’effondrent les structures de l’Empire
romain, les seuls points de repère qui demeurent sont les monastères
chrétiens et les communautés juives. Ces dernières vont jouer un rôle
économique important en favorisant la circulation de l’argent et des
esclaves à travers l’Empire carolingien et l’Empire abbasside. En effet,
en cette époque où les deux empires sont en guerre, les juifs jouissent
de relais communautaires nombreux et fiables dans les deux entités.
Musulmans et chrétiens leur accordant leur confiance, ils jouissent
d’une situation privilégiée dans le système commercial international de
l’époque, exportant armes, esclaves et fourrures de l’Empire carolingien
vers l’Empire byzantin [36].
C’est dans ce tréfonds de l’histoire
que résident les soubassements de cet antisémitisme traditionnel.
Enfouie dans l’inconscient populaire depuis les origines, cette mémoire
cachée resurgit, à dates régulières, comme un geyser jamais éteint. Des
croisades aux pogroms, en passant par les grandes vagues d’expulsion.
Avec
l’affaire Dreyfus (1894) apparaît une autre forme d’antisémitisme, plus
idéologique, adaptant l’anti-judaïsme traditionnel à l’esprit du temps,
ce temps qui conduira, au lendemain de la Grande Boucherie de 1914, à
l’éclosion des fascismes – dont l’antisémitisme obsessionnel du nazisme
fut la plus folle expression et la Shoah la plus atroce mise en
pratique.
Anarchisme et antisémitisme
Si
l’on fait remonter la naissance organique de l’anarchisme au congrès de
Saint-Imier (1872), il faudra donc une vingtaine d’années pour que les
anarchistes soient directement -– et concrètement – confrontés au
problème juif [37]. « Il y avait avant l’affaire Dreyfus, écrit
Jean-Marc Izrine, une pensée antisémite prononcée à l’intérieur des
mouvements socialistes. C’était dû à plusieurs facteurs : une
méconnaissance du judaïsme doublée d’une vision péjorative du juif
vivant en Occident ; une critique non contenue de la religion hébraïque
sous couvert d’anticléricalisme ; une dénonciation sans nuance du
“capital juif ” sous prétexte d’anti-capitalisme » [38]. S’il ne s’agit
pas de revenir sur le cas de Proudhon, dont la haine du juif fut
récurrente, ou, dans un tout autre ordre d’idée, sur les dérives
langagières de Bakounine contre « le juif Marx », on peut néanmoins
constater que, comme les autres écoles socialistes, le mouvement
anarchiste se laissa parfois aller à certaines connivences malsaines
avec cet antisémitisme populaire aux racines aussi vieilles que
l’histoire humaine. En ce sens, il lui arriva aussi de participer de ce «
socialisme des imbéciles », si justement pointé par August Bebel. Avec
l’affaire Dreyfus, ajoute Jean-Marc Izrine, « les libertaires situeront
définitivement l’antisémitisme idéologiquement à droite » [39],
affirmation qui peut s’admettre si l’on considère que, très
majoritairement, les anarchistes s’impliquèrent alors – et parfois les
premiers, comme Bernard Lazare [40], et en première ligne – dans le
combat dreyfusard, mais qui mérite tout de même d’être nuancée. Ainsi,
Sylvain Boulouque [41] atteste de la présence, sinon d’une récurrence
antisémite, du moins d’une « conflictualité » potentielle, parfois
exprimée, entre anarchisme et judaïsme, au sein du mouvement anarchiste
français, et ce bien au-delà de l’affaire Dreyfus.
Ainsi, une
fois la Seconde Guerre mondiale venue, les anarchistes la subirent. Dans
l’attente de jours meilleurs et recroquevillés sur eux-mêmes. Si
quelques-uns cédèrent à l’infamie, d’autres résistèrent à leur façon,
privés de tout car peu enclins à rejoindre les maquis gaullistes ou
communistes [42]. Sans gloire, en somme. Pourtant une histoire reste à
écrire, celle des réseaux que quelques-uns de ces anarchistes ou
syndicalistes révolutionnaires mirent sur pied, et dont l’une des
activités fut de porter assistance à des juifs plus traqués
qu’eux-mêmes. Il en alla ainsi de Roger Hagnauer, lui-même d’origine
juive et membre du noyau de La Révolution prolétarienne, et de sa femme
Yvonne Hagnauer, pédagogue et syndicaliste, qui jouèrent un rôle
considérable dans le sauvetage de gamins juifs, accueillis et cachés, en
1942 et 1943, dans leur Maison d’enfants de Sèvres [43]. Il en alla
encore ainsi des anarchistes espagnols du réseau d’évasion du groupe
Ponzán [44], qui, au risque de leurs propres vies, passèrent de nombreux
juifs en Espagne pour les tirer des griffes des autorités de Vichy et
de la Gestapo.
Si l’on peut comprendre que, comme tant d’autres,
les anarchistes ne saisirent pas la spécificité de la « solution finale
», une interrogation demeure ouverte, du moins pour moi. Même passé
l’effroi provoqué par la découverte de l’horreur concentrationnaire, le
mouvement anarchiste français d’après-guerre n’eut non seulement rien à
dire – ou si peu – sur un événement aussi considérable que la Shoah,
mais il fit preuve d’une rare tolérance vis-à-vis d’un personnage au
parcours sinueux qui fréquenta assidûment ses rangs, durant les années
1950, et y trouva quelques complicités suspectes. Comme justification a
posteriori d’une telle attitude, on a laissé entendre, sotto voce, qu’en
cette période de grande conflictualité interne, le mouvement anarchiste
était sans doute trop occupé à régler ses problèmes d’intendance pour
que ses militants se posent des questions autrement plus vastes, ni même
pour qu’ils s’intéressent de près à qui les fréquentait. On a également
dit qu’à l’orée des années 1960, la guerre d’Algérie occupant toutes
les attentions, une réflexion proprement anarchiste sur la Shoah ne
répondait pas aux priorités du temps. En revanche, il ne semble pas
qu’on se soit interrogé sur une possible corrélation entre cette
attitude pour le moins discrète et l’ancienne complaisance pour
l’antisémitisme que manifestèrent, même très minoritairement, avant
guerre, certains anarchistes.
Cet étrange Rassinier
Natif
du Territoire de Belfort et instituteur de profession, Paul Rassinier –
1906-1967 – [45] navigua, avant guerre, du PC -– dont il fut exclu pour
« gauchisme » en 1922 – aux groupes oppositionnels communistes, puis à
la SFIO. Pacifiste intégral dans les années d’avant-guerre, il
participa, sous l’Occupation, à la création du mouvement de résistance
Libération-Nord, tout en s’y déclarant hostile aux actions armées.
Arrêté en 1943, il fut déporté au camp de Dora. Déclaré invalide à son
retour d’Allemagne, il dut renoncer à sa carrière d’enseignant. Député
SFIO de la seconde Constituante – en remplacement de René Naegelen, qui
s’était démis de son mandat en sa faveur en septembre 1946 –, il fut
battu, deux mois plus tard, aux législatives de novembre, par son ennemi
de toujours, le radical Pierre Dreyfus-Schmidt, allié, pour l’occasion,
aux communistes belfortins.
C’est alors que Rassinier entame une
nouvelle phase de son existence et que son parcours va croiser celui des
anarchistes. En 1950, il fait paraître, préfacé par Albert Paraz [46],
Le Mensonge d’Ulysse. Séjournant à Mâcon depuis sa mésaventure
électorale, il fréquente le groupe local des Citoyens du monde et
adhère, en 1954, à la Fédération anarchiste (FA), tout juste
reconstituée. À Nice, où il habitera par la suite, il entre au groupe «
Élisée Reclus » et se fait nommer « gérant-directeur » de son journal,
L’Ordre social. Installé à Asnières en 1958, il devient un collaborateur
assidu de la presse libertaire – Le Monde libertaire, Contre-courant et
Défense de l’homme, notamment -–, où il se taille une réputation
d’expert en questions économiques.
Ce qui fit, plus que tout, la
sulfureuse réputation de Rassinier, fut donc la publication du Mensonge
d’Ulysse, libelle devenu, au gré du temps, le livre phare des
négationnistes de toutes obédiences, mais particulièrement de ceux
procédant d’une « ultra-gauche » aussi doctrinaire que délirante. Si le
sujet de ce livre n’est pas la négation des chambres à gaz, mais la
dénonciation du rôle des kapos – communistes – à l’intérieur des camps,
et, conséquemment, la remise en cause de ce que Rassinier appelle le «
mensonge d’Ulysse », à savoir le mythe – communiste – de la solidarité
entre détenus, une phrase sibylline, à peine murmurée, ouvre les vannes
du doute : « Mon opinion sur les chambres à gaz ? Il y en eut : pas tant
qu’on le croit. Des exterminations par ce moyen, il y en eut aussi :
pas tant qu’on l’a dit » [47].
Cette phrase, pourtant lourde de
sens, n’a pas éveillé chez les libertaires de l’époque, du moins
publiquement, la moindre réserve sur les véritables intentions de
l’auteur – intentions qui furent, en revanche, clairement décelées,
approuvées, recyclées et développées, quelque trente ans plus tard, par
les négationnistes. Cette phrase ne fit aucun scandale dans le Landernau
anarchiste, et c’est bien là que le bât blesse. Pour obscène qu’elle
fût, elle passa au second plan. Au nom du combat pour la seule vérité
qui semblait mobiliser, alors, les libertaires : la juste dénonciation
des infamies staliniennes. Même André Prudhommeaux, dont l’œuvre écrite
prouve pourtant une particulière aptitude à la sagacité, s’y laissa
prendre quand – cinq ans après la publication du Mensonge d’Ulysse ! –
il évoqua les procès intentés à Rassinier par d’anciens déportés en
lâchant une pitoyable allusion au « crime “virtuel” (non prouvé,
semble-t-il) de l’anéantissement par les gaz » [48].
Il fallut
attendre 1961 pour que la Fédération anarchiste se décide enfin à ouvrir
les yeux sur Rassinier. Pour cela, elle dut être informée, par des
anarchistes allemands, que cet encombrant personnage venait de faire
publier une traduction du Mensonge d’Ulysse chez Karl Heinz Priester,
ex-SS et éditeur néonazi notoire. En défense, Rassinier chargea ces «
soi-disant anarchistes allemands » du pire péché qui fût : « Ils sont
cul et chemise avec les communistes » [49]. L’argument, cette fois-ci,
ne convainquit personne [50].
Retour sur un génocide
Il
ne s’agit pas, bien sûr, de faire au mouvement anarchiste français de
cette époque un procès a posteriori. Après tout, au prétexte que les
cendres ne devaient pas être remuées trop tôt, il fallut que passe du
temps, beaucoup de temps, et ce dans tous les milieux, pour que
l’incontournable de la Shoah – son caractère génocidaire massif et
industriel [51] – ne soit plus contourné. Il convient de se souvenir,
par exemple, que vingt ans passèrent pour voir apparaître la première
traduction française du grand œuvre de Hannah Arendt, Les Origines du
totalitarisme [52]], dont l’édition américaine datait de 1951. De la
même façon, les expériences du sociologue américain Stanley Milgram sur
la soumission à l’autorité du « petit monde », menées au début des
années 1960 aux États-Unis, mettront dix bonnes années pour être connues
en France [53].
Si le film Nuit et brouillard (1955), d’Alain
Resnais, contribua, indiscutablement et largement, dix ans après la
libération des camps, à raviver la mémoire de « l’univers
concentrationnaire » – pour reprendre l’expression de David Rousset –,
il le fit à la manière de son temps, confuse, sans opérer de distinction
entre camps de concentration et d’extermination. En minorant, par
conséquent, la spécificité du génocide et la place des juifs dans ce
dispositif de liquidation. On sait, aujourd’hui, que cette lecture –
partielle et partiale – de l’histoire des camps répondait pour beaucoup,
en ces temps de guerre froide, à un impératif politique précis :
légitimer les communistes – le PCF séduisait, alors, un gros tiers de
l’électorat français – comme principal pôle de résistance au nazisme.
S’il était le « parti des fusillés », il fallait bien que le bilan des
victimes le prouve. En outre, toute la société française – et
particulièrement les réseaux dominant son establishment culturel et
politique – prit prétexte de la difficulté éprouvée par les rescapés
juifs à exprimer leur singularité de victimes pour gommer l’innommable
de la « solution finale ». Sur ce plan, et contrairement à leur penchant
pour la dissidence, les anarchistes ne brisèrent aucun consensus, sauf
celui de démythifier, Rassinier aidant, le mythe communiste
résistancialiste. On constatera simplement que, disposant, dans les
années 1920 et 1930, de beaucoup moins d’informations sur le Goulag
qu’ils n’en avaient, dans les années 1950, sur l’ampleur du génocide de
masse perpétré par les nazis contre les juifs, les anarchistes
comprirent et analysèrent la spécificité du totalitarisme soviétique,
alors qu’ils restèrent relativement muets devant la spécificité du
totalitarisme nazi.
Si le temps n’était pas encore venu de se
livrer, en anarchiste, à une réflexion sur la Shoah et sur ce que cet
événement – considérable – pouvait induire, pour un anarchiste, dans la
perception de son lien avec la condition juive, il est étrange, voire
problématique, que, soixante ans plus tard, un colloque réuni, par des
anarchistes, autour du thème « Anarchistes et juifs », lui accorde si
peu d’espace.
L’être juif, l’anarchiste et la Shoah
Qui
est juif ? À cette question, Rudolf de Jong [54] répond gentiment : «
Pour moi est juif toute personne qui considère une partie de la
tradition juive ou de la culture juive comme un aspect de son identité »
[55]. Cette définition est heureusement nuancée, quelques lignes plus
loin : « C’est l’antisémite qui décide de qui est juif » [56]. On se
rappelle, en effet, comment les nazis ou les autorités de Vichy firent
la chasse à ceux qui n’étaient pas aryens à moins de « x » générations.
Et, ce faisant, on approche ce que représente d’antagonisme ou
d’ambivalence le fait d’être juif. Je suis juif parce que ma mère est
juive, et que j’aime ma mère. Je suis juif parce que lui, l’autre, dit
ou pense – ouvertement ou honteusement – que je suis juif ou que je
pourrais l’être, et je n’aime pas cela. Pour autant un autre juif,
croyant, dira de moi que je ne le suis pas et, dans ce cas, je serais
content de ne pas l’être comme il l’est lui-même tout en sachant que, du
point de vue de l’antisémite, nous sommes lui et moi pareils,
c’est-à-dire de trop. Cette sensation d’être d’ailleurs est, là, en
arrière-plan, toujours. C’est elle qui permet au juif Arnold Mandel de
s’identifier, un temps, aux anarchistes, parce qu’ils les voient comme «
un monde à part », si proche du « milieu juif archaïque » [57]. C’est
encore cette sensation qui monte des propos d’Ida Mett, tels que les
rapporte Sylvain Boulouque, quand une polémique fait rage, en 1938, au
sein de La Révolution prolétarienne. Comment appeler les juifs qui
arrivent en Palestine ? Pour Robert Louzon, ce sont des colons ; pour
Ida Mett, ce sont des réfugiés. Et elle précise sa pensée dans une
lettre adressée à un membre du noyau de la revue : « À l’heure actuelle,
quand dans le monde sévit un énorme incendie dirigé contre le peuple
juif, je pense qu’il est criminel de jeter de l’huile sur le feu » [58].
Plus qu’une prophétie qui – hélas ! – va se réaliser, on peut voir là
l’effet d’une réminiscence, celle d’une douleur vieille comme l’histoire
juive. Parfois, cette ancienne douleur fait irruption et, avec elle,
monte une terreur tout aussi ancienne, celle-là même qui peut nous [me]
conduire à prendre des positions – électorales, en l’occurrence –, qu’on
[je]
sera incapable d’expliquer aux autres, surtout aux compagnons
[59]]. Parce qu’elle excède la raison. C’est pour cela que je cherche à
comprendre le génocide et pourquoi il s’est passé. C’est aussi pour cela
qu’une grande tristesse me prend quand je constate que la pensée dont
je me sens le plus proche –- l’anarchisme – est, semble-t-il, incapable
de produire la moindre réflexion originale sur la Shoah.
Car ce
livre pose, indubitablement, un problème de taille. La Shoah y est
totalement absente, si l’on fait exception des sept lignes que lui
consacre Rudolf de Jong dans sa contribution déjà citée. Sept lignes
pour évoquer un événement considérable, une extrême abomination ayant
conduit plus de six millions de personnes vers l’horreur. Sept lignes
quand le sujet a suscité des myriades de livres. Sept lignes, c’est
décidément court pour traiter de la Shoah quand son existence même remit
en cause – et pour l’humanité entière, auquel s’accorde le projet
libertaire – la possibilité de vivre debout.
Dans un fort beau texte,
mon ami René Fugler écrit : « C’est surtout la férocité rationalisée
des camps de concentration et d’extermination qui a tracé un seuil sans
retour. La prise de conscience ne s’est faite que par étapes : de la
déportation à la prise en compte du phénomène concentrationnaire, puis à
la reconnaissance de la réalité du génocide en tant que tel » [60].
Mais il ajoute plus avant qu’avec « l’irruption de nouveaux massacres
ethniques […], une illusion s’est défaite : l’idée que cette terreur
était un produit spécifique du nazisme et que, puisqu’on en avait fini
avec lui, elle ne se renouvellerait pas » [61]. Et d’insister : « La
civilisation industrielle a produit un décalage de plus en plus large
entre nos possibilités de réalisation et notre capacité de ressentir, de
percevoir, d’imaginer même le résultat final de nos fabrications. Cette
incapacité est encore accrue par la “division du travail” qui, dans le
génocide déjà, a permis à d’innombrables exécutants de poursuivre leur
tâche “consciencieusement” mais sans conscience » [62]. À ma
connaissance, René Fugler constitue l’un des rares exemples – le seul
probablement – à avoir abordé, soixante ans après l’événement, cette
problématique d’un point de vue anarchiste.
La question demeure,
donc, de cette longue impensée libertaire sur la Shoah. S’il fallait lui
trouver une explication – et il le faut –, je dirais qu’elle est
multiple. Elle devrait tenir compte de l’hypothèse, avancée par Sylvain
Boulouque, d’une rémanence antisémite au sein de l’imaginaire
libertaire, antisémitisme larvaire resurgissant périodiquement, le plus
souvent sous sa forme cachée -– anti-impérialiste et antisioniste – dans
les manifestations de solidarité à la cause palestinienne. En deuxième
lieu, il faut bien reconnaître que le mouvement libertaire maintient un
rapport privilégié à sa propre mémoire – celle de ses défaites, et
particulièrement celle qui, d’avoir été évitée en terre d’Espagne,
aurait pu mettre un terme à l’avancée des fascismes. Ce combat pour la
mémoire libertaire, titanesque au vu des faibles forces et des pauvres
moyens de celles et ceux qui le portent, conforte, à coup sûr, dans la
galaxie anarchiste, le sentiment justifié que, sans cet effort constant
de remémoration, la chape de plomb se serait abattue depuis longtemps
sur son histoire qui, pour le coup, témoigne, en Espagne notamment, que
le seul mouvement populaire et massif de résistance au fascisme fut, à
l’origine du moins, impulsé par des libertaires. Le revers de la
médaille, c’est que l’indispensable revendication de cette mémoire
particulière ne va pas sans un certain auto-enfermement. Enfin, la place
accordée à la dénonciation, permanente et argumentée, du totalitarisme
soviétique occupa longtemps, et dans les conditions les plus difficiles
qui soient, une grande partie de l’espace intellectuel des libertaires.
Il fallut bien ça pour échapper à son emprise et maintenir vivante une
alternative au « socialisme réel ».
D’autres absences, en guise de conclusion
Ce
colloque – et donc ce livre – n’avait pas, comme c’est normal, vocation
à l’exhaustivité. Il n’en demeure pas moins qu’il fait totalement
l’impasse sur trois aspects de première importance : les juifs
séfarades, les Arabes palestiniens et les femmes.
Concernant les
juifs séfarades, il eût été intéressant, par exemple, de s’interroger
sur les raisons qui les maintinrent, globalement, en marge du courant
anarchiste ou, plus précisément, sur le pourquoi l’anarchisme ne les a
pas séduits [63]. La question est d’autant plus intéressante que
l’empreinte de cette branche du judaïsme fut très forte, des siècles
durant, tout autour du bassin méditerranéen, tant en nombre qu’en
spiritualité. À titre d’hypothèse, et compte tenu de la très ancienne
implantation des séfarades dans les territoires où ils vivaient – elle
datait, en effet, de la fin de l’Empire romain –, cette non-rencontre
pourrait s’expliquer par leur meilleure intégration à des types de
sociétés archaïques industriellement sous-développées. Une autre
hypothèse pourrait tenir au fait que le hassidisme n’ait eu aucune
influence sur leur perception du judaïsme.
Qu’ils soient chrétiens
ou musulmans, les Arabes palestiniens sont les autres grands absents de
ce recueil. Ce qui est grave, au moins pour deux raisons. D’abord,
parce qu’il est difficile de contester qu’ils ont été les principales
victimes du sionisme triomphant. Ensuite, parce que la façon dont les
organisations se réclamant de la cause palestinienne ont décidé, au
lendemain de la guerre des Six-Jours, de s’appuyer sur des méthodes
terroristes pour reconquérir leur terre, a fortement contribué, sous
couvert d’antisionisme, à un regain de l’antisémitisme. La solidarité
qu’elles rencontrent, notamment dans les mouvements politiques d’extrême
gauche, est à l’origine de bien des glissements, pas seulement
sémantiques, de l’un à l’autre.
Les dernières absentes de ce livre
sont, comme de juste, c’est-à-dire comme d’habitude, les femmes.
Heureusement, le livre se conclut par une courte, mais percutante,
contribution de Birgit Seeman [64] sur trois d’entre elles : Emma
Goldman, Milly Witkop et Hedwig Lachmann. On eût aimé que le parcours,
remarquable, de ces trois anarchistes juives, fasse l’objet d’une
évocation plus poussée. Ne serait-ce que parce qu’aucune de ces trois
femmes, qui revendiquèrent pourtant leur judéité, ne s’est jamais sentie
attirée, ni même concernée, par le nationalisme juif, auquel ce
colloque accorda décidément beaucoup trop de place. Au point que, pages
refermées, on se demande si ces trois femmes ne sont pas, après tout,
les seules anarchistes de ce livre. D’indispensable lecture, malgré ses
manques.
Pierre SOMMERMEYER
[1] Merci à René Fugler pour son aide et sa complicité. Sans lui, cet article aurait été fort différent.
[2]
Fils de mère juive de la minorité allemande de Pologne et de père
allemand d’origine protestante, je suis né en 1942. Cachés à
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), nous avons pu échapper aux rafles.
[3] Gregorio Rawin et Antonio López, « Anarchisme et judaïsme en Argentine. L’Asociación Racionalista Judía », pp. 173 à 180.
[4]
Dans la tradition judaïque, nom donné aux textes bibliques faisant Loi.
Elle comprend la Torah écrite (Pentateuque, Prophètes et Hagiographe)
et la Torah orale (Mishna, Talmud, Midrash ainsi que les commentaires et
les applications pratiques).
[5] Furio Biagini, « Utopie sociale et spiritualité juive », pp. 17 à 31.
[6]
Le « jubilé » représente, dans la Bible, cette année exceptionnelle
revenant tous les cinquante ans et marquant la redistribution égalitaire
des terres et la libération des esclaves.
[7] Il est indiqué que
les maisons en ville deviennent la propriété inaliénable de leur
acheteur, alors que celles qui se situent en dehors des murailles
reviennent, tous les cinquante ans, à Dieu, leur propriétaire originel.
Cette séparation entre la ville et la campagne repose sur le fait que la
terre est considérée comme un moyen de production.
[8] Traduction de la Bible de Jérusalem, Samuel, Premier Livre, chapitre 8.
[9]
La première mention de l’idée d’un messianisme juif se situe au
chapitre 9 du livre d’Isaïe (traduction de la Bible de Jérusalem) : «
Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a reçu le
pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom :
Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix [Is
9:5-], pour que s’étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône
de David et sur son royaume, pour l’établir et pour l’affermir dans le
droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l’amour jaloux de Yahvé
Sabaot fera cela. [Is 9:6-] »
[10] Traduction de la Bible de Jérusalem, Isaïe, chapitre 61.
[11]
Si cette notion d’« onction » fait évidemment penser aux rois
thaumaturges et à la tradition postérieure du couronnement des rois
français, le terme constitue, dans le cas qui nous occupe, une
traduction fidèle de l’hébreu, langue dans laquelle messie signifie «
roi oint ».
[12] Traduction de la Bible de Jérusalem, Osée, chapitre 1.
[13] Traduction de la Bible de Jérusalem, Jérémie, chapitre 2.
[14]
Pour approfondir cette question, le lecteur devra se reporter aux
textes qui fondent le messianisme juif, et particulièrement au chapitre
25 du Lévitique Sur le messiannisme, voir Frédérique Leichter-Flack,
entrée « Messianisme », in Nouveau dictionnaire international des termes
littéraires, Paris, Université Paris III-Sorbonne.
[15] Dans un
livre paru en 1969, Judaïsme contre sionisme – Paris, Éditions Cujas –,
le rabbin et kabbaliste de renom Emmanuel Lévyne (1928-1989) intitulait
un courrier adressé à la revue libertaire Défense de l’homme : «
L’hébraïsme est un anarchisme ». Il y déclarait : « Nous, enfants
d’Abraham, nous ne voulons d’aucun État, ni d’un État français, ni d’un
État juif, ni d’un État arabe. » Sur cette thématique de l’anti-sionisme
judaïque, on lira avec profit l’ouvrage de Yakov M. Rabkin, Au nom de
la Torah. Une histoire de l’opposition juive au sionisme, Montréal, Les
Presses de l’Université Laval, 2005.
[16] En réaction contre le
judaïsme « académique » de son époque, ce mouvement mystique de
renouveau juif fut fondé, au XVIIIe siècle, en Biélorussie et en
Ukraine, par Israël ben Eliezer (1700-1760), plus connu sous le nom de
Baal Shem Tov (le Maître du Bon Nom). Accusé d’être davantage une
manière d’être ou une éthique qu’un courant religieux, le hassidisme fut
sévèrement condamné par Rabbi Eliyahou ben Shlomo Zalman (1720-1797) et
les principales autorités rabbiniques de cette époque.
[17] Daniel Grinberg, « Formes de la militance radicale en Pologne », pp. 159 à 171.
[18]
« Il représentait, nous dit Chaïm Seeligmann , une protestation de la
part de ceux qui aspiraient au salut ou à la libération d’une situation
difficile », « une tension vers une utopie lointaine » (p. 50), in Chaïm
Seeligmann, « Apocalypse, messianisme laïque et utopie », pp. 45 à 52.
[19]
Il faut noter que les trois religions monothéistes – judaïsme,
christianisme et islam – connurent, au cours de leur histoire, des
mouvements mystiques à connotation puritaine de même type prônant le
retour aux origines.
[20] Cité sur
www.lapaixmaintenant.org/article337
[21] Arthur Koestler, La Tour d’Ezra, traduit de l’anglais par Hélène Claireau, Paris, Calmann-Lévy, 1948, p. 410.
[22]
Ce désir d’État séparé ou de territoire propre est, par ailleurs,
intimement lié à la culture occidentale du XIXe siècle, pour laquelle
les concepts de peuple et de nation se confondent avec celui de
territoire. C’est, de manière inversée, la même idée qu’exprima le comte
de Clermont-Tonnerre, partisan de l’émancipation des juifs, lorsqu’il
déclara à la tribune de l’Assemblée, en décembre 1789 : « Il faut tout
refuser aux juifs comme nation et tout leur accorder comme individus. »
Pour d’autres peuples ou nations nomades, en revanche, cette idée de
territoire est parfaitement inopérante (cf. articles sur les Roms et les
Touaregs dans Réfractions, n° 21, « Territoires multiples, identités
nomades », novembre 2008).
[23] Eric Jacobson, « Gerschom Scholem, entre anarchisme et tradition juive », pp. 53 à 75.
[24] Gershom Scholem, « Entretien avec Muki Tsur », in Fidélité et utopie, Paris, Calmann-Lévy, 1978.
[25] Paul Mendes-Flor, Divided Passions, Detroit, 1991.
[26] Mina Graur, « Anarchisme et sionisme : le débat sur le nationalisme juif », pp. 125 à 142.
[27]
Cette laudative impression – extraite des mémoires d’Augustin Souchy :
Attention anarchiste ! Une vie pour la liberté, Paris, Éditions du Monde
libertaire, 2006 – est reprise, page 202, par Yaacov Oved, «
L’anarchisme dans le mouvement des kibboutz », pp. 195 à 205.
[28]
Dans son autobiographie – De Berlin à Jérusalem, Paris, Albin Michel, «
Présences du judaïsme », 1984 –, Gershom Scholem se garde bien,
d’ailleurs, de faire de Landauer un rallié au sionisme.
[29] En
revanche, Yaacov Oved ne dit pas un mot sur Rudolf Rocker – qui pour
être « goy » n’en fut pas moins très proche du monde juif. Il eût été
pourtant intéressant de se demander pourquoi Rocker resta si discret sur
le sionisme, mais aussi sur l’antisémitisme, dans son grand œuvre,
Nationalisme et culture – Paris, Éditions CNT-RP/Éditions libertaires,
2008. Discrétion que confirme, sans lui donner d’explication, Rudolf de
Jong dans sa contribution : « Réflexions sur l’antisémitisme dans le
débat anarchiste », pp. 143 à 158.
[30] Siegbert Wolf, « “Le vrai
lieu de sa réalisation est la communauté”. L’amitié intellectuelle entre
Landauer et Buber », pp. 75 à 89.
[31] Comme l’indique Siegbert
Wolf, « Buber voyait certes dans la Palestine le centre culturel du
judaïsme et le lieu de sa renaissance, mais il ne croyait pas en la
nécessité d’un État juif » (p. 85). Sa vie durant, il lutta -– notamment
au sein de Berit Shalom (association de la paix), groupe né à Jérusalem
en 1925 – pour la constitution d’un État laïque reposant sur la parité
entre Juifs et Arabes. Inutile de préciser que cette position fut
toujours très minoritaire au sein du camp sioniste.
[32] Rappelons que ce projet eut des variantes ougandaise et argentine.
[33] Emmanuel Lévyne, Judaïsme contre sionisme, p. 46, op. cit.
[34]
Théodore Reinach, Textes d’auteurs grecs et romains relatifs au
judaïsme, Paris, 1895, réédition Les Belles Lettres 2007. On peut lire
un compte rendu de lecture de cet ouvrage essentiel sur la page
http://plusloin.org/plusloin/spip.php?rubrique4.
[35] Il est intéressant de noter qu’au même moment s’inventait, au nord de la Palestine, la démocratie athénienne.
[36]
Le concile de Meaux-Paris – vers 850 – interdira, entre autres choses,
aux juifs de posséder des esclaves chrétiens et, plus généralement, de
faire commerce des esclaves.
[37] Sur la perception de l’affaire
Dreyfus par les anarchistes, on lira avec profit : Sébastien Faure, Les
Anarchistes et l’affaire Dreyfus, présentation de Philippe Oriol, Paris,
Éditions CNT-Région parisienne, 2002 ; Jean-Marc Izrine, Les
Libertaires dans l’affaire Dreyfus, Toulouse, Le Coquelicot, 2004.
[38]
Jean-Marc Izrine, « Il y a cent ans la réhabilitation de Dreyfus.
L’apport méconnu des libertaires », Réfractions, n° 17, hiver
2006-printemps 2007, pp. 153-157.
Consultable sur http://refractions.plusloin.org/spip.php?article179
[39] Ibid.
[40] Sur Bernard Lazare, indispensable est la lecture de l’ouvrage de Philippe Oriol, Bernard Lazare, Paris, Stock, 2003.
[41]
Sylvain Boulouque, « Anarchisme et judaïsme dans le mouvement
libertaire en France. Réflexions sur quelques itinéraires », pp.
113-124.
[42] Michel Sahuc, Un regard noir. La mouvance anarchiste
française au seuil de la Seconde Guerre mondiale et sous l’occupation
nazie (1936-1939), Paris, Éditions du Monde libertaire, 2008.
[43] Pour en savoir plus sur les activités du couple Hagnauer, on se reportera au site http://lamaisondesevres.org/
[44]
Antonio Téllez Solà, Le Réseau d’évasion du groupe Ponzán. Anarchistes
dans la guerre secrète contre le franquisme et le nazisme, Toulouse, Le
Coquelicot, 2008.
[45] À propos de Rassinier, on lira : Nadine
Fresco, Fabrication d’un antisémite, Paris, Seuil, « La librairie du XXe
siècle », 1999, et Florent Brayard, Comment l’idée vint à M. Rassinier.
Naissance du révisionnisme, préface de Pierre Vidal-Naquet, Paris,
Fayard, 1996. À propos du négationnisme, on se reportera à Pierre
Vidal-Naquet, Les Assassins de la mémoire, Paris, La Découverte, 1987 ;
Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, Paris, Seuil, 2000
; Louis Janover, Nuit et brouillard du révisionnisme, Paris, Éditions
Paris-Méditerranée, 1996.
[46] Cette préface valut au « citoyen
Rassinier » d’être exclu de la SFIO pour « atteinte intolérable à
l’honneur des résistants » (19 avril 1951). Albert Paraz (1899-1957),
romancier et journaliste, se disait volontiers « anarchiste de droite ».
Sur son anarchisme, on peut avoir des doutes. De droite, et plutôt
extrême, Paraz – collaborateur de Rivarol et défenseur fanatique du «
martyr » Louis-Ferdinand Céline – le fut totalement.
[47] Paul
Rassinier, Le Mensonge d’Ulysse. Regard sur la littérature
concentrationnaire, Bourg-en-Bresse, Éditions bressanes, 1950, p. 171.
[48]
André Prudhommeaux, recension du Mensonge d’Ulysse, Témoins, n° 8,
printemps 1955. Consultable sur le site La Presse anarchiste : –
[49]
Lettre de Paul Rassinier, Bulletin de la Fédération anarchiste, n° 39,
octobre 1961, pp 6-10. Citée par Nadine Fresco, op. cit. En 1964, lors
d’un procès en diffamation intenté par Rassinier à la Ligue
internationale contre l’antisémitisme (LICA), qui l’avait accusé d’être
un « agent de l’internationale néonazie », les débats révélèrent, par
ailleurs, qu’il appointait à Rivarol pour des collaborations signées du
pseudonyme Bermont.
[50] Ou presque, puisqu’il adhéra par la
suite, semble-t-il, à une curieuse et confuse secte de la galaxie
libertaire : l’Alliance ouvrière anarchiste.
[51] Le génocide des
Tsiganes demeure encore largement occulté. Lire, à ce sujet : Claire
Auzias, Samudaripen. Le génocide des Tsiganes, Paris, L’Esprit frappeur,
1999.
[52] Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, suivi de Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard/Quarto, 2002.
[53]
Stanley Milgram, La Soumission à l’autorité, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
Les expériences de Milgram ont été portées à la connaissance du grand
public à travers le film I comme Icare, de Henri Verneuil, sorti en
1979.
[54] Rudolf de Jong, « Réflexions sur l’antisémitisme dans le débat anarchiste », op. cit.
[55] Ibid., p. 144.
[56] Ibidem.
[57] Arnold Mandel, Nous autres Juifs, Paris, Hachette, 1978. Cité par Sylvain Boulouque, p. 113.
[58] Ida Mett, lettre à Finidori, 13 novembre 1938, cité par Sylvain Boulouque, p. 119.
[59]
L’auteur fait ici allusion au fait qu’il ait appelé à voter contre Le
Pen au second tour de l’élection présidentielle de mai 2002. [NdlR.
[60]
René Fugler, « Cruauté du monde, cruauté de l’homme », Réfractions, «
Ni Dieu ni maître. Religions valeurs, identités », n° 14, printemps
2005, p. 22.
[61] Ibidem.
[62] Ibid., p. 23.
[63] Dans
un même ordre d’idée, les juifs britanniques issus de l’immigration
juive espagnole d’après la Reconquista ont été, semble-t-il, totalement
absents du mouvement anarchiste juif, exclusivement ashkénaze, à
l’époque où Rocker était à Londres.
[64] Birgit Seemann, « Anarcha-féminisme et judaïsme. Quelques questions », pp. 207 à 212.