Ou les finalités de l’Islam, d’après notre lecture du Coran.
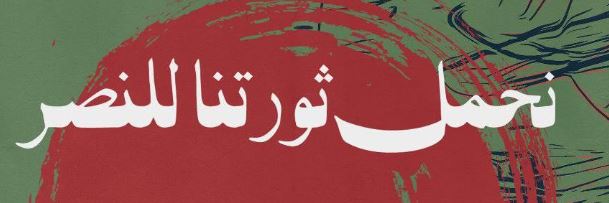
- Des rapports de dominations en Palestine occupée.
- Vers une victoire palestinienne ? Genocide, Insurrection et Ethique, une breche ouverte dans la muraille
Le site a vocation a écrire une théologie de la libération pour l’Islam.
Peut-on écrire une histoire par en bas des débuts de l’Islam ? Peut-on produire une islamologie musulmane autonome ? À la faveur du renouvellement de la recherche qui soulève des enjeux importants sur l’histoire de l’Islam et son rôle aujourd’hui, nous proposons à travers ce site une nouvelle approche methodologique.
L’analyse materielle et historique de l’expansion mecquoise permet de dégager les enjeux de la proclamation du Coran, et le conflit social interne qu’elle révèle. La geste de Muhammad et de ses compagnons montre le renouvellement de l’ethique bédouine par les principes monothéistes, dans un surprenant mélange d’autonomie et de justice sociale.
Pour saisir le renouvellement du monothéisme proposé par Muhammad, nous relisons le Coran par l’analyse rhétorique de M. Cuypers et les intuitions fortes de la théorie mimétique de R. Girard. Pour comprendre l’émergence de l’islam et ses objectifs nous appliquons les outils de l’anthropologie anarchiste et du matérialisme dialectique. Il en résulte l’histoire d’une transformation profonde de l’anthropologie bédouine vers une autodetermination du genre humain.
Autodétermination de l’humanité
- L’humanité vis et agit à partir des ressources de la nature (rizq, na3ima). Reconnaissance d’un seul Dieu qui nous pousse vers le haut par les dynamiques internes à la nature. Ce Dieu est l’origine du mouvement positif d’emergence qui a créé l’univers materiel, fait éclore la vie, nourrit l’intelligence, révélé le sens.
- L’humain ne peut pas se satisfaire des apparences et de l’amour des richesses, mais recherche cette poussée vers le haut de la vie, de l’intelligence. Refus du mondain (dunya) au profit du réel qui tend vers des réalités supérieures.
- L’humain ne doit pas se soumettre à des parties de la nature, ni à des systèmes sociaux, ni a des constructions symboliques. Le ciel des idées doit être nourrit par l’humanité mais pas son maitre. Le refus de l’association c’est le refus de l’humanité de se souemttre à ce qu’elle a construit elle même. Le Dieu monothéiste n’est pas une partie du réel mais un Dieu transcendant, qui nous permet à notre tour de transcender notre réalité. Lire aussi : Réification, aliénation, le capital comme ordre supérieur
- L’humain voyage et se guide par les étoiles, les ruines des civilisations, la nature, les risques de l’avenir, le texte révélé : le ciel des idées permet de s’orienter au delà du mondain, de surnager au dessus de l’experience vécue. Les mots et l’intelligence permettent d’échanger au delà des déterminismes naturels ou sociaux.
- Par la praxis, le travail de l’humanité sur la réalité terrestre et sur elle même, l’humain participe de la réalité naturelle, et essaye de surnager à ses déterminismes. Si l’existence de l’individu est fournie par la réalité sociale, il cherche à la dépasser, la transformer (qui eduque l’educateur ? Labica-Marx-Theses-Feuerbach).
- La dualité sujet-object émerge de la dialectique entre la nature et la société, puis entre la société et l’individu. (IMMANENCE et TRANSCENDANCE Le chemin vers la liberté et l’autodétermination de l’humanité)
- C’est à travers Dieu que l’humanité se met au service d’idéaux supérieur. Un Dieu qui leur donne leur cohérence et leur exigence. L’égalité, la justice, la vérité sont des principes metaphysiques, qui ont des fondements réels, sont révélés par la pratique.
Al Khalifa : la responsabilité sur le monde
- Le Coran donne deux raisons à la création de l’humanité. “Je vais créer sur terre une lieutenance (khalifa)”. L’Humanité est responsable devant Dieu de la vie sur la surface terrestre. “J’ai créé l’humanité pour Me servir”. L’Humanité est au service de cette responsabilité.
- Par cette distance prise, au dessus la réalité, l’humanité essaye de surnager en haut du réel. (Sabi7). L’humanité progressivement devient capable de khalifa sur terre : prendre devant Dieu la responsabilité de la vie et de l’intelligence, accepter d’accomplir le projet de Dieu, l’Islam, le Royaume de Dieu.
- La réalisation de l’humain vient par la réalisation du plan divin : le chemin vers l’autodétermination est le chemin vers une coordination adéquate de l’individu, du groupe, de l’humanité, de la vie sur terre.
- L’émancipation ne peut se faire que par la transformation de la société, de la transformation du rôle collectif au service de la praxis, la réalité de la vie sur terre. CALIFAT ou OUMMA L’Islam comme sujet de l’histoire
- Cette réalisation de l’humain est la poursuite du processus d’hominisation, lorsque l’humanité prend conscience d’elle même, devient son l’objet de sa propre reflexion, et travail volontairement à son progrès. Passer de l’humanité en soi à l’humanité pour soi en prennant la responsabilité consciente du rôle de l’humanité sur la vie terrestre, et de l’appareil de production, qui est la réalité de la praxis, l’action de l’humanité sur la nature et sur lui même.
Salam et Ethique, s’extraire des conflits
- Partage des fruits – Respect de la vie
- Patience, foi et actions salutaires. La patience, la perseverance, est la force de l’ethique. Comme l’eau l’ethique est une force instoppable dans le temps, même si elle parait faible dans l’instant présent. L’ethique est le moyen pour l’individu de transformer le groupe, pour le groupe de changer le rapport de force avec les dominations.
- Les conflits sont une réalité de l’Histoire du monothéisme et de la révélation, qui s’est faite en large part dans la resistance des peuples nomades contre l’oppression des cités états, Babylone, Egypte, Rome, La Mecque.
Une Histoire Révolutionnaire du Monothéisme et une resistance des sociétés bédouines, le communisme primitif.
- Cette resistance produit une resistance culturelle des populations nomades et pastorales. Depuis Abel le nomade contre Cain le fondateur de la premùière ville. Il est possible de siter cette resistance dans une anthropologie anarchiste, comme celle de Pierre Clastre, La-societe-contre-letat.
- A partir de l’hypothèse du religieux de René Girard, il est possible de relire l’histoire du monothéisme selon le materialisme historique et l’anthropologie anarchiste, non pas pour la réduire à du néant comme le font les orientalistes, mais restaurer son sens, en la traduisant en terme modernes.
- Le départ d’Abraham de Ur est d’après le Coran l’acte fondateur du monothéisme. Cette confrontation de nomades araméens avec les cités états correspond assez bien avec la reprise critique de textes mésopotamiens.
- La révolte des hyksos contre les pharaons, puis leur fuite semblent être la version egyptienne, tandis que la Torah raconte une version hébreux avec ses propres reflexions. Les rebelles shasous, apirous (hébreux) contre l’Egypte et les cités états canaanéennes expliquent la sédentarisation posterieure des banu Israel.
- le judéo christianisme contre Rome,en particulier lors des révoltes juives. la guerre de Kitos représente un moment unique de lutte judéo-chrétienne et judéo-arabe contre l’empire romain. d’où emergeront les nazaréens, ebionites, el kasaites, puis plusieurs siècles de resistance arabe (I. Shahid) à l’interieur du christianisme. Le nestorianisme et le jacobisme sont des exemples. L’église ethiopienne semble apporter un cadre important également.
- Le Hilf al Fudhul montre que l’Islam commence dans une resistance des bédouins arabes contre les marchands Quraysh. Face à la destruction du lien social et de l’ethique bédouine par l’imperialisme mecquois qui assujetis ses sujets (mawalis), une resistance sociale à lieu qui précède de 10 ans la révélations du Coran. La révolution interne que l’Islam va créer dans la société mecquoise va initier un grand mouvement qui ira libérer les populations des empires byzantins et sassanides. Omar, les qurra; et la conquête de l’Iraq
- Par l’experience de ces conflits et de la resistance à ces empires, ces bédouins produisent une critique du religieux mystique et autoritaire. Cette critique permet l’élaboration d’une ethique pratique, libératrice, fondée sur un Dieu unique. Comprendre l’histoire du monothéisme comme resistance à l’injustice, permet de comprendre l’élaboration des idéeaux de justice, de partage, de vérité présente dans la révélation.
- Remplacement des conflits mimétiques pour l’appropriation (médiation interne, l’objet du conflit n’est pas partageable) en construisant une communauté dont la finalité est le travail de la Terre (partageable) selon le projet divin (partagé => médiation externe).
- Refléxion sur le rôle du texte religieux et des prophètes dans leurs sociétés. LA FOSSILISATION DU SAVOIR ET LE SCHEME PROPHETIQUE
Réalisation de l’humain
« Lève ta face vers la religion en hanif, la conception de Dieu selon laquelle il a conçu l’humain »
- La pratique du système éthico-pratique du Coran force l’individu au travail sur lui-même, jihad al nafs. Lui sont révélés par cette pratique des mécanismes internes et sociaux, qu’il transforme. Début d’une certaine objectivité par le respect de soi, respect de l’autre, respect de la nature. La Taqwa: le respect de l’engagement. Réponse à Rachid Benzine : Trois découpages possibles
- Les limites naturelles, testées et validées par le jeûne, sont prises en compte, et révèlent la possibilité d’une certaine volonté propre, indépendantes des besoins naturels. Agir par et pour soi. Les liens sociaux sont révélés également par : les interdits alimentaires (séparation de soi du groupe), le sabbat (séparation de soi de la production), la zakat (compréhension de l’autre et confrontation avec les problèmes du groupe social).
La oumma, résolution du conflit entre le groupe et l’individu
- Découverte des limites de l’affranchissement solitaire de soi : les autres, l’ordre social. La normalité quotidienne. Nécessité d’une action collective.
- Problème de la confrontation du groupe social par la mise en évidence de la vérité, la révélation du fonctionnement social dans ses effets réels.
- Confrontation entre l’idéologie d’une société et le constat objectif expérimenté par les individus opprimés ou en marge.
- La critique prophétique révèle les catastrophes à venir (1984, soleil vert, …) préparées par le comportement d’une société. L’exemple de Noé qui annonce la destruction prévisibles par des signes : un typhon. Et la resistance de la société à tout changement, son impossibilité à voir le réel.
- Mise en branle d’un groupe minoritaire par une pratique commune visant à transformer le groupe large : la oumma.
- Transformer le monde réel par des pratiques dont la visée est en même temps émancipation de l’individu, la formation du collectif, la réalisation du projet. La fin se trouve dans les moyens mis en œuvre.
- Constituer une communauté dont l’intérêt permette la généricité du groupe humain, visant la place adéquate de l’humanité entre Dieu et Nature.
- L’Islam fournit un système ethico pratique à l’échelle individuelle plutot qu’une réflexion sur le collectif. Pourtant la réalisation individuel de ce système semble générer des effets collectifs et la constitution d’un groupe, de sorte que le religieux semble toujours une pratique collective,
- synago, ekklesia, jama’ signifient tous rassembler le groupe dans un lieu commun.
- De fait la réduction du religieux à une pratique individuelle et son interdiction dans l’epace publique revient à le rendre inopérant, et à substituer l’état comme absolu à la place des valeurs humaines construites dans le ciel des idées.
- CALIFAT ou OUMMA L’Islam comme sujet de l’histoire
Les différentes rubriques du site :
- Etude du Coran : relire à l’aide de la rhétorique sémitique, pour pouvoir en dégager le sens premier, au plus près du texte, presque au corps à corps, pour donner le serieux de l’analyse. Nous ne tombons pas dans le piège d’une relecture idéologique, mais voulons montrons l’importance du Coran et des textes bibliques dans l’élaboration d’une resistance idéologiques, en prticulier contre l’orientalisme. L’approche du religieux de René Girard nous aide à en sortir une histoire évolutive du monothéisme, dont l’aboutissement est l’Islam.
- Histoire du monothéisme : relecture de l’histoire du monothéisme pour comprendre d’où a surgit le texte. Le mettre en contexte pour comprendre sa portée.
- Schème Prophétique : s’interroger sur la nature du texte saint et du rôle particulier jouer par les prophètes dans leurs sociétés.
- L’Autre Révolution : partir à la recherche des mouvements sociaux et des penseurs qui portent à la fois révolution et monothéisme, dans toutes les traditions.
- Vers une philosophie monothéiste : traduire l’Islam en termes philosophiques modernes, pour voir quels sont les apports aujourd’hui, et pouvoir éviter les anacrhonismes et les jugements de valeurs.
Contact :
Vous souhaitez participer, proposer des articles : contact at collectif-attariq.net