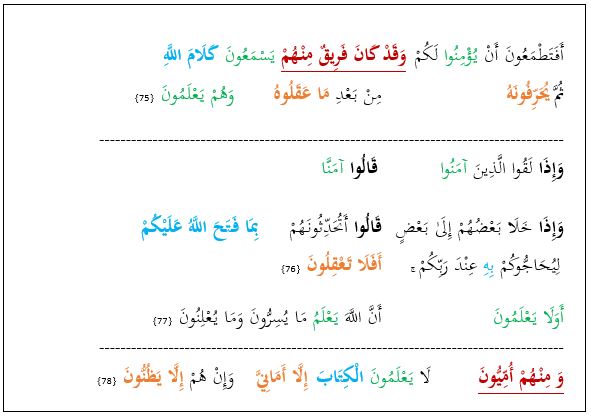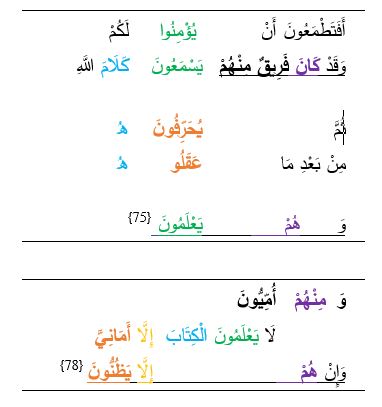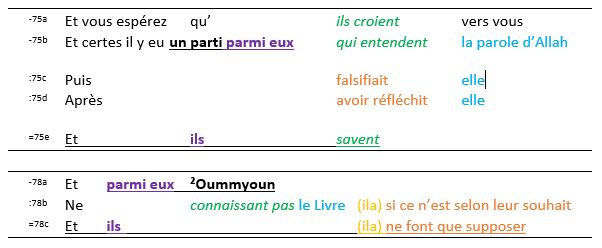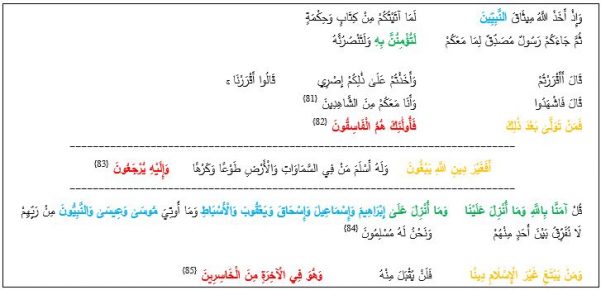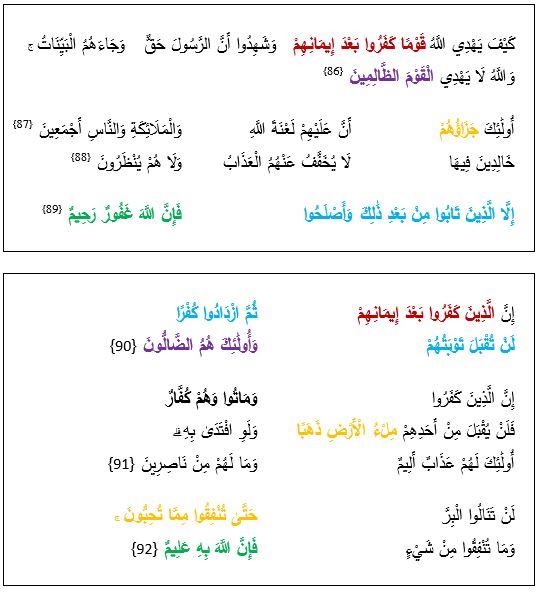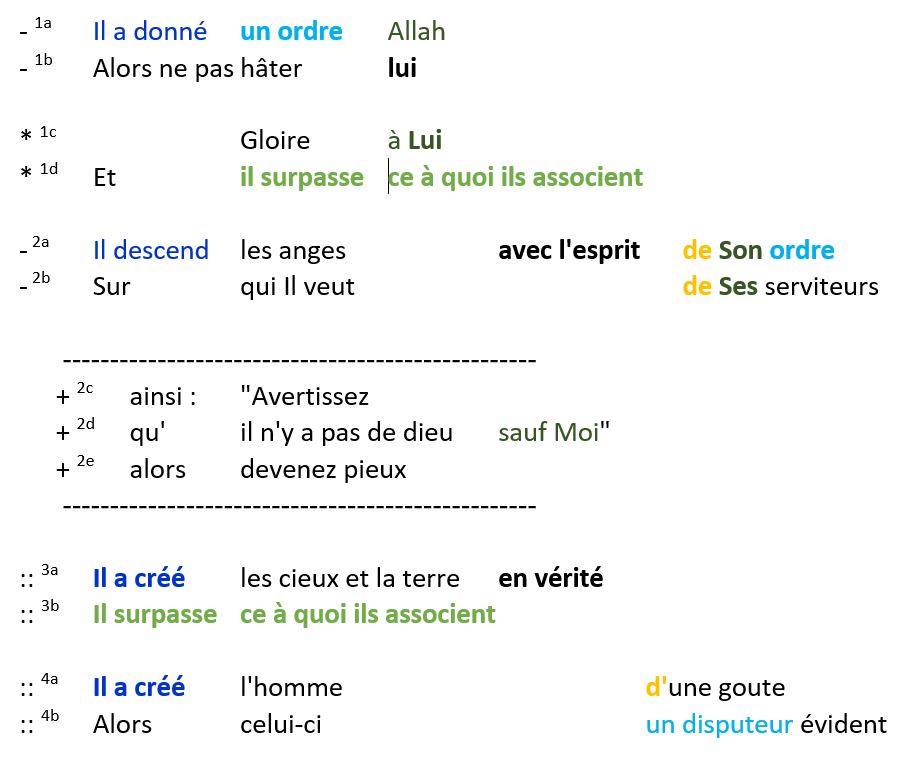Archives de catégorie : Rhétorique Sémitique
Intertextualité du passage 33-44 de la sourate Yasin
Structure du passage 33-44 :

Le texte de Lactance dont il est question http://remacle.org/bloodwolf/eglise/lactance/instit2.htm
Geneviève Gobillot cite Lactance comme « un premier seuil herméneutique », participant d’« un paysage conceptuel, sur lequel ses propres enseignements [nb : du Coran] prennent un relief qui en éclaire la plupart du temps de façon décisive les tenants et les aboutissants. »[1] Dans le cinquième chapitre du second livre des « Institutions divines » [2], nous remarquons un même triptyque terre / astres / mer que les psaumes et notre passage. Puis exactement les termes de la partie centrale : les astres, le jour et la nuit, et le décret divin : « Dieu a placé les astres dans le ciel, et leur a assigné la route qu’ils tiennent » et pour finir « il fait succéder tour à tour le jour à la nuit, dont l’un est destiné au travail et l’autre au repos ». Les thèmes des deux propositions de cette dernière sont repris tels quels dans le Coran[3]. Comme les Psaumes, desquels il reprend peut-être les exemples, Lactance insiste sur le statut créé des choses : contra des choses existantes par elles-mêmes, il parle d’ouvrier et d’ouvrage. En particulier les objets célestes sur lesquels il appuie sa démonstration.
La question porte essentiellement sur leur mouvement et sur leur utilité pour l’homme. Pour les stoïciens ceux-ci sont preuve d’une volonté intrinsèque, si les choses sont réglées et qu’elles deviennent utiles, elles ont une intelligence. Ils concluent en conséquence à la divinité des objets celestes. Partant du principe d’une divinité unique, Lactance reproche aux stoïciens d’observer les choses sans concevoir leur origine. Il oppose les animaux, qui ont également une volonté. Et leur réfute immédiatement le statut animal : pour lui l’intelligence n’a résidé que dans le déploiement des astres. Sur le modèle d’Archimède construisant ses représentations du système solaire, il explique le mouvement et l’utilité par l’ordre divin qui aurait créé puis ordonnancé les objets celestes dès le départ. A finalité de l’homme. Deux modèles sont donc proposés. Le premier est la divinité des objets celestes, qui déciderait d’eux-mêmes leurs actions et effets, le second celle d’une divinité ayant organisé l’ensemble. Lactance trace ainsi un lien qui part de l’origine de toute chose vers la vie humaine. C’est un raisonnement à visé éthologique, d’explication des phénomènes, mais dont la réponse est donnée a priori : quand Lactance dit « le mouvement des astres n’est donc pas volontaire, mais nécessaire, parce qu’ils suivent la loi qui leur est imposée », c’est une tautologie : la conclusion est elle-même la preuve.
Le texte coranique n’est pas une simple louange dithyrambique comme les Psaumes. Il propose comme Lactance une réflexion sur les rapports entre les astres et leurs effets, et en propose une réarticulation, portée par la structure du texte. La première partie de notre passage part de la « terre morte », ce qui exclut d’emblée d’en faire une divinité. Dieu la fait vivre et en fait sortir des fruits : la vie devient un mouvement, conséquence d’une impulsion première. Si l’impulsion est divine, le mouvement est aussi le fait de la terre elle-même (parallèle frappant entre 33c « Nous avons sorti d’elle du grain » et 36b « ce que fait pousser la terre »). Ce mouvement produit les fruits dont mangent les hommes. Il y a alors une volonté précise de Dieu vers l’homme, dont le travail suivra (35c « de ce qu’a fait ses mains »), prolongation par l’homme du travail divin, reçu de la nature[4]. L’interjection “Ne remercia-t-il pas ?” suit directement ce prolongement, en ce que l’homme hérite, jusque dans son travail, d’un résultat qui ne vient pas de lui-même. D’où probablement l’ambivalence laissée entre deux sens possibles : qu’il mange « de ce qu’a fait ses mains » ou « de ce que n’a pas fait ses mains ». Le texte loue alors Dieu comme origine de tout ce mouvement qui précède l’action humaine. Pour le Coran, il n’y a pas de divinité dans les choses mortes, ni dans le fruit produit de la nature, mais un Dieu à l’origine du mouvement qui va de la terre morte jusqu’au fruit qui nourrit l’homme.
Le texte reprend ensuite l’alternance du jour et de la nuit. Le mouvement des astres, origine de cet effet est traitée dans le morceau central, avec les phases de la lune, autre exemple de la nuit. Au cœur de ce morceau et de tout le passage, le rôle divin dans la mise en œuvre du mouvement, dont le reste est conséquence. Enfin dans le dernier morceau, l’effet (le jour et la nuit) et la cause (les astres) tournoient dans un même mouvement d’ensemble, ramené au terme SBH signifiant également voguer et louange, rappelant la gloire du créateur du morceau précédent. A l’opposé de Lactance, le Coran ne cherche pas à donner un cours d’astronomie, en effet, il est tout à fait possible de lire une vision égyptienne primaire des astres dans des chaloupes (foulk) et d’un lever du soleil en un point précis de l’horizon, comme il est possible pour un moderne d’y lire des orbites différentes, qui ne se croisent pas. Le propos n’est pas là. Ce qui est remarquable c’est l’articulation partant des effets observés par l’homme (l’obscurité de la nuit) aux extrémités de la structure, pour remonter progressivement par le mouvement des astres à leur cause première, le décret divin comme actus primus au centre. Pour revenir finalement à l’articulation de l’ensemble, louange des mouvements de l’univers à leur créateur (SBH), à l’opposé de l’obscurité première, image du rejet du prophète[5].
Dans la troisième partie, le Coran reprend de Lactance l’exemple de l’homme appelant au secours dans la tempête[6], mélangé ici avec l’histoire de Noé. L’irruption de la possibilité de la mort et du déluge met en valeur le support divin constant à la vie humaine matérialisé par le bateau (reprise de foulk), que l’homme ici aussi prend en charge à son tour. En proposant la possibilité de son inversion, « si Nous voulons, Nous vous noyons », le texte montre encore une téléologie divine dirigée vers l’homme, rappelant, par sa menace planant sur les sociétés humaines, thème récurrent de la sourate, l’importance de la branche sur laquelle il est assis.
Le Coran reprend les enjeux évoqués dans les institutions divines. Pour expliquer les mouvements célestes et leurs effets, jusqu’à la vie qui sort de terre, le texte opère une synthèse entre les positions de Lucilius et Lactance. Comme chez Lactance, l’objet est dépourvu de toute divinité, cependant, le texte ne part pas d’une existence de Dieu a priori qui suffirait à expliquer l’inexplicable. Le Coran reprend la quête de Lucilius, mais propose une autre démarche : comme pour Abraham s’interrogeant sur la divinité des étoiles, les choses ne sont pas des divinités en elle-même, la divinité ne peut en être que leur origine[7]. Dieu c’est Le Créateur des astres pour Abraham, et ici l’origine de leur mise en mouvement. Le Coran part des effets (l’alternance du jours et de la nuit), remonte aux cause (les mouvements des astres). Toute divinité ou téléologie est alors repoussée hors de l’univers réel jusqu’à l’actus primus, décret de Dieu. Celui-ci poursuit pourtant son action par l’émergence continue de la vie, action allégorisée ailleurs dans le texte par la descente de l’eau[8]. Cette théologie, toujours anthropocentrique, est néanmoins plus fine en ce qu’elle n’articule plus grossièrement le monde vers l’homme, mais reprend comme chez le philosophe, la remontée déductive des phénomènes observé par l’homme, qu’elle repousse à une cause première. Le texte coranique enfin la superpose à une éthique : il y a pour l’homme dans l’observation des phénomènes naturels une invitation à remercier pour ce qu’il a reçu de la nature et, ayant trouvé Dieu comme origine de toute chose, à prolonger le travail, tout en s’inquiétant des conséquences de son comportement. Le texte coranique propose un monothéisme strict articulant l’observation des phénomènes naturels à la constitution d’une éthique. Renvoyant discrètement aux thèmes de la sourate, la réception du messager, le partage des richesses reçues de la nature et la possibilité d’une fin terrible.
[1] G. Gobillot, « Des textes Pseudo Clementins à la mystique Juive des premiers siècles et du Sinaï à Ma’rib », dans Carlos A.Segovia et Basil Lourié (éds), « The Coming of the Comforter:When, Where, and to Whom ? », Gorgias Press, 2012, p.8 sqq.
[2] Lactance, rhéteur latin, mort en 325. Une édition bilingue latin français des Institutions divines est disponible sur http://remacle.org/bloodwolf/eglise/lactance/instit2.htm (second livre)
[3] Par exemple Ya sin v.37, al-Naba v.9-10.
[4] L’idée absente du second livre de Lactance, se trouve peut-être déjà dans la Genèse : « 1,15 L’Éternel Dieu prit donc l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden, pour le cultiver et pour le garder. »
[5] Voir par exemple Cor 33 :41-46 qui pose le prophète comme une lampe éclairante, sirājan munīran. Et la discussion sur l’utilisation de la lumière pour l’homme dans un cadre monothéiste par Emran El-Badawi, The Qur’an and the Aramaic Gospel Traditions, New York; London: Routledge Press, 2013; p. 154-157.
[6] Citons ici G. Gobillot qui retrouve les notions communes à Lactance et au Coran de cet exemple : « Coran 17, 67 : « Quand un malheur vous touche en mer, ceux que vous invoquez s’égarent, sauf lui » à mettre en parallèle avec (Institutions Divines, II, I, 8–12) : « Cela (reconnaître et proclamer un dieu suprême) ils ne le font pas quand leur situation est prospère ; mais pour peu que quelque pesante difficulté les accable, les voilà qui se souviennent de Dieu. Si quelqu’un, en mer, est ballotté par un vent furieux, c’est lui (Dieu) qu’il invoque ». A ce propos le Coran, comme les Institutions Divines, met en garde contre une autre tendance spontanée de la nature humaine : la faculté d’oublier : « Lorsqu’il (Dieu) vous a sauvés et ramenés à terre, vous vous détournez. L’homme est très ingrat » Quant à Dieu, qu’ils avaient imploré au milieu de leurs besoins, ils n’ont même pas une parole pour le remercier ». » G. Gobillot, op.cit. p. 6.
[7] Coran 6:75-81. En particulier le saut théorique, non expliqué, fait par Abraham dans le verset 79 : « Je désavoue ce que vous associez à Dieu et je tourne mon visage en croyant originel vers Celui qui a créé les cieux et la terre ».
[8] Par exemple Coran 16:10-11 : « C’est Lui qui, du ciel, a fait descendre de l’eau qui vous sert de boisson et grâce à la quelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D’elle, Il fait pousser pour vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. »
Hanifan – Partie 1
Première partie :
Al Baqarah et Al Imran
Téléchargement en PDF ci dessous. Merci de mentionner l’adresse du site.
Les termes Hanifan et Oummyyin dans leur contexte
Nous suivrons volontairement l’ordre du Livre et étudierons d’abord le contexte conjoint de deux occurrences dans la sourate Al Baqarah, puis un court passage de la sourate Al Imran, avant d’étudier toute une séquence de cette dernière contenant les 3 dernières occurrences. Le contexte reste tout au long de cette partie celui du débat avec les peuples du Livre, et nous retrouverons des thèmes récurrents, reformulés plusieurs fois, selon le style particulier du Coran.
2:135 قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
3:67 مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
3:95 قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
Avec
2:78 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ
3:20 وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ
3:75 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ
Sourate Al Baqarah
(2:78) ummiyyūna
La première occurrence du terme, dans la Sourate Al-Baqara. Nous présentons ici l’analyse de la partie auquel il appartient. Nous reviendrons dans la quatrième partie sur le parallèle de cette occurrence avec celle de la sourate Al Jum’ua.
Nous avons là une partie qui traite des rapports
des rapports d’un groupe avec l’écriture[1],
rapport principalement articulé par les verbes croire et savoir. Cette partie
est divisée en trois morceaux, de façon concentrique. Le morceau central (à
l’intérieur de la sous-partie centrale) exprime la méfiance du groupe[2] à partager avec
les musulmans leur connaissance de l’écriture, qu’ils craignent être retournée
contre eux par la suite. Sa construction (« quand ils rencontrent
… ») rappelle le même schéma au début de la sourate. Les morceaux externes
divisent le groupe en deux ensembles distincts, selon leur stratégie pour
éviter de reconnaitre le prophète : le premier morceau traite « d’un
parti parmi eux » qui connaissent l’écriture mais la déforment, le
dernier pose le reste opposé : « parmi eux ²Oummyouna » qui
n’en ont qu’une connaissance approximative, qui plus est déformée par leur désir,
qui imaginent l’Ecriture sans la connaitre.
[1]
Il faudrait attendre l’analyse complète de la sourate pour avoir plus de
visibilité sur le groupe mentionné ici par le pronom « eux ». Les
fils d’Israël sont le sujet de ce qui précède, il pourrait donc s’agir des
juifs de l’époque du prophète, ou bien de l’ensemble des gens du livre qui ne
reconnaissent pas le prophète, le groupe serait alors un ensemble opposé à ceux
mentionnés dans le verset 62.
On observe que les deux morceaux externes sont
construits de manière semblable, bien que le premier soit plus développé :
les trois segments du premier correspondent aux trois membres du second :
75a-b et 78a déterminent deux groupes « parmi eux », 75c-d et 78b
déterminent le rapport de chaque groupe à l’Ecriture, 75e et 78c marquent la
différence entre les deux : les uns savent, les autres ne font que
supposer. Le texte présente deux groupes du même ensemble dans deux morceaux
d’une construction semblable. Cela permet au lecteur (ou à l’écoutant) de
pouvoir faire le lien entre les deux groupes, malgré la digression centrale qui
explique l’enjeu, et de saisir intuitivement le lien entre les deux (un rapport
problématique au texte) et la différence constitutive (la falsification ou
l’ignorance).
La construction rhétorique, forme complexe de
syntaxe, permet ici la construction d’un système descriptif. Les 3 groupes de
la structure, révélés par le parallélisme, construisent une présentation
précise et ordonnée du propos. A la lecture, ils vont nous aider à mieux
préciser le réseau sémantique qui encadre le terme qui nous intéresse. Dans le
cadre restreint de cette partie, le terme « ²Oummyoun » est pris dans
deux symétries, à l’intérieur de son morceau et entre les deux morceaux
descriptifs.
Le premier entre les deux membres 78a et 78b :
la caractéristique de « ²Oummyoun » est de « ne pas connaitre le
livre ». C’est partiellement cohérent avec l’interprétation
traditionnelle du sens comme « ignorants », mais rapportée spécifiquement
à une ignorance religieuse : celle du livre de la parole divine. En
l’occurrence ignorance de la Bible, ou peut-être simplement de la Torah qui est
nommée un peu plus haut dans la sourate.
L’autre parallèle est celui entre les morceaux,
plus précisément entre les membres 75a-b et 78a qui présentent les deux
ensembles au sein du groupe qui refuse « la parole d’Allah ».
L’ensemble et les partis sont indiqués par l’expression « parmi eux ».
D’abord « un parti parmi eux », singulier qui détermine un
groupe constitué, ceux qui connaissent la parole. A l’opposé, le pluriel de
« parmi eux ²Oummyoun », ensemble plus large, caractérisés par
l’ignorance du Livre. A l’opposé d’un « parti » bien
déterminé, il y a des individus, ou des groupes d’individus. « Ignorants »,
dans le sens « ignorants du Livre » est toujours possible. Mais on
peut s’interroger sur le lien possible entre « faryqoun » et
« ²Oummyoun », d’autant plus qu’il y a un lien possible entre « parti »
et la racine « ²M », autour du sens de communauté. Existe-t-il un
sens commun à « ignorant » et « communauté »
qui puisse définir « ²Oummyoun » ? Qui donnerait à peu
près : « les communautés qui ignorent le livre » ?
M. Hamidullah propose de reprendre pour
l’occurrence suivante (3.20) le terme de « gentils », qui
traduit dans la Bible, ceux qui ne sont pas juifs. Il fait sens ici dans les
deux parallèles : « il y a un parti parmi eux qui entendent la
parole d’Allah puis la falsifient (…) et parmi eux des gentils, qui ne
connaissent pas Le Livre si ce n’est selon leur souhait ». Cette
distinction parmi ceux qui rejettent le prophète entre ceux qui falsifient et
ceux qui imaginent, opère une distinction critique précise entre plusieurs
groupes : les juifs qui falsifient la Torah et les chrétiens qui
l’ignorent ; parmi les chrétiens entre ceux qui suivent la Torah et les
chrétiens « de Paul » parmi les nations qui ne connaissent pas ou
prou l’Ancien Testament. Les deux sens, ignorants et gentils, sont possibles
ici et rentrent dans le contexte. Cependant l’utilisation du terme gentil est
plus précise et montrerait une distinction fine opérée par le Coran parmi les
gens du livre selon leur rapport au texte biblique. Nous garderons comme
première approximation l’appellation « gentils », pour ceux qui ne
connaissent pas le Livre.
Contexte de la sourate Al Baqarah, entre 2.75 (²oummyyin)
et 2.135 (ḥanifan).
Nous n’allons pas dérouler ici toute l’analyse
rhétorique du contexte des deux termes, comme nous le ferons plus bas pour la
sourate al Imran, où trois occurrences des deux termes sont pris ensembles dans
une même séquence. Nous tenons cependant à noter que le contexte de ces termes
est dès le début celui du débat avec les peuples du Livre, une critique de la
religion. Nous invitons le lecteur à lire tout ce passage de son côté à
l’occasion, pour bien saisir ce qui est déployé dans la sourate al Baqarah en termes
de contenu et dont des aspects seront repris ou détaillés par la suite. Nous
tenons cependant à noter quelques versets qui résonnent particulièrement avec
notre étude, notamment avec l’analyse qui suit de la sourate al Imran. La traduction
est celle de M. Hamidullah, sauf pour les termes en gras.
Il y a d’abord la réfutation de la prétention du
peuple à Livre à avoir l’exclusivité du salut : « 94 Dis : « Si
l’Ultime demeure auprès d’Allah est pour vous seuls, à l’exclusion des autres
gens, souhaitez donc la mort si vous êtes véridiques ! ». (…) 111 Et ils ont
dit : « Nul n’entrera au Paradis que Juifs ou Chrétiens ». » Prétention
à laquelle le Coran répond que le salut est en Dieu uniquement, donc pour tous
ceux qui se dirigent vers Lui : « 112 Non, mais quiconque
dirige sa face vers Allah (أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ) tout en faisant le
bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et
ils ne seront point attristés. »
Le même raisonnement est appliqué à l’écriture,
quand les peuples du Livre refusent la possibilité d’un messager envoyé à d’autres
peuples (100, 105), alors qu’eux-mêmes se détruisent entre eux, empêchent de
prononcer Son Nom et détruisent les lieux de culte (113, 114). Encore une fois,
Dieu est donné comme seule direction et source de salut : « 105 Allah
réserve à qui Il veut sa Miséricorde », ainsi que dans le verset 115,
qui conclut le sujet : « 115 A Allah seul appartiennent l’Est et
l’Ouest. Où que vous vous tourniez, la Face d’Allah est donc là, car Allah a la
grâce immense ; Il est Omniscient. » Même raisonnement encore en
119-120, dont la solution est le texte envoyé par Dieu, pour ceux qui le
récitent : « 121 Ceux à qui Nous avons donné le Livre, qui
le récitent
(تَلَىٰ) comme il se doit,
ceux-là y croient. Et ceux qui n’y croient pas sont les perdants. ». Notons
déjà que « تَلَىٰ » induit une retranscription dans le réel
d’une parole de Dieu.
Raymond Farrin propose une composition de la
sourate Al Baqarah en 7 sections concentriques, nos occurrences se trouveraient
dans deux sections qui répondent aux argumentations des juifs et des
chrétiens : B (40-112) relative à l’histoire fils d’Israël et C (113-141)
à celle d’Abraham. Elles prépareraient des séquences semblables adressées aux
musulmans, C’ (153-177) qui prépare le pèlerinage à la Mecque et B’ (178,242)
la loi délivrée aux musulmans. Au centre se trouverait la nouvelle Qibla comme
test de foi et aux extrémités une confrontation avec les dénégateurs[1]. Malheureusement
il ne fournit pas le détail structurel de ses compostions, semblant faire un
découpage thématique. Cependant pour la séquence C, dont nous détaillons
ci-dessous les deux tiers d’une séquence, nous tombons sur le même découpage.
Nous étudierons le passage 124-129, l’élévation de la maison par Abraham et
Ismaël, ce qu’il appelle le cercle central de C. Et le passage 131-141,
argumentation avec les juifs et les chrétiens, qui est pour lui le dernier
cercle de C, et donc nous trouvons le même centre : l’appel des musulmans
à suivre tous les prophètes.
Il note que la partie B critique la prétention des
fils d’Israël à un traitement spécial, car « les transgresseurs parmi eux
seront jugés comme les autres transgresseurs », tandis que « ceux qui
croient et font les œuvres salutaires, incluant les juifs les chrétiens et les
sabéens, n’auront rien à craindre. (v.62, comparer avec 82). Ici dans deux
places centrales, le Coran parle d’égalité et de pluralisme religieux. » Nous
pensons comme lui que le Coran critique entre autres la préférence
communautaire et institue un jugement individuel, juste, selon les actions de
chacun.
2.135 « Ḥanifan »
Nous présentons de ce fait l’étude du passage
124-129 ainsi que celle du passage 130-141. Deux passages sur Abraham, quand il
érige la maison avec Ismaël. Le second aurait suffi pour la simple occurrence
de « ḥanifan ». Cependant nous reviendrons par la suite sur les
thématiques développées dans 124-129, et il convient de les étudier in situ.
Nous demanderons au lecteur de bien garder en mémoire le vocabulaire, en
particulier celui du verset 125 « Quand nous fîmes de la maison
(الْبَيْتَ) un héritage[2]
(مَثَابَةً) pour les humains (لِلنَّاسِ) et une sûreté (أَمْنًا). Adoptez la position (مَقَامِ) d’Abraham, un lieu de prière. »
[1]
Les défiant à proposer soit une sourate semblable au Coran soit à changer le
lever du Soleil, semblant s’accorder avec l’allégorie de la prophétie comme
lumière, cf Emran El Badawe, ,p.
[2]
Littéralement un lieu en récompense. Même racine qu’en 2.103 : « Et s’ils
croyaient et vivaient en piété, une récompense (لَمَثُوبَةٌ) de la part d’Allah serait
certes meilleure. Si seulement ils savaient ! » La maison d’Abraham,
récompense pour les humains fait ici penser à la terre promise, redéfinie, ou
remplacée, peut-être déplacée. Nous reverrons plus en détail dans la sourate Al
Imran le lien entre la maison, Ismaël et l’alliance. Un « lieu en
récompense » pour les hommes semble annoncer le « mafazan » de
la sourate Al Naba.
Passage 124-129 (Le centre de C pour Raymond Farrin)
Partie 1
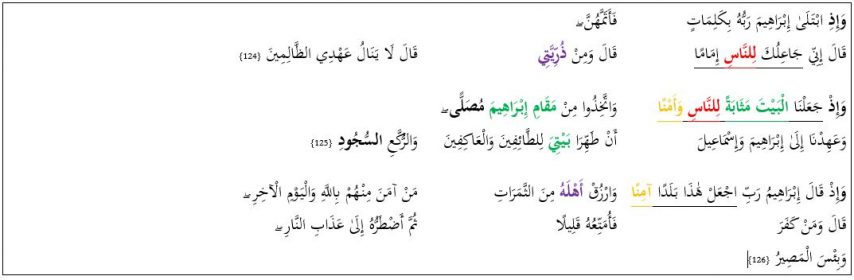
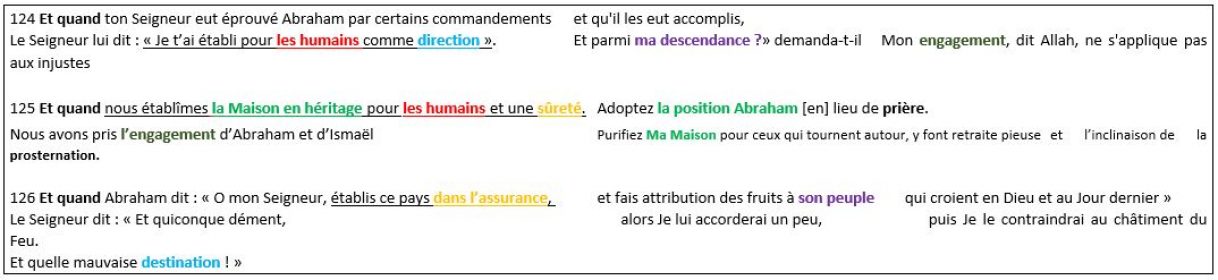
Précédent
Suivant
La partie est composée de 3 morceaux commençant par
« Et quand ». Dans les trois Allah établi quelque chose,
Abraham comme guide, devancier pour les humains, la maison comme « lieu
en récompense » pour les humains, et à travers la demande d’Abraham, ce
pays (celui de la maison) comme lieu de sûreté[1]
pour ceux qui l’habitent. Dans les deux parties externes, quand Abraham demande
des bienfaits pour sa descendance, puis pour le peuple du pays, Dieu en exclut
les injustes. De plus dans ses interventions Dieu agit pour tous les humains (لِلنَّاسِ). Cette double correction divine s’adresse
à travers Abraham à toutes les parties : aux peuples du livre dans leurs
prétentions à détenir le salut (الظَّالِمِينَ, en 124, reprise du V. 95) et pour la même
raison aux musulmans à venir. Elle abolie en général la notion de préférence,
d’un héritage spirituel qui soit filial. Dans le dernier morceau, Abraham corrige
son discours sa « descendance » devient « peuple » du pays
(par un terme désignant aussi la famille).
Dans le morceau central, la « posture » d’Abraham devient « Ma
maison », celle de Dieu, un lieu de prière et de rassemblement pour les
pèlerins. C’est un lieu destiné à recevoir sa nourriture des hommes, par
l’intermédiaire du pèlerinage. La notion de « récompense » (مَثَابَةً) , associée aux fruits et au jour dernier
semble faire de cette destination une préfiguration du paradis, à l’opposé du
« châtiment du feu » dans le dernier segment. La position d’Abraham
est une direction, physique et morale, qui prépare la qibla. Et lieu d’arrivée
du pèlerinage. A travers l’image du désert et de l’oasis dans laquelle Abraham
établira Haggar et Ismaël, on trouve l’établissement d’une direction pour
l’humanité (Abraham comme modèle), et l’alliance avec Dieu, dans le Coran
l’engagement (عَهْدِ), dont la finalité est un pays … et son
peuple. Dans un contexte de débat argumenté avec le peuple du Livre, cette
partie s’appuie sur Abraham comme figure commune, qui établit dans leur
fondement matériels et spirituels le pèlerinage et la qibla vers « la
maison ». L’ « engagement » entre Dieu et Abraham, le
« pays sûr » et « son peuple », qui comme la terre promise préfigurent
le paradis.
[1]
Qui introduit à son tour le refuge, « maban » de la sourate Al Naba.
Partie 2
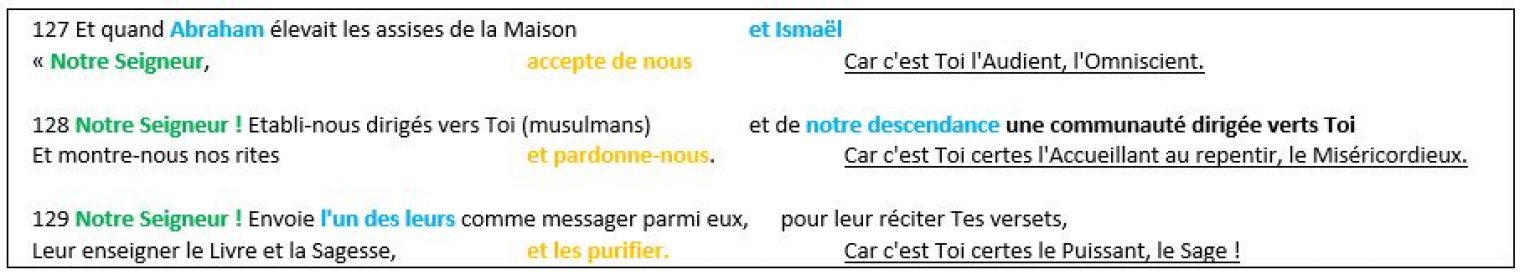

Précédent
Suivant
La seconde partie est fait de trois morceaux
réguliers, construits chacun de deux segments de deux et trois membres. Le
discours est celui d’Abraham et d’Ismaël (pourquoi est-il mis en fin de
phrase ?) et adressé à Dieu. « Notre Seigneur » introduit
les deux derniers morceaux et le deuxième segment du premier. Chacun des trois
morceaux se termine sur demande d’Abraham et sa reconnaissance de Dieu, marquée
par deux noms divins, toujours différents. La partie qui commence par
« Quand Abraham éleva les fondations de la maison », devient une
supplique pour que Dieu fasse de la descendance d’Abraham une communauté
dirigée vers Dieu. A laquelle il pardonnera et enverra un messager. A l’idée de
maison est à nouveau associée ceux qui y vivront. A tel point qu’on peut se
demander si Abraham n’élève[1]
pas en parallèle les fondations de la maison … et Ismaël. La remarque d’Allah
dans la partie précédente (« Mon engagement, dit Allah, ne s’applique pas
aux injustes ») produit chez Abraham une préoccupation de l’éducation de
sa descendance à venir, dont la demande à Dieu sonne comme une annonce du
prophète Muhammad. Le prophète est ainsi présenté comme le moyen de prolonger
l’engagement entre Allah et les justes de la maison d’Abraham et Ismaël, selon
la demande d’Abraham.
[1]
Le mot élève (يَرْفَعُ) est très fort. Il s’agit uniquement
d’Allah qui élève le mont sur Moïse, Jésus lui-même, et le souvenir de
Muhammad. Doit être noté que c’est ici Abraham, et pas Dieu, qui élève la
maison. La demande : Seigneur accepte (avance) de nous prend son sens dans
le parallèle avec le verbe élever du segment précédent.
Passage 130-141 (Le dernier de C pour Raymond Farrin)
Partie 1
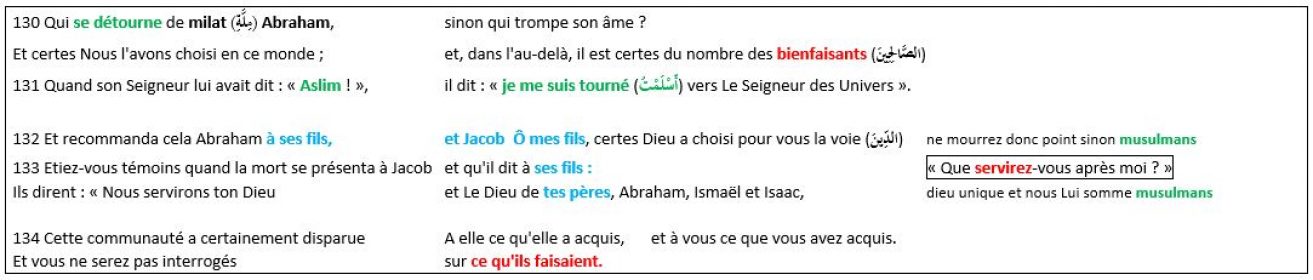
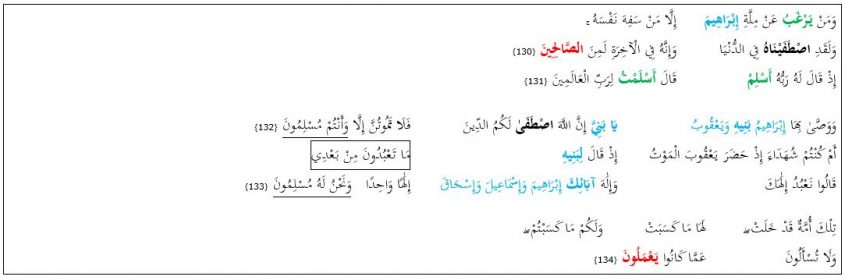
Précédent
Suivant
Cette partie est composée de trois
morceaux. Les deux morceaux externes posent à travers l’au-delà la question des
actions. Le morceau central pose celle de la transmission de l’Islam, qui est
définie ici comme la voie suivie par Abraham. Si Dieu juge chaque individu
(« qui ? ») alors il importe de bien transmettre et de s’assurer
de ses fils ! La question centrale « Que servirez-vous après
moi ? » pose la question de la continuité après Abraham.
L’interrogation pose la question du choix personnel et de sa réalisation
concrète (« servir »). Si l’homme revient aussitôt à la notion
familiale au centre, Dieu brise l’idée d’une continuité entre les différentes
communautés dans le dernier morceau. C’est donc le modèle d’Abraham plus que la
descendance (que l’on engage fortement à suivre) qui est mis en avant.
Nous distinguons trois termes
désignant la religion, (مِلَّةِ, أَسْلِمْ, الدِّينَ), milat, Islam et dyn. Comme remarqué par
Cyril Moreno, ici « Aslim ! » (أَسْلِمْ) ou « aslamet » (أَسْلَمْتُ) sont des verbes, Islam serait religion au
sens d’une action, qui consiste à se tourner vers Dieu. Le terme dyn
signifierait de son côté religion au sens large, une « voie » suivie
par l’homme. Ainsi l’Islam serait la voie particulière qui mène vers Dieu. Cela
fait sens en contexte, et nous y reviendront plus loin, à propos de 3.20. Nous
avons ici un premier contexte ici qui permet d’encadrer milat (مِلَّةِ) :
–
Au niveau du segment, « se détourner de
milat Abraham », c’est « tromper son âme ». Ainsi « milah »
a à voir avec ce qu’il se passe dans l’âme, au niveau des choix conscients, des
directions prises.
–
Au niveau du morceau, il y a aux extrémités l’idée
de direction, avec l’opposition entre « se détourner de milat
Abraham » ou « se tourner vers Dieu ». Milat Abraham est ainsi
liée à « Islam », au sens de tourné vers Dieu.
–
Au niveau du morceau encore, à l’extérieur on
trouve « milah » la religion, et au centre « bienfaisant »,
qui concerne les actions. Or le terme qui complète « les œuvres salutaires »
est habituellement « Iman », la foi (par exemple dans Al Asr). Milat
Abraham serait un sens proche de « la foi » d’Abraham.
–
On observe aussi dans le parallèle entre les
morceaux externes une relation avec le verset 134, ce qu’on a acquis. Au
pluriel en 134 (« une communauté »), au singulier en 130 (« qui ? »,
« Abraham »). « Milat Abraham » ou « tromper son
âme » pourrait être inclus avec les actions (« bienfaisant »)
dans l’acquis, le construit, par chaque âme, ou chaque communauté.[1] « Acquis »
suppose un vécu, une histoire, une construction, telle que l’histoire des
réflexions d’Abraham développée par le Coran.
Ainsi « milah » serait
dans l’âme quelque chose de l’ordre de la foi, construit progressivement par
Abraham, et qui l’amènerait vers Dieu. La partie théorique qui accompagne ses
actes (bienfaisant).
A. Jeffery propose le mot dans la
liste de ses « emprunts ». « Milah » est un terme présent
dans d’autres langues sémites, désignant « les mots », et dans un
second temps la religion. Effectivement, nous avons retrouvé des parallèles
intéressants. L’hébreu « מל », «
mot », donne (מלה, les mots, le discours), mais aussi (מלל, parler, écouter), (מלא, remplir, les premiers fruits) et étonnamment
(מולה, la circoncision, telle qu’établie avec
Abraham et sur laquelle nous reviendrons). En syriaque, nous avons également (ܡܸܠܵܐ mots, verbe, discours, remplir, parfaire)
qui peut aussi vouloir dire religion, doctrine, mais aussi « mlt », mot
d’origine arabe, turque, kurde (ܡܸܠܲܬ, un peuple, une minorité ethnique). Jeffery
évoque également « voie ». Tous font sens en contexte, et il est
possible que le Coran joue sur cette polysémie des références.
Notons que la racine arabe de
« milah », c’est MLL (م ل
ل), qui s’insère
dans un cadre sémitique plus large (מלל, parler, ܡܸܠܵܐ mots). La seule autre occurrence de
celle-ci dans le Coran est le verbe « dicter », répété trois fois à
la fin de la sourate dans le cadre de l’écriture d’une dette par un scribe
(2.284, وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ). Le Coran semble donc inscrire « milah » dans le
cadre des mots, du discours, du sens que l’on portera par écrit. Faut-il faire
un lien avec « تَلَىٰ »,
« réciter » qui revient souvent en contexte (125,129, puis
encore dans la sourate Al Imran) ? Comment
traduire ? L’enseignement, la doctrine, la croyance, la philosophie
d’Abraham ? Est-ce le parallèle figuratif de la « position »
d’Abraham, maqam Ibrahim (2.125, وَاتَّخِذُوا
مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى) ?
[1]
« Acquis » s’applique d’ailleurs régulièrement à « âme »,
voir 2.281 ou 4.111, qui insistent sur l’aspect individuel de la rétribution.
Partie 2
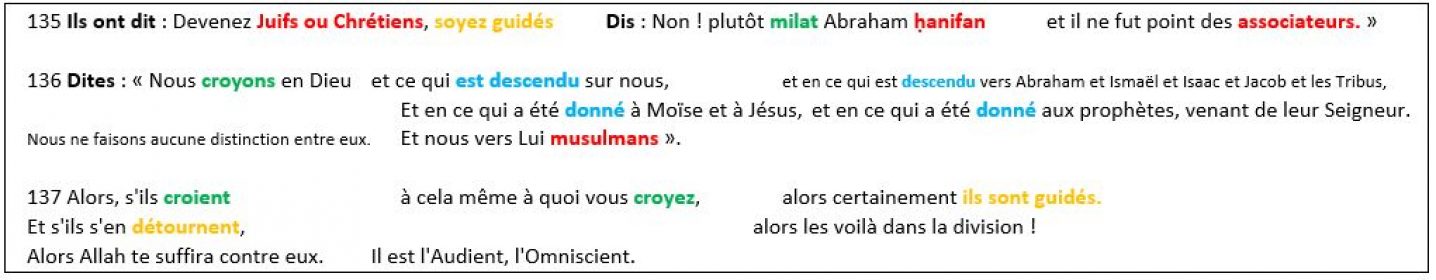

Précédent
Suivant
La partie est composée de trois morceaux AA’B’. Comme on le remarque
parfois, la composition du premier morceau annonce le plan.
Les deux premiers morceaux sont introduits par le verbe dire (« ils
ont dit », « Dites »). Ils opposent la proposition des « juifs
et des chrétiens » du premier morceau (appartenez à notre groupe) et une
contreproposition : la croyance en Dieu et dans l’intégralité des
prophètes. Ce refus de distinguer parmi les prophètes fait miroir au refus dans
le premier morceau de choisir une dénomination particulière. A une appartenance
héritée et déterminée qui serait guidance en soi, le second morceau oppose une
direction, une finalité à travers les textes : Dieu, qui est à l’origine
de leur révélation. Le terme « milat » joue un rôle particulier entre
les deux morceaux, il représente la croyance, l’énoncé (يملل), « les mots » de la religion.
En ce sens il fait écho à l’ensemble des textes et des révélations du second
morceau. Le dernier morceau fait la synthèse et corrige l’affirmation
initiale : « se guider », c’est le choix de
l’intégralité proposé dans le second morceau ; au contraire « se
détourner », sélectionner chacun une partie, c’est de fait créer des
schismes. Il y a une discrète référence à l’unicité de Dieu (Dieu suffit) qui
referme le cercle et encadre la partie avec le premier membre (« … point des
associateurs »).
Abraham est la première des personnes citées. Le Coran affirme ainsi
que l’ensemble du corpus monothéiste, dont lui-même, s’inscrit dans le
prolongement du discours d’Abraham. Ce qui donne une importance centrale à
l’attitude « ḥanifan » d’Abraham, qui génère ce qui suit. « Milat
Abraham ḥanifan » représente un point d’entrée de la révélation qui
génère l’ensemble du corpus textuel à venir. D’où le terme « musulman vers
Dieu » qui s’inscrit dans le prolongement de ḥanifan, sa finalité.
Par cela, c’est Dieu, qui est désignée comme origine de cette descente et
finalité du corpus. Comprendre le terme ḥanifan, c’est comprendre la
critique que le Coran fait des juifs et des chrétiens et le modèle qu’il
propose. D’où notre méthode, qui recherchera le sens par son articulation à la
fois structurelle et sémantique avec cette critique, qui est toujours le
contexte immédiat du terme. Par cette critique le Coran se fixe un but :
résoudre les contradictions des religions précédentes. Il se donne pour cela
deux contraintes : inclure Abraham et son orientation comme point de
départ, formuler une cohérence qui englobe tout le corpus monothéiste. Le moyen
qu’il se donne est un monothéisme strict, qui met tout en regard de Dieu.
Le modèle Abrahamique, au fur et à mesure de son développement, va construire
le sens de « ḥanifan ».
Dans le premier morceau, le terme « ḥanifan »
est pris en relation entre deux déterminations religieuses contradictoires. Le
terme qualifie Abraham dans son attitude relative à sa religion, sa croyance.
C’est l’opposé de « juifs et chrétiens » du premier membre,
opposition marquée par le terme fort « bala » : « Non,
au contraire ... ». Le troisième membre précise sur Abraham qu’il ne
fut point partie des « associateurs », terme qui précise l’aspect
monothéiste de la religion d’Abraham. « Ḥanifan » est ici une
appellation d’ordre religieuse opposée à « juif et chrétien », mais
qui n’est pas associatrice, donc a fortiori pas polythéiste. Or, le seul sens
pré-coranique connu du terme « ḥanifan » est le syriaque
« hnp », qui signifie païen. De nombreuses études ont été écrites
pour essayer de concilier les deux sens irréductibles, le « parfait
monothéiste » de la tradition avec le terme « païen ». S’agit-il
d’une inversion de valeur du terme païen ? Nous avons noté que le contexte
porte sur le refus de l’appartenance comme condition du salut, ici comme
condition pour être bien guidé. Si l’on considère Abraham du point de vue de la
simple appartenance familiale, il est en effet païen. Et pourtant il n’était
pas associateur : c’est donc une preuve par l’absurde que l’appartenance
ne détermine pas l’individu. Une première approximation du sens serait
donc : « Ils ont dit : « Soyez Juifs ou Chrétiens, vous serez guidés ».
Dis : « Non ! plutôt la croyance d’Abraham le païen, et il ne fut point
des associateurs. » Qui ne reprendrait polémiquement de « païen »
que la signification « ni juif ni chrétien » que les juifs et
les chrétiens lui donnent – et à laquelle ils s’arrêtent d’après le Coran – et
pas la dimension polythéiste. Alors il faut y voir une critique implicite de
l’emploi du terme par ceux-là : « par votre prétention au monopole,
vous appelez tout le monde païen, y compris Abraham. » En retour de cette
utilisation, « Ḥanifan » se charge implicitement du sens
positif d’une attitude précise : ne pas appartenir de façon sectaire à une
religion, que ce soit celle de ses pères (qui ont voulu le bruler et desquels
ils s’éloignent), et par prolongement, pas non plus aux monothéismes historiquement
déterminés qui confondent direction vers Dieu et exclusivité héréditaire ou
institutionnelle de la « bonne guidance ».
En parallèle au prophète qui doit donner le contre-exemple d’Abraham (« Dis !
»), il est demandé aux croyants dans le second morceau (« Dites !
») de formuler qu’ils reprennent l’ensemble des révélations (« descendu
… ») et des livres (« donné … »), incluant la Torah
et l’Evangile (donnés à Moïse et Jésus), ainsi que le Coran (« descendu
sur nous »). La reprise du verset initial de la sourate (verset
3 : « nous croyons en ce qui est descendu sur toi et ce qui est
descendu avant toi »), s’oppose maintenant aux prétentions des uns et
des autres au monopole de la révélation (versets 100, 105). A la sélection d’un
livre parmi les autres qui accompagne les divisions, le Coran oppose de
rassembler en reprenant le tout, dans lequel il s’inclue. Ce qui importe c’est
la direction vers Dieu, direction qui fonde le terme « musulman »,
et que l’on retrouve via l’ensemble des textes dont Dieu est à l’origine. Le
parallèle entre les deux morceaux révèle celui de « musulman » avec
les désignations religieuses du premier morceau : « musulman »
est placé en opposition à « juifs et chrétiens » et « associateurs »
et dans le prolongement de « ḥanifan ». Le parallèle est
établi ici entre les deux termes, que nous observerons par la suite juxtaposés :
« ḥanifan mousliman ». Dans la logique de la rhétorique sémitique,
une telle juxtaposition forme un tout : ici l’impulsion originelle
d’Abraham « ḥanifan » qui s’extrait de la religion de ses pères
est associée à la formulation d’une destination commune vers Dieu à travers le
terme « musulman ». Les deux termes participent d’une critique des
religions existantes, instituées. Critique qui est en même temps négation des
prétentions à l’exclusivité sectaire, formulation d’un consensus qui dépasse
les clivages en regroupant le corpus textuel et proposition d’une attitude
adéquate qui s’extrait des contingences culturelles pour retrouver une
direction vers Dieu.
Au-delà de la reprise du sens négatif « ni juif ni chrétiens »
du terme syriaque « païen », nous pouvons déjà avec cette première
occurrence commencer à dégager le sens positif de sa reprise « ḥanifan »
dans l’arabe du Coran. Nous arrivons à une nouvelle approximation qui se
rapproche un peu plus de celle de l’exégèse traditionnelle : « ḥanifan »
c’est l’attitude dégagée de la notion d’appartenance culturelle ou religieuse, « sans
folklore », non sectaire, qui permet alors de se tourner vers Dieu.
La religion « pure » de l’exégèse traditionnelle traduit donc en
partie l’idée. Elle masque cependant son fondement critique, la négation de la
notion d’appartenance et de monopole, qui a pu s’estomper avec la nécessité
historique, contingente, d’installer l’Islam comme communauté réelle. Nous nous
arrêterons pour l’instant à cette approximation : « Non ! plutôt
la croyance d’Abraham en indépendant ». Le choix d’Abraham d’une croyance
originale, différente du consensus social de son époque, tout comme la proposition
par le Coran d’un nouveau consensus, nécessitent de fait une autonomie,
au sens propre, par rapport à la culture, aux normes et aux croyances contingentes
du moment.
Partie 3
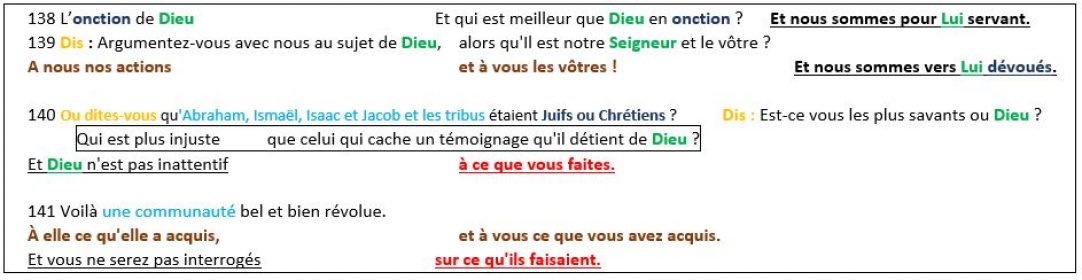
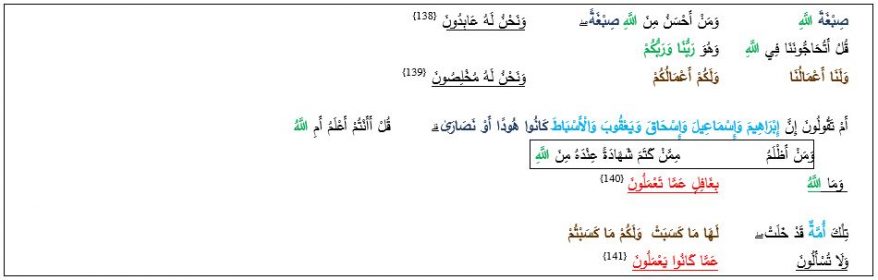
Précédent
Suivant
Le terme « صِبْغَةَ » – teindre, tremper dans un
liquide[1]
– désigne figurativement chez les chrétiens d’orient le baptême, l’immersion qui
marque l’entrée d’une personne dans la foi, et dans l’église, les deux étant
assimilés[2].
La reconnaissance rituelle, officialisée, du croyant est dépassée en la renvoyant
à Dieu, comme fondement, origine et finalité de toute pratique véritable. Au-delà
de l’apparence des signes et des appartenances religieuses, ramenées dans le
mot « teinture », c’est le « servant » qui fait le
croyant. Le principe monothéiste du Coran s’exprime ici : par la mise en
perspective devant Dieu, le signe disparait dans sa signification ;
l’habit, la couleur du croyant, se sont ses œuvres.[3] Le premier
morceau est construit autour d’une orientation de celles-ci vers Dieu
(« c’est Lui que nous servons, c’est à Lui que nous sommes
dévoués »), formulation d’une attitude adéquate qui corrige une pratique
religieuse devenue finalité en soi. Le dernier terme, « dévoués »,
conclue et encadre le morceau. Forme IV de la racine (خ ل ص), séparer, qui signifie dans son participe
actif « مُخْلِصُونَ »
« dévoués » à Dieu, et dans son participe passif « الْمُخْلَصِينَ », « les désignés »,
« ceux réservés » par Dieu[4].
Autrement dit, ils préfèrent Dieu et Dieu les préfère, portant l’ambiguïté constante
dans le Coran sur l’origine humaine ou divine de la foi. Ce double aspect se trouvait
déjà dans l’équivalence entre onction divine et service humain. Le terme
« dévoué / désigné », est parallèle avec « servir », et encadre
le morceau avec « onction », il reprend ce qui fait la réalité du baptême,
de la conversion. Dieu s’est gardé un reste[5],
et Muhammad y inscrit tous les croyants, en leur demandant de faire leur part.
« A nous nos actions, à vous les vôtres », comme pour Jacques, les
œuvres sont dans le Coran la preuve de la foi, préparant le « concurrencez
dans les bonnes œuvres » de la sourate Al Ma’ida. Le ton est plus
polémique, comme le marque le segment central, qui s’appuie sur l’attitude
correcte pour renvoyer tout le monde devant le même Dieu.
La désignation
et la différenciation par les actions (« à nous nos actions … »)
dans le premier morceau est reprise dans le dernier par la différenciation par
leur résultat (« A elle ce qu’elle a acquis … »). Elle est reprise
dans les sentences finales des deux derniers morceaux (« … ce que vous
faîtes. … ce qu’ils faisaient ».). Le Coran indique que c’est l’action des
hommes que Dieu regarde, que c’est elle qui est le critère objectif d’une
possible différenciation entre des groupes humains (entre communautés v.141, ou
entre groupes religieux v. 139), et finalement critère sur lequel porte le
jugement (« acquis, interrogés » dans le verset 141).
L’appartenance
religieuse mise en perspective par sa vérité, la foi, dans le premier morceau,
est questionnée historiquement dans le second. Comment qualifier les croyants
historiques, avant la naissance des dénominations religieuses ? Quelle
sont les termes corrects pour parler d’eux ? Question à laquelle le Coran
va tenter de répondre par les termes ḥanifan et musulman. Formuler une
définition qui marche pour tout le monde permettra et de sortir des impasses et
apories dans laquelle se sont enfermées les religions monothéistes précédentes
et d’arriver à une articulation universelle de la religion comme voie vers
Dieu. Au centre du second morceau, et donc de la partie, est posée la question
de connaissances sciemment cachées par les juifs et les chrétiens. Nous avons
vu précédemment qu’il s’agit d’arguments qui pourraient être utilisés contre
eux. Le texte parle de témoignage, c’est-à-dire de paroles qu’ils devraient au
contraire mettre en avant, montrant la contradiction d’une approche sectaire,
qui les séparent finalement de cela même qu’ils devraient défendre. Argument
pour une reprise de l’ensemble des textes, qui implique en pratique de
rassembler les différentes subjectivités.
[1]
Terme sémitique générique, Syriaque « ܨܒܥ », « tremper », Luke 7.38,
16.24 ; hébreu « צֶבַע » teinture, Juge 5.38. Figurativement
« insuffler, inculquer ».
[2]
L’immersion dans l’eau est déjà une pratique juive, type d’ablution précédant
la prière, et qui peut avoir valeur de conversion.
[3]
La tradition arrive plus ou moins d’elle-même à cette synthèse, la
« coloration » devient figurativement le changement du croyant par la
pratique. Encore une fois, perdant la dimension critique de par la perte de la
référence, elle tend à adopter l’ancien travers, cette « coloration »
redevenant à son tour « religion ».
[4]
En particulier 15.40-41 : « Ô mon Seigneur, parce que Tu m’as induit
en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous,
à l’exception, parmi eux, de Tes serviteurs élus. »
[5]
Le terme الْمُخْلَصِينَ n’est qu’un des signes de la reprise dans
le Coran de la théologie du reste, dont nous reparlerons pas la suite.
Sourate Al Imran
Nous allons maintenant étudier les deux termes « ²Oummyin » et « ḥanifan » conjointement dans la première moitié de la sourate al Imran, la partie 19-20 et la séquence probable 65-97.
(3:20) wal-umiyīna


Précédent
Suivant
La seconde occurrence du terme « ²Oummyyina »
intervient dans un contexte très similaire à celui de 2.75-78. On retrouve les
divergences, l’argumentation, le Livre, Dieu. Le mouvement général est
cependant inversé, le texte prend acte des divergences expliquées auparavant et
propose leur résolution.
La structure est articulée autour de trois verbes à
la VIIIe forme (se constituer quelque chose). Le premier, « اخْتَلَفَ » (diverger, J. Berque) supporte une
forte polysémie qui joue ici : se constituer tourné (se détourner), se
constituer différend (différer), donc « diverger », mais aussi se
constituer prédécesseur : une disparition qui appel à un successeur, d’où
« se disperser ». A l’opposé, dans le dernier morceau « اهْتَدَوْا » se constituer guidé, c’est-à-dire
se diriger, un mouvement opposé à la dispersion du premier. Au centre « اتَّبَعَ », se constituer suivant,
c’est-à-dire rejoindre, approuver. Ces trois termes mis en relation (se
disperser/diverger ; rejoindre ; se diriger) illustrent la métaphore
du chemin, un des fils conducteurs du Coran, qui construit au fil du texte « le
chemin des hommes droits »[1].
Dans le premier morceau, « diverger » est
mis en parallèle avec « recouvrir les signes de Dieu ». Le Coran présente
ceux qui ont reçu le Livre comme un ensemble, qui s’est divisé par envie
réciproque entre ses membres. La division provoque la divergence
d’interprétation et pas l’inverse (segment central)[2] et s’accompagne
d’un reniement des versets divins (troisième segment)[3]. On se masque réciproquement
les signes qui montrent le chemin, alors que les suivre auraient de fait dû rassembler
le groupe[4].
C’est une troisième référence au fait de cacher des versets pour tromper les
autres, dont la raison est donnée : « par envie entre eux», par
jalousie entre groupes. Alors que dans le système girardien[5], Dieu est une
médiation externe, c’est-à-dire partageable, non sujette à la dispute, cette partie
pointe vers un conflit mimétique humain, pour posséder la religion en tant que
système terrestre, qui devient l’objet de conflit entre eux. On masque les
versets qui permettraient une solution partageable[6].
Dans le dernier morceau, « Islam » est
pris dans deux symétries, c’est « se diriger » à l’opposé de « se
détourner ». Dans la métaphore du chemin donné ici, « dyn », parait
bien signifier « religion », dans le sens de voie, chemin, comme l’a
montré Al-Ajmi. L’Islam, qui n’est défini que comme rapport à Dieu (19a, 20a), s’inscrit
dans ce sens, et le tout premier membre sonne comme une définition préalable : appelons
« l’Islam » la voie vers Dieu. La proposition de rassemblement du
morceau central est le pivot du raisonnement, le projet monothéiste est à
nouveau fondement, moyen et objectif : le Coran propose Dieu comme
finalité commune en réponse à la dispersion initiale. La position
transcendante de Dieu, le Dieu, permet de dépasser la contingence des conflits
inter religieux et de s’adresser à tous. Le rapport au texte est résolu dans le
prolongement de la proposition de la sourate Al Baqarah : prendre
l’ensemble des textes : la transmission du message par le prophète (20h),
s’oppose à son recouvrement (19d).
Le terme ²Oummyin ici est pris dans deux relations :
dans le dernier morceau il fait partie de l’ensemble « ceux à qui a été
donné le Livre et les ²Oummyin », ensemble lui-même parallèle avec « ceux
qui a été donné le Livre » du premier morceau, qui s’adressait uniquement
aux peuples du livre et à leurs divisions. Le second morceau est adressé à tout
le monde, et l’expression y forme une totalité. On obtient « dit à ceux
à qui a été donné le livre et [aux autres], allez-vous vers
l’Islam ? » Dans cet ensemble, les ²Oummyin sont ‘les autres’, donc ceux
qui n’ont pas reçu le livre. Ce sont donc les gentils. Il n’y a pas de sens ici
à dire « ceux qui a été donné le Livre et les ignorants », cela ne
forme pas une totalité ni un ensemble cohérent. Cela laisserait bizarrement les
lettrés qui ne sont ni juifs ni chrétiens en dehors de l’adresse du prophète.
²Oummyin ici ne peut signifier ici que « gentils », comme le traduit M.
Hamidullah : ceux qui font partis des autres peuples. Ce ne sont plus les
gentils parmi les peuples du Livre, comme en 2.68, mais ceux des « nations »,
les peuples pas encore atteintes par le monothéisme. L’expression “le
peuple du livre et les gentils” forme un ensemble de deux complémentaires,
qui invite à l’Islam toute l’humanité. Comme le christianisme avait voulu
regrouper les juifs et les nations, l’Islam regroupe à son tour ceux qui ont
reçu le Livre [7]
avec ceux des autres peuples. L’« Islam », est alors moyen de
dépasser les rivalités et finalité commune, vers Dieu.
Cette lecture du monothéisme n’est pas totalement étrangère
aux chrétiens . Elle est présente dans le Nouveau Testament, où la foi
d’Abraham est déjà prise en exemple, dans une critique du judaïsme et d’une
certaine religiosité, qui se manifeste pareillement par une ouverture aux
nations[8].
[1]
Penser au foisonnement de verbes de termes s’inscrivant dans cette métaphore,
depuis « diriges nous sur le chemin des hommes droits », jusqu’à
« je retourne vers le Seigneur des hommes ».
[2]
« Les préjugés passent de la réalité dans les manuels », et pas
l’inverse.
[3]
On peut supposer que chacun s’accroche à ceux qui confortent leur construction,
établissant des systèmes interprétatifs divergeant, dont la nécessité de s’auto
justifier va remplacer progressivement la recherche de la vérité.
[4]
Il y a un lien étroit ici entre éthique, savoir et cohésion sociale qui
sous-tend les différents développements de l’objet de notre étude.
[5]
René Girard, en particulier dans « La Violence et le sacré » et
« Des choses cachées depuis la fondation du monde », montre la
religion comme un outil généré par les conflits humains, qui génère par le
sacrifice l’ensemble des systèmes culturels. Il montre la place particulière du
monothéisme, qui cherche à révéler ce mécanisme et à fournir d’autres moyens
que le sacrifice comme résolution des conflits.
[6]
Revenant de fait à des religions sacrificatrices, dont la particularité est de
cacher le fonctionnement, alors que le monothéisme se donne comme but et comme
moyen de révéler le fonctionnement et les enjeux.
[7]
Les juifs et les chrétiens se désignent chacun comme le « véritable
Israël ». La notion fût créée par les chrétiens pour se placer dans la
suite des prophéties concernant Israël. Le Coran, lui, différencie entre les
« fils d’Israël » et les « hudan » de son époque. Discrètement
« se diriger », qui est la forme VIII de « se guider », qui
désigne aussi les juifs, pouvant suggérer que le « verus Israel » ne
sont pas les peuples du Livre, mais tous ceux qui volontairement se dirigent
(« اهْتَدَوْا ») vers Dieu. Le Coran, ferait à
nouveau disparaitre le signe dans le signifié, se débarrassant d’une notion
problématique.
[8]
Ainsi de Galates, 3 « 5 Celui qui vous confère l’Esprit et qui opère
parmi vous des miracles, le fait-il donc par les oeuvres de la Loi, ou par la
soumission de la foi? 6 comme il est écrit: ” Abraham crut à Dieu, et
cela lui fut imputé à justice. ” 7 Reconnaissez donc que ceux-là sont
fils d’Abraham, qui sont de la foi. 8 Aussi l’Ecriture, prévoyant que
Dieu justifierait les nations par la foi, annonça d’avance à Abraham cette
bonne nouvelle: ” Toutes les nations seront bénies en toi.
” 9 De sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec le
fidèle » Ou encore le très beau passage de l’épitre aux hébreux,
11:8-14, sur la foi comme liberté.
Sourate Al Imran 64 -97
La séquence 64-97 de la sourate Al Imran développe le thème de l’Islam comme direction commune et nous permet d’aborder ensembles les termes ²oumyyin et ḥanifan. Elle forme un tout cohérent : Dieu s’adresse au prophète Muhammad pour clarifier ses relations avec les peuples du Livre et les prophètes, en s’appuyant sur l’exemple d’Abraham.
Il faudra attendre l’analyse complète de la sourate pour valider le découpage de l’ensemble et les relations entre les passages. On peut cependant déjà voir 4 passages indépendants développant un thème commun. Les trois passages (65-68), (81-85) et (93- 97) sont construit sur une même forme concentrique AxA’, et formulent une direction commune vers Dieu partant d’Abraham. Raymond Farrin propose 64-99 pour son cercle C, qui appelle juif et chrétien à un agrément à ne servir que Dieu, sur l’exemple commun d’Abraham. Pour nous 98-99 sont dans la séquence suivante : ils ne peuvent être rattachés au passage 93-97, et les membres initiaux « Dis : ô gens du Livre » sont en parallèle à ceux « ô vous qui croyez » des versets 100 et 102. C’est le problème de son Livre, qui ne livre que des structures globales, purement sémantiques, sans s’appuyer sur la structure syntaxique sous-jacente. Ceci dit, nous sommes d’accord dans les grandes lignes avec son découpage, et pour établir le parallèle avec la séquence 113-141 de la sourate Al-Baqarah étudiée précédemment, parallèle au centre de notre étude et dont nous allons étudier les ramifications.
Notons d’emblée la phrase introductive de cette séquence : « Ô peuple du Livre, venez à une parole équitable entre nous et vous ». C’est dans ce cadre qu’apparaissent les deux premières occurrences du terme ‘ḥanifan’, qualifiant Abraham, ou la religion d’Abraham. Entre les trois, nous retrouvons deux passages parallèles polémiques (69-80) et (86-92), le premier adressé au peuple du livre (notez le singulier), le second sur ceux rejetant la révélation. Le terme ²Oummyin intervient dans le premier des deux, à nouveau en relation avec le peuple du livre.
La séquence se découpe comme suit :
A (64-68) Ô peuple du Livre, venez à une parole équitable entre nous et vous
B (69-80) Problématique du peuple du Livre
A’ (81-85) Croyons dans tous les messagers d’Allah
B’ (86-92) Problématique des dénégateurs
A’’ (93- 97) Suivons la doctrine d’Abraham
A (64-68) Ô peuple du Livre, venez à une parole équitable entre nous et vous
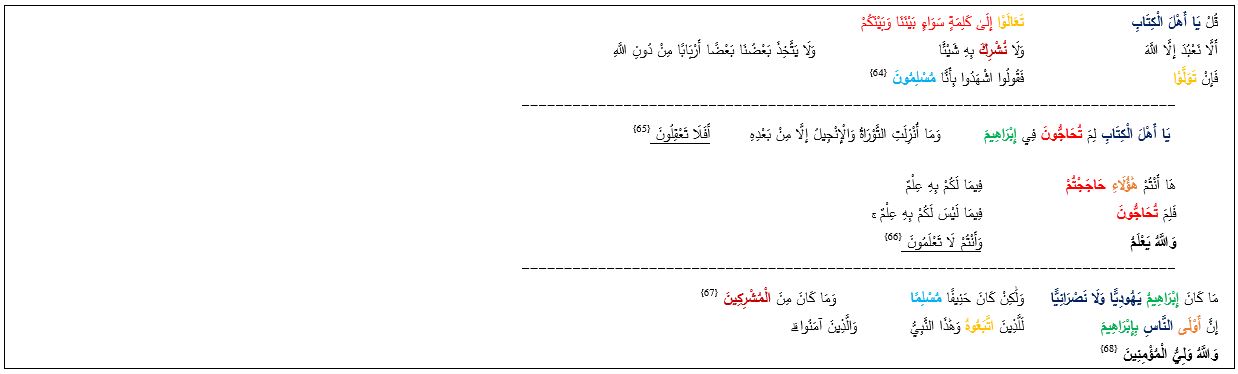
Ce passage est composé de trois parties, les deux
parties externes ne contiennent qu’un seul morceau. Il est adressé au
« peuple du Livre », terme qui introduit les deux premières partie et
la dernière via l’expression « ni juif ni chrétien ». La première et
la dernière partie sont parallèles : la proposition d’une parole commune, ne
servir que Dieu, et ne pas « associer », s’appuie dans la dernière sur
la position d’Abraham « ḥanifan mousliman », « non
associateur »[1].
Le parallèle entre les deux morceaux est appuyé par la reprise du terme
« musulman », direction prise par Abraham, sur laquelle le Coran
appelle le nouveau groupe à s’aligner[2].
La partie centrale met en évidence une sortie négative de la première
proposition : « argumenter » les uns contre les autres à propos
d’Abraham (situation dans laquelle le Coran trouve les juifs et les chrétiens) au
lieu d’en venir à « une parole équitable entre nous et vous ». Cette
sortie négative met en évidence la solution positive proposée dans la
dernière partie : Abraham modèle du monothéisme, comme fondement de la première
proposition.
Le terme « ḥanifan » est pris dans
les symétries entre les membres du segment (67), dans lequel il occupe une position
centrale. Le verset 67 lui-même est également prit dans un large filet de
symétries : Il est parallèle avec le segment qui le suit dans son morceau.
Il est parallèle avec la première partie, duquel il reprend les termes
« musulman » et « association ». Il est parallèle avec le
segment qui introduit la seconde partie (65). Ce vaste réseau de relation va
nous permettre de mettre en valeur la structure syntaxiques qui encadre son
sens.
Nous avons vu précédemment, en accord avec la thèse
du Dr Al-Ajmi, que la notion d’Islam est étroitement liée à celle de chemin, de
direction. L’opposition dans la première partie entre « venez » et
« s’ils se détournent » est résolue par la proposition d’une position
commune, au centre des deux. Le verset 67 montre comment Abraham incarne celle-ci.
L’affirmation qu’Abraham n’était ni juif ni chrétien au début du verset, s’appuie
sur l’évidence du verset 65 : la Torah et l’Evangile ne sont descendus qu’après
lui. Ainsi il ne peut appartenir à des groupes religieux fondés sur ces textes.[3]
[1]
Ces termes sont organisés selon la quatrième Loi de Lund : ceux qui sont aux
extrémités d’un morceau se retrouvent au centre de l’autre, et réciproquement.
[2]
Ils en prendront le nom comme désignation, parfois paradoxalement Le terme
demande à se diriger vers Dieu comme le faisait Abraham, et pas à penser
qu’Abraham était un « musulman » à l’image des nouveaux croyants de
632 au XXIe siècle, de façon purement contingente et anachronique. Notre étude
vise entre autres à restaurer le sens de l’attitude « hanifan » mise
en avant dans le Coran comme solution.
[3]
Ce qui pose d’ailleurs la question du culte : quel culte suivait Abraham ?
En particulier pour les interdits alimentaires, comme énoncé à la fin de la
sourate Al Nahl. H. Zellentin pose les enjeux de la question dans « The
Quran’s legal culture ».
La troisième partie
Le morceau est de forme AA’B avec deux segments
parallèles et une sentence finale. Le premier segment définit Abraham. Le
second définit parmi les humains « les plus proches de le suivre ». La
problématique est posée par l’opposition entre ces deux premiers segments, qui
mettent en regard de l’attitude d’Abraham, d’un côté sa différence avec les
peuples du Livre, de l’autre pour les humains en général, ce qui se rapprocherait
de cette attitude. Entre les deux se trouve un non-dit, ce qu’il faudrait
éviter, le texte mettant en valeur ce qui serait souhaitable. Le troisième fait
la synthèse ramenée à Dieu.
Les deux premiers segments sont opposables membres
à membres. Les deux premiers membres de chaque reprennent le nom Abraham, dans
le premier segment il est opposé aux groupes institués « juifs et
chrétiens » qui se réclament de lui, dans le second des humains sont
rapprochés de lui. En passant de groupes religieux spécifiques à l’ensemble
générique de l’humanité, l’opposition s’écarte d’une lecture a priori pour
tenter une redéfinition ontologique de ce qui serait réellement le plus proche
d’Abraham. Redéfinition étendue et valable pour l’humanité. Pour universaliser
son propos, le texte pose une tautologie, les « plus proches
d’Abraham sont ceux qui le suivent », ramenant à une réalité pratique, qui
gomme les notions d’appartenance.
L’opposition entre les seconds membres précise ce
qui est en jeu. Les deux attitudes étudiées précédemment sont rassemblées
« hanifan mousliman », et mise en regard de leurs deux modèles respectifs.
A travers ces deux points historiques sont mis en regard la fondation du
monothéisme par l’attitude « hanifan » d’Abraham et sa
finalisation comme direction vers Dieu par « ce prophète », Muhammad
[1]. Le terme
musulman n’est pas une désignation religieuse anachronique, il ne peut s’agir
ici que d’une attitude déjà adoptée par Abraham, complémentaire à
« hanifan ». Les deux termes juxtaposés forment un ensemble, noté
plus haut : l’impulsion originelle d’Abraham « ḥanifan »
qui s’extrait de la religion de ses pères est associée à la formulation d’une
destination commune vers Dieu à travers le terme « musulman ». Le
Coran pose Muhammad comme finalisation historique de cet ensemble dans un
double mouvement, qui en même temps ramène toute l’expérience précédente des
peuples du Livre dans son rapport à Dieu et leur ré applique l’impulsion
originale « hanifan » de sortie du religieux, expérimentée par
Abraham. Pour le Coran, ces deux mouvements se font ensembles, rassemblés dans
l’expression « hanifan mousliman ».
Il faudrait se demander ce que signifie « ceux
qui croient », à l’opposé des « associateurs ». Il reformule de ce
qu’il faut conserver des « juifs et chrétiens ». Dans la perspective
ontologique du deuxième segment, ce que le Coran conserve de l’attitude religieuse
une fois qu’y est appliqué le critère de la critique. Le reste fidèle, qui n’a
pas suivi les idoles (d’où l’opposition avec associateur) est invité en même
temps que le reste des nations, les ²oummyyin vu précédemment. Est-il dépendant
syntaxiquement de « le plus proche » (ceux qui croient sont le
plus proche d’Abraham) ou de ceux qu’il faut suivre (il faut suivre ceux
qui croient) ? Les deux interprétations sont possibles simultanément, s’ils
sont les plus proche d’Abraham, il faut les suivre aussi.
Le dernier segment fait la synthèse en 3 termes du
morceau. L’ensemble est remis dans la perspective de Dieu, et indique son
attitude envers les hommes. « Protecteur » (وَلِيُّ) est
la forme V de la racine (و ل ي) dont le « le plus proche » (أَوْلَ) est la forme IV, le parallèle met en
valeur la réciprocité des rapports entre Dieu et l’homme. Le terme « croyant »
reprend le verbe du segment précédent. En juxtaposant le premier et le dernier
terme du segment précédent, la sentence finale du dernier segment referme le
cercle : Dieu, qui est la direction implicite enfin nommée, protège ceux
qui sont tournés vers Lui. Le premier segment contient la problématique et sa
solution, le second sa reformulation en terme généraux et le moyen historique
de sa résolution concrète, le troisième le résultat acquis, dans sa simplicité
devenue évidence. La simplicité de la synthèse et la trivialité du parallèle
font de la question des dénominations religieuses un non-sujet, du moins
montrent la possibilité maintenant acquise de sa résolution.
[1]
Le texte désignant son transmetteur par le pronom démonstratif.
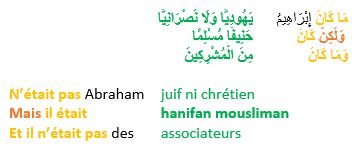
L’analyse
rhétorique relève trois propositions, mises en relief par leurs parallèles
réciproques. Leurs oppositions forment un système descriptif précis, qui
interroge les catégories religieuses des peuples du livre. Que veulent dire les
catégories « juif », « chrétien » et « païen » appliquées à Abraham ? Ce
système d’oppositions successives prend ici une tournure dialectique. Le premier
membre est construit sur la juxtaposition des termes juif et chrétien, opposés
qui forment un ensemble, auquel Abraham n’appartient pas, ce qui historiquement serait évidemment
impossible . Cela donne une connotation contingente à ces religions : elles ne
sont que circonstancielles si elles ne peuvent inclure Abraham. Le
deuxième membre sur l’opposition contradictoire de « païen » et « musulman »,
qui ensemble qualifient Abraham. Les deux membres externes, semblent opposer
{les juifs et les chrétiens} et {les polythéistes}, deux groupes
contradictoires qui partagent toute l’humanité selon les critères religieux
judéo-chrétiens. Cependant ils qualifient tous les deux ce que n’est pas
Abraham, et mettent de fait en parallèle {les juifs et les chrétiens} et {les associateurs}.
Le membre central créé une rupture par une expression
paradoxale, « ḥanifan musulman », avec le terme païen à contre-emploi (un
païen non polythéiste). Comme dans la formule « la ilah ila Allah », Il y a ici
une double négation : Abraham n’est pas polythéiste (musulman, opposé au
dernier membre), mais pas non plus du peuple du livre (hanifan, opposé au premier).
Ajoutée au remplacement de « polythéiste » par « associateurs », l’expression
brise la dialectique entre {peuple du Livre} et {païens} constitutive de
l’époque. Nous avions vu que la première occurrence préparait cette association
des deux termes, on y observait au niveau d’une partie la même opposition à «
juifs et chrétiens » et « associateurs ». Dans cette seconde occurrence, les
deux termes sont juxtaposés pour former l’expression « hanifan musulman »,
confrontée directement avec les autres catégorisations religieuses. Son
opposition avec « juif et chrétien » montre une nouvelle possibilité :
appartenir à peuple « païen » et être monothéiste. Son opposition
avec « associateur », transforme l’opposition habituelle {monothéiste} /
{païen} en {monothéiste} / {associateurs}.
Alors que païen est un statut en même temps qu’une
pratique, associateur concerne uniquement un rapport à Dieu. Le Coran, toujours
selon son procédé monothéiste, ramène le formalisme des statuts à Dieu et à leur
réalité pratique. Nous avons trois statuts religieux (juif, chrétien ; païen)
qui sont mis en relation avec deux rapports à Dieu (musulman ; associateurs).
La rupture centrale souligne cette différence de nature entre les termes.
N’était pas Abraham juif ni chrétien // mais il était païen, musulman //
et il n’était pas des associateurs.
La critique de la confusion entre croyance et peuple se
fait par l’introduction de deux termes opposés, portant uniquement sur la
croyance (musulman ; associateurs). Nous retrouvons le lien entre critique des religions
précédentes, redéfinition du vocabulaire et mise en place d’un nouveau modèle. Le
sens de « musulman » ne peut être ici une troisième définition
ethnico religieuse, il redéfinit la religion dans son rapport à Dieu uniquement.
« Associateur » à l’inverse de « païen », permet de questionner ce
rapport à Dieu, y compris dans le cadre des religions du Livre.
Le changement de terme, permet une critique du monothéisme
de l’intérieur qui était interdite par la confusion {étranger, idolâtre}
désormais abolie par la position {étranger, monothéiste} d’Abraham. Si
l’étranger n’est plus forcément associateur, alors l’appartenance n’est plus
forcément synonyme de monothéisme. S’ouvre la critique coranique de la position
{appartenance, associateur} des systèmes juifs et chrétiens. Abraham est à la
fois exemple de ce qui ne fonctionne pas dans leur système et modèle de ce
qu’il faudrait faire, les mots qui le qualifient portent simultanément critique
et modèle. Cette position extérieure aux systèmes religieux précédents utilisée
comme appui critique rappelle de fait le mouvement d’Abraham hors du système de
ses pères par la critique des statues, d’où le terme « hanifan », Abraham est
bien un païen, mais qui est sorti du paganisme, arrivé par la contemplation de
l’univers à un nouveau Dieu, d’où le terme « musulman ». Il y a
équivalence entre : 1. le changement de nature religieuse effectuée par le
Coran depuis les systèmes précédents (pour l’instant le passage de l’ethnicité
à un rapport à Dieu), 2. le conflit d’Abraham avec le système culturel de son
peuple (les idoles comme langage et religion), 3. le tout forge l’expression
« hanifan musulman », et est exprimé par elle. Cette capacité
critique, développée par Abraham, qui lui permet de dépasser les déterminations
de sa communauté d’origine (la critique, la confrontation et le départ), est
mise en avant à travers le terme « hanifan ». « Musulman » porte à la
fois la destination (Dieu) et le moyen (rapporter à Dieu).
Ensemble, départ et destination, ils sont à la fois
l’histoire des prophètes et le moyen du monothéisme dans l’histoire, le trajet
d’une situation existante vers une nouvelle. Le « non-encore » de la
promesse comme pays du croyant, la maison élevée par Abraham. Le tout sert
d’exemple à la critique du monothéisme par lui-même de Muhammad, critique
adressée aux systèmes religieux de l’époque, qui prennent le chemin inverse,
celui de communauté en voie de fixation, au risque d’oublier le Dieu
transcendant de l’alliance. Elle pourrait bien reposer sur une relecture de
l’épitre aux hébreux, 11.8-14, ou Abraham circule librement, entre la
Mésopotamie, la Palestine et l’Arabie, vivant en étranger sous la tente, à la
recherche d’un pays et d’une cité promise par Dieu. La proposition d’une parole
commune repose sur une lecture du rôle historique du monothéisme par rapport
aux sociétés humaines, que le Coran propose de reprendre, à travers une
référence commune.
B (69-80) Problématique du peuple du Livre
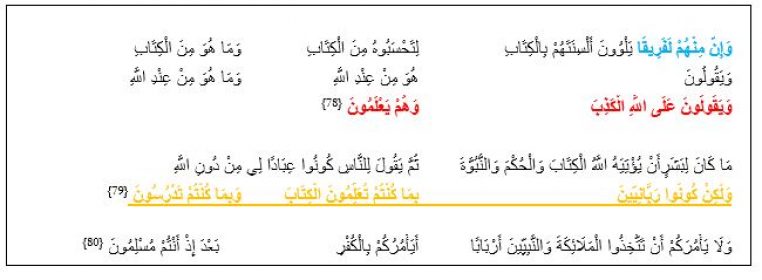
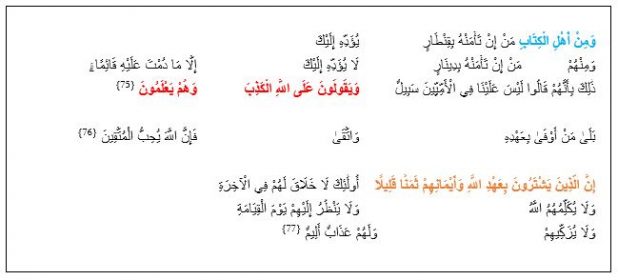
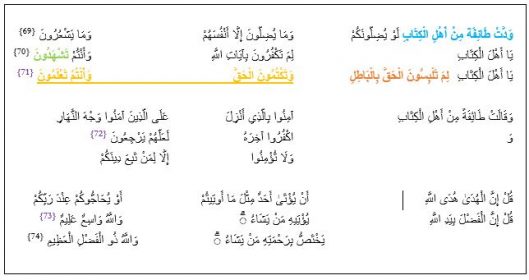
Précédent
Suivant
Après la proposition
d’une position commune, le second passage développe la critique des peuples du
Livre. Elle porte sur le rapport conjoint à Dieu et à l’écriture. Chaque
partie est introduite par la désignation d’une partie d’entre le peuple du
Livre et reliée aux deux autres par la reprise d’un segment. Les deux parties
externes opposent « ne cachez pas la vérité alors que vous savez » et
« soyez des enseignants par ce que vous avez connu du Livre et de ce que
vous avez étudiez. ». La partie centrale est liée à la première par le
parallèle entre « n’habillez pas la vérité par le futile » et
« ceux qui échangent l’alliance de Dieu et leur foi pour un prix
ridicule ». Et à la dernière par la reprise exacte de « et ils disent
sur Dieu le mensonge alors qu’ils savent ». Le rapport à Dieu, au savoir
et à la vérité sont ici étroitement liés.
La première partie, reprend
le reproche contre certains des gens du livre de vouloir détourner les autres,
comme on l’a vu en 2.76. Il est remarqué que c’est incompatible avec le
témoignage, dont le but est au contraire de transmettre la connaissance, ils
masquent ce qu’ils devraient revendiquer. C’est alors eux-mêmes qu’ils
détournent. Le morceau central en illustre l’impact sur eux-mêmes, quand
ils s’enjoignent entre eux de suivre uniquement les gens de leur religion[1]. La subjectivité
serait-elle garante de la vérité ? Au contraire nous lisons dans cet
isolement un phénomène d’aveuglement collectif[2].
La seconde que nous
étudierons en détail puisqu’elle contient l’occurrence d’²Oummyyin, met en
évidence un phénomène parallèle. Pour ne pas rendre leur argent, ils mentent
sur Dieu, en cachant un verset un bien connu. La préservation d’un système
préférentiel avantageux, leur cache la parole divine, rompant ainsi leur
alliance pour un prix dérisoire.
Enfin dans la
dernière partie ils inventent des choses, disant qu’elles viennent de Dieu
alors qu’ils les ont inventées. Encore une fois, cela est dû à un problème de
relation à l’autre, introduction du fait de se faire seigneur sur les autres,
sur lequel nous reviendrons.
Nous nous
intéresserons à la partie centrale, après avoir bien établi son contexte
immédiat, qui est le développement de 2:76 et de 3:19 : par envie entre
eux, les gens se cachent l’écriture et divergent, s’établissent en secte.
Rompant ainsi la relation avec Dieu. Au contraire, le verset 73 donne
l’enjeu : c’est Dieu qui guide et donne l’Ecriture à qui Il veut
(73). Ainsi le savoir, le rapport à l’Ecriture sont l’enjeu de disputes alors
qu’ils devraient être une base commune, un savoir partagé.
[1]
Suivre uniquement ceux qui tournent leur face vers la rivière, pourrait bien
être une reprise du baptême, comme en 2.139. Toujours une conversion pensée
dans le sens d’une appartenance et pas d’un chemin vers Dieu.
[2]
L’exact opposé de ce que proposera mille ans plus tard Malcolm X : « je suis
avec la vérité, quel que soit celui qui la dise », la nécessité d’aller la
chercher au-delà des subjectivités.
La partie centrale
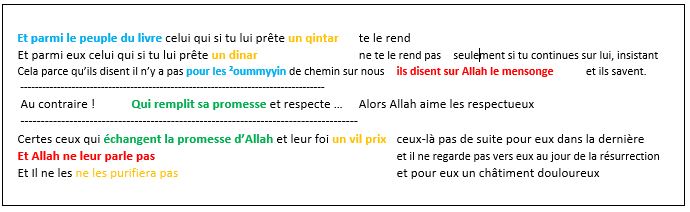
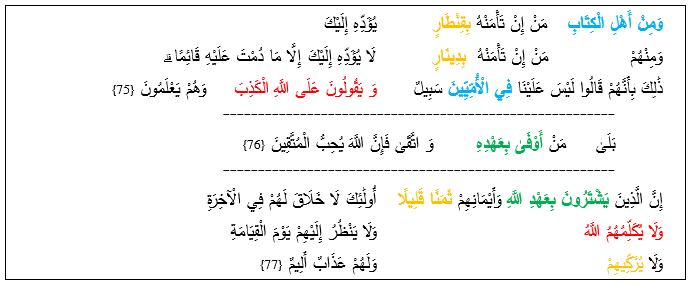
Précédent
Suivant
La partie se découpe
en deux morceaux externes parallèles et un morceau central. Le premier donne un
cas particulier de fraude, ceux qui ne rendent pas l’argent aux
« ²Oummyyin », il s’accompagne de « ils mentent sur Dieu ».
Le dernier rapporte ceux-là à Dieu : « ils échangent la promesse
d’Allah pour un prix ridicule » (l’argent gardé dans l’exemple), en
retour de leur mensonge « Allah ne leur parle pas ».
« Il ne
les purifiera pas », « لَا
يُزَكِّيهِمْ », porte la racine de la
« zakat », l’aumône. Cela renvoie au moins les chrétiens au Notre
père, où « pardonner les pêchés » est le sens figuratif de
« annuler les dettes », ici garder l’argent pour des raisons
ethniques, au lieu de le rendre (et en général de le partager), c’est préférer
« un vil prix », en conséquence « Il ne leur fera pas aumône ».
On observera encore la symétricité des rapports de Dieu avec les hommes. Ils
rompent leur engagement, Dieu rompt le sien ; ils mentent sur Dieu, Il ne
leur parle plus ; ils ne rendent pas l’argent, Dieu ne leur remet pas leur
prix. Ils sont la cause de leur châtiment, le jugement est juste, et s’applique
selon leur critère. Enfin le choix d’un « un vil prix » fait que Dieu
« ne les purifiera pas », ils se
dégradent volontairement alors que Dieu leur avait proposé le chemin pour se
redresser.
Le morceau central oppose
l’attitude correcte – remplir sa promesse – qui rétablit le lien entre la vérité,
l’autre et Dieu. Cette attitude c’est la « taqwa », le sens pour
Berque est de « se prémunir », qui rappelle le sens premier de
« préserver », se préserver, préserver l’autre, préserver son rapport
Dieu. Nous traduisons par « respecter », qui s’en rapproche et qui a
l’avantage de toujours fonctionner syntaxiquement[1].
La réciprocité des
rapports entre Dieu et les humains est mise en évidence encore ici. Voir les
comportements humains selon le point de vue de Dieu permet de les mettre en perspective
et les désubjectiviser. Ce n’est plus l’aveuglement de soi selon ses propres
arguments, ni l’opposition à l’autre à cause d’une situation non maitrisée.
Cette réciprocité semble faire disparaitre la miséricorde. Ce n’est pas le cas,
nous le verrons en expliquant « ils mentent sur Dieu ».
[1]
On parle souvent de « piété ». L’autre traduction, « craindre
Dieu », nous semble sans fondement dans le Coran. « Piété »
fonctionne mais repose sur un fonctionnement personnel, isolé, qui n’est pas en
rapport avec l’autre ou Dieu. La « taqwa » est toujours en situation
envers quelqu’un. Il faut un verbe transitif. Voir également l’analyse du terme
dans les versets 5:87-93, in « Réponse à Rachid Benzine : trois
découpages possibles ? ».
Le verset 75
Le morceau est
composé de 3 segments, les deux premiers sont parallèles et mettent en
opposition deux attitudes parmi les gens du Livre. Il y a ceux qui sont particulièrement
honnêtes et rendent l’argent emprunté, fût-ce une grande somme. Et ceux qui le
gardent, fût une somme méprisable. Le dernier segment décrit le cadre
idéologique qui sert de justification à la seconde attitude : certains parmi
« le peuple du livre » s’estiment supérieurs aux
« ²oummyyin ». La répétition de « ils disent », et son
opposition avec [alors qu’]« ils savent » pose cette justification dans
un mensonge volontaire contre Dieu. C’est une reprise des versets du morceau
69-71, « pourquoi voilez-vous la vérité par le futile, pourquoi occulter
le vrai alors que vous savez ? » : l’un des thèmes du passage est le
recouvrement des versets bibliques dans l’argumentation sectaire. Le Coran
propose maintenant un exemple précis : « ils disent qu’il n’y a pas
pour les ²oummyyin de voie sur nous ».
« Ignorant »
fait ici à peine sens. Il s’agirait de prendre un avantage sur les illettrés
(qui ne savent pas compter ?). Cela contredirai le harcèlement pour récupérer,
n’expliquerai pas l’impossibilité d’un recours, ni le contexte général de
conflit religieux. De plus il y a une extériorité entre celui à qui l’on
s’adresse (« si tu lui prête ») et le peuple du Livre. Le terme ne
remplit le sens que lui donne le contexte seulement s’il s’agit d’un étranger,
d’un groupe extérieur pour le peuple du Livre, vers lesquels ils n’ont pas de
compte à rendre[1].
Deux parallèles mettent en opposition « peuple du Livre » et
« ²oummyin ». Dans le membre lui-même : « Il n’y a pas pour
les ²oummyyin / de voie sur nous », qui montre que cette
partie du peuple du Livre fait une différence de type « eux et nous »
avec les « ²oummyyin ». Puis l’opposition entre « le peuple du
Livre » et les « ²oummyyin » qui encadre le verset justifie dans
leur discours une différenciation injuste et a posteriori entre les deux
groupes. Différenciation qui contredit les versets de Dieu, leurs Livres.
L’exemple donné se
suffit à lui-même, il est rationnel, universellement partageable. Dieu ne
justifie pas la malhonnêteté ni de ne pas tenir sa parole. A lui seul, il
suffit à remettre en cause tout discours qui établirai une division qualitative
entre les humains sur des fondements religieux. Cependant « et ils
savent » s’inscrit dans le contexte d’un rapport à Dieu et à l’écriture,
appuyé sur le rapport à l’autre par un exemple précis. Qu’est-il donc écrit
dans « le Livre » , qu’ils savent contredire cette attitude ?
Dieu ne fait pas acception de personne[2].
Surtout il existe un commandement explicite, dès la Torah, correspondant assez
précisément à notre cas et que Dieu appui personnellement, au point de le
marquer de Son Nom :
· Lévitique
19.34 « L’étranger qui séjourne
parmi vous, vous sera comme celui qui est né parmi vous, et tu l’aimeras comme
toi-même ; car vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte : Je
suis YHWH, votre Dieu. »
·
Lévitique « 24.22 Vous n’aurez qu’une
même loi ; l’étranger sera comme celui qui est né au pays ; car je
suis YHWH votre Dieu. »
·
Nombres « 15.15 Il y aura une seule loi
pour toute l’assemblée, pour vous et pour l’étranger en séjour au milieu
de vous ; ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants : il en sera de
l’étranger comme de vous devant YHWH. »
Dans le pays de la
promesse, le pays donné par Dieu, le pays à construire, il n’y a pas de
différence entre l’étranger et l’autochtone, il n’y a pas de « eux et
nous ». Le texte s’appuie sur deux raisons. L’expérience vécue « vous avez
été étrangers en Egypte », est fondatrice de la religion de Moïse. Elle se
traduit dans la pratique par un devoir de solidarité qui gomme les différences
entre étrangers. Et une mise en rapport avec Dieu : « car je suis YHWH votre
Dieu ; il en sera de l’étranger comme de vous devant YHWH. ». Il y a déjà
dans la Torah cette cohérence entre l’expérience immanente, le Dieu
transcendant et la conséquence pratique. Le départ d’Egypte comme le départ
d’Abraham, les places en situation d’étranger, où ils rencontrent le Dieu
unique, le même pour tous les hommes, duquel découle les principes pratiques
d’égalité et de justice. Nous obtenons dans la Torah un commandement suffisamment
important pour que Dieu y appose Son Nom : la loi est universelle, l’étranger y
a droit. Vu l’insistance marquée par l’apposition du nom divin, nier ces
commandements, c’est mentir sur Dieu en plus de cacher les versets. L’évangile
porte lui aussi cette notion « Est-il Dieu des juifs seulement et pas des
nations (εθνων, ܥܡܡܐ) ? Oui
également des nations »[3].
La loi est universelle parce que Dieu est unique. Nier l’égalité des hommes
devant Dieu, c’est nier son unicité.
Se servir de son
appartenance religieuse pour justifier l’injustice sur les autres n’est plus
possible. L’acte malveillant trouve sa justification théorique dans l’orgueil,
le premier pêché. Au contraire, la Torah y opposait un devoir de solidarité
entre étrangers passés et à venir. Dans le Nouveau Testament, les « Actes
des apôtres » parlent d’Abraham qui « par la foi vivait sous la
tente, en étranger dans la terre promise », de ceux « à la recherche
d’une patrie ». Figurativement nous avions vu « hanifan » ceux
qui quittent leur culture pour se diriger vers Dieu. Nous avons bien deux
modèles opposés. L’arrogance identitaire contre l’humilité de celui qui cherche
un « non-encore », le pays promis par Dieu, qu’il cherche en
étranger.
On se rappelle la
façon dont le terme « hanifan » portait simultanément la critique des
peuples du Livre et le modèle coranique. Il convient d’étudier le vocabulaire
du Livre pour comprendre le rôle similaire que joue le terme ²oummyyin. La
Torah parle des « nations » (גוֹיִם, ἔθνη,
ܥܲܡܡܹ̈ܐ) et des «
peuples » (לְאֻמִּים, λαοὶ, ܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ). Pour traduire l’opposition
religieuse entre « le peuple du Livre » et « les nations »,
le Coran aurait dû reprendre comme la Bible (גוֹיִם, ἔθνη,
ܥܲܡܡܹ̈ܐ) qui traduit les goys, les ethnies, les païens. Il
l’aurait traduit par « قَوْمِ » dont la
racine porte la même notion de dresser que l’hébreu « גוֹיִם »[4]. Terme qui d’ailleurs est utilisé dans le Coran pour
qualifier les gens religieusement ou intellectuellement. Il choisit plutôt de
traduire par « أُمِّيُّونَ »
l’équivalent de (לְאֻמִּים, λαοὶ, ܐܸܡ̈ܘܵܬ̣ܵܐ), le
peuple, qui est culturellement neutre[5]. Dans le même mouvement, il passe à un pluriel
générique, pas les peuples (« أُمَمٌ ») mais
« ceux des peuples » (« أُمِّيُّونَ »). Il
préfère une généricité neutralisée, « ceux des peuples »[6], permettant par la suite de définir les gens
individuellement, par les actions qui leur sont propres.
Le terme « قَوْمِ » n’est
lui-même plus porteur d’une notion d’étrangeté, il signifie toujours un groupe
qui porte, qui se dresse pour, une pensée, un groupe sur un critère
particulier, mais en aucun cas les gentils, les païens, les goys.[7] Le terme est conservé, mais dépossédé de
son pluriel et d’une partie de son sens[8].
Notons que la même
substitution est effectuée pour Abraham, qui ne deviendra pas une
« nation » comme dans Génèse 18.18, mais une
« communauté ḥanifan » (« أُمَّةً
قَانِتًا
لِلَّهِ
حَنِيفًا »)[9]. Pour appeler tous à un Oumma (« أُمَّةً ») commune,
sur laquelle nous reviendrons. Le Nouveau Testament utilise habituellement le
terme gentils (ἔθνη) pour les non juifs, même chrétiens.
Cependant, son ouverture à tous les peuples a déjà proposé la même substitution
des termes, ainsi Actes 15.14 : « Simon a raconté comment Dieu a choisi parmi
les gentils (« ἐξ ἐθνῶν
») un peuple (« λαοὶ ») consacré à Son Nom ». Toujours
l’idée d’un reste, parmi tous les groupes humains, et d’un mouvement vers Dieu,
à la recherche d’un pays, et de son peuple.
Le choix du terme
arabe parmi les termes bibliques opère un glissement, on quitte la notion d’un
archétype ennemi infidèle, goy pour les juifs, païen pour les chrétiens, pour
arriver à un terme neutre, les peuples, ceux des peuples. On se rapproche des
« humains », terme qui a été opposé par Dieu à Abraham à propos de sa
descendance (2.125) puis au peuple du Livre (3.20). Le Coran s’adresse à tous
sur un pied d’égalité. Le glissement de terme est parallèle à celui opéré sur
« hanifan », l’un introduit la capacité à s’extraire de son
ethnicité, l’autre demande à ne pas se construire d’ennemi sur une base
ethnique. Au-delà de la notion de polythéisme, ramené aux terme « moushrikin », c’est la notion d’étranger
incluse dans le terme païen qui provoque l’injustice. Le Coran oppose à
l’injustice le rappel que Dieu est le Dieu de tous les hommes, et pas le Dieu
d’un peuple comme … les divinités païennes. Un monothéiste ne peut parler
d’étranger comme d’une catégorie sérieuse. Dans le morceau suivant, le Coran
ramène le terrain sur ses thèmes propres : le respect de l’engagement
entre l’homme et Dieu, la « taqwa ».
[1] Ce qu’ont bien saisit les traducteurs. M. Hamidullah
traduit encore par « gentils », Berque par « inculte », Mason par « infidèles
».
[2] C’est effectivement écrit à de nombreuses reprises, dès
le Lévitique. Citons Actes 10:34-35 : « Alors Pierre, ouvrant la
bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de
personnes, 35 mais qu’en toute nation celui qui le craint et qui pratique la
justice lui est agréable », le texte préfère déjà la justice et l’attitude
correcte qu’il oppose à une préférence ethnique. Et c’est écrit chez Jacques,
chez Pierre, chez Paul. Déjà dans le Deutéronome, les Psaumes et dans les
Proverbes. Le lien entre injustice et lecture mensongère est déjà posé en
Romains 1:18 « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et
toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive ».
Ainsi la critique coranique adressée aux juifs et aux chrétiens n’est pas nouvelle
mais s’inscrit en continuité du Livre.
[3] Romain 3.29. Le Coran retient ce point chez Paul, mais
pas l’abandon de la loi. Au contraire de Paul qui prônait l’abandon de la loi
pour toucher les nations, le Coran propose une loi simplifiée pour tous,
s’appuyant sur la Torah qui demande une loi identique pour l’étranger et pour
les fils d’Israël, voir même pour la « multitude mixte » sortie
d’Egypte. Voir également Isaïe 56.
[4] Dans le Coran, le terme « قَوْمِ »,
construit comme goy sur la notion de « lever », traduit le terme {גוֹיִם, ἔθνη,
ܥܲܡܡܹ̈ܐ} avec sa
dimension religieuse, positive ou négative. Voir par exemple مُوسَىٰ
لِقَوْمِهِ, لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ, الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ. Il n’existe
pas au pluriel.
[5] Noter la neutralité du terme, par exemple en 6.38, 7.38
ou 11.48.
[6]
Qui semble ne pas avoir d’équivalent en français. Peut-être « les
gens », trop vague. « The people » en anglais.
[7]
Le Coran utilise au contraire les termes « kafirin »,
ceux qui recouvrent la vérité, ou « moushrikin »,
ceux qui associent, qui concerne directement des attitudes et des pratiques et
s’affranchit de la notion d’appartenance. C’est l’action d’une personne qui la
définit.
[8]
Ce qui pose la question, l’avait-il dans la Bible et s’agit-il d’une abrogation
coranique ? Ou bien il faudrait revoir son sens dans le texte biblique et
il s’agirait d’une correction des interprétations.
[9]
Noter la reprise en 16.120 ( إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ
كَانَ
أُمَّةً
قَانِتًا
لِلَّهِ
حَنِيفًا
وَلَمْ يَكُ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ) de Genèse 18.18 (וְאַ֨בְרָהָ֔ם
הָי֧וֹ
יִֽהְיֶ֛ה
לְג֥וֹי גָּד֖וֹל
וְעָצ֑וּם
וְנִ֨בְרְכוּ
ב֔וֹ כֹּ֖ל
גּוֹיֵ֥י
הָאָֽרֶץ)
Le passage central (81-85) Croyons dans tous les messagers d’Allah
Le passage est comme
le premier composé de deux parties parallèles et d’une sentence centrale.
La première partie relate
l’engagement pris des prophètes de toujours supporter les messagers qui les
suivent.[1]
En parallèle de cette solidarité entre les prophètes qui transmettent la parole
de Dieu, la seconde renouvelle la demande aux humains de croire dans l’ensemble
de la révélation et de ne pas différencier entre ceux-là. C’est Dieu qui envoie
le message aux prophètes, et c’est Dieu qui demande aux humains de les recevoir.
Être musulman c’est « ne faire aucune différence entre les messagers »
(v.84), les deux parties externes se terminent sur le même segment : s’écarter
de cette position, c’est suivre une autre voie que l’Islam, c’est faire partie
des perdants. La partie centrale est une extension de ces derniers segments,
poussée, par la proposition naturaliste au centre, à tout le contenu de l’univers
: comment peut-on suivre une autre voie que vers Dieu alors que tout revient finalement
vers Lui ?
L’ensemble rend
futile la distinction entre les messagers. Ils n’ont pas d’autorité en soi, Allah
leur ordonne dans la première partie, Il est leur Seigneur dans la seconde. Surtout,
au-delà des messagers, Allah est l’origine des messages, et la fin de toute
chose. Comme Abraham, l’homme est placé face à l’univers, au centre rhétorique de
toute la séquence : « Et vers Lui se dirige qui dans les cieux et la
terre » et à travers l’univers face à Dieu, fin de toute chose.
Les messagers sont solidairement
l’expression de Dieu, quelle différence parmi les groupes humains tient face à
ce témoignage ?
[1]
Des exemples sont déjà connus du peuple du Livre. On se rappellera Samuel qui
désigne David, mais surtout de Jean le baptiste qui prépare la venue de Jésus. Il
y a également tout un jeu de prophéties qui annoncent le Messie ou un prophète
à venir, dont Jésus puis Muhammad se réclameront.
B’ (86-92) Problématique des dénégateurs
Le passage traite
des personnes « qui recouvrent la vérité après avoir cru »,
expression qui ouvre les deux parties parallèles. L’une sur la malédiction ici-bas
à l’exception d’un reste qui reviens vers l’alliance[1], l’autre sur le
sort après la mort de ceux qui meurent en rejetant la foi. Le passage parle du
peuple du Livre, qui en même temps témoigne pour Dieu, et en même temps
recouvre les versets.
On remarquera dans
la première partie le terme « salaire » avec une forte connotation
négative, puisqu’il s’agit de l’opprobre générale, et dans la seconde un
passage sur les richesses qu’on n’emmène pas dans la tombe. Outre le lien entre
les deux, c’est évidemment un rappel du dinar, et du vil prix contre lequel la
foi était échangée, dans le passage 69-80, parallèle à celui-ci. La vertu n’étant
accessible que par le don de ce qu’on aime, rappelant le parallèle avec la miséricorde. Le
passage B (69-80) représentait la critique d’une attitude, reprise ici dans ses
conséquences. Cependant les deux parties finissent ici sur une tonalité
positive faisant intervenir Dieu et la miséricorde, qui s’oppose au vers
77 du passage 69-80, quand Dieu ne « purifiait pas » (« لَا
يُزَكِّيهِمْ »).
On notera au début
du premier passage le parallèle entre « un peuple qui recouvre la vérité
(…) après que lui soient venues les explications » et « Dieu ne guide
pas un peuple … ». L’apparente indécision sur l’acteur (Dieu ou le peuple)
se résout d’elle-même : si quelqu’un rejette le guide, il n’est pas guidé.[2]
Deux attitudes
positives encadrent ce passage très critique : témoigner en faveur du
messager et partager de ce qu’on aime. Comme l’ « envie entre eux »
la course aux richesses est présentée comme une influence sur la religion, qui
fait oublier les principes. Le passage se présente donc comme un avertissement,
avec une tonalité très négative, et une porte de sortie.
[1]
Dans le Coran, un reste est toujours mis à part des groupes critiqués, en
général indiqué par la proposition « sauf ceux qui croient et font les
œuvres salutaires ». Noter «وَأَصْلَحُوا » ici qui rappel « as
salihat ».
[2]
Cette solution est aussi indiquée dans la sourate al nahl. Ceux qui rejettent
le message ne sont pas guidés.
A’’ (93- 97) Suivons le culte d’Abraham
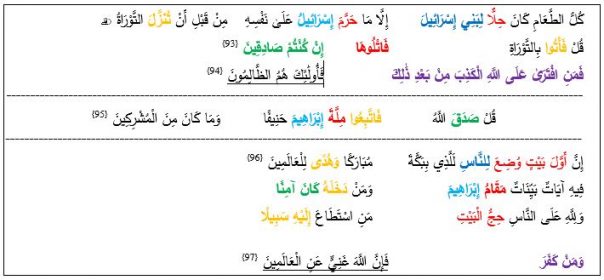
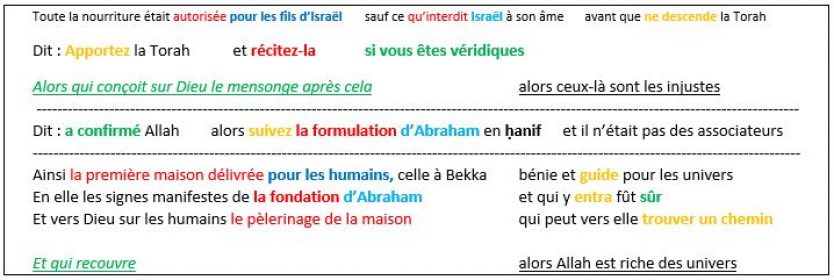
Précédent
Suivant
Passage passionnant et
intraduisible. Deux pratiques, deux mouvements, deux moments de la révélation
monothéiste gravitent autour d’Abraham. D’un côté les interdits alimentaires,
et surtout la descente de la Torah qu’il faut amener, réciter. De l’autre la
maison d’Abraham, vers laquelle il faut se diriger et entrer. Le mensonge est rendu
inopérant dans les deux derniers segments des parties externes. La Torah et la
confirmation divine dans la partie centrale sont des vérités qui l’éclipsent. Comme
dans les passages parallèles A et A’, les verbes de mouvements sont omniprésents
et structurant. La Torah est descendue et apportée dans la première partie. La
maison est un guide, vers lequel on trouve un chemin pour y entrer. Apporter la
Torah et entrer dans la maison, c’est « suivre » Abraham, dans le
morceau central, qui ramène ensemble les deux pratiques, validées par Dieu, qui
demande de suivre en celles-ci « la doctrine d’Abraham en ḥanif ».
La première partie pose un
problème bien connu : à quels interdits alimentaires étaient voués les
prophètes avant Moïse[1].
Par exemple Abraham et son petit-fils Israël ? Il répond
partiellement : Dieu n’a rien interdit. Israël a pu cependant s’interdire
de lui-même. Sans détailler, le Coran pointe par cet exemple l’aspect
contingent de ces interdits. Ce qu’il reste, la vraie nourriture, c’est la
Torah.
La troisième partie propose une seconde pratique. La
maison (al bayt) est « délivrée », c’est un accouchement[2], un
accomplissement. Dans le segment suivant, la forme VI de Maqâm indique un
événement collectif : le lieu que l’on a « érigé », rappelant « رْفَعُ ,élever ». Cet
aspect fondateur de l’action d’Abraham – et de sa reconnaissance divine – en font
un signe, qui justifie qu’on s’y dirige[3].
Désormais un pèlerinage, au-delà de la maison, c’est la fondation de la maison
par d’Abraham qui est la destination, le guide. Il y a plus qu’une maison ici.
Celle-ci est un signe matériel de l’alliance, la promesse faite à Abraham dans
le chapitre 16 de la Genèse :
« 3
Alors Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, et lui dit: 4 Pour moi,
voici, mon alliance est avec toi et tu deviendras père d’une multitude
de nations (goyim) . (…) 10 Voici mon alliance que vous garderez,
et qui sera entre moi et vous, et ta postérité après toi: (…) A l’âge de huit
jours tout mâle sera circoncis (מול de מל, comme מלל
[4])
parmi vous, dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison
que celui qui, acheté à prix d’argent de quelque étranger que ce soit, n’est
point de ta race; (…) 23 Et Abraham prit Ismaël son fils et tous
ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu’il avait achetés de
son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d’Abraham; et il
circoncit leur chair en ce même jour-là, comme Dieu le lui avait dit. »
La « maison pour les
humains » c’est la maison d’Abraham, sa famille ET les étrangers. C’est la
circoncision qui est un retrait de l’amour du monde vu dans le passage
précédent, étrangement liée à la racine « ML », comme « milat ».
Ce sont les nations, et maqâm est l’établissement de la nation d’Abraham (qaoum
Abraham) qui devient dans le Nouveau Testament et le Coran la communauté
d’Abraham (oummat Abraham)[5].
C’est aussi une position prise : l’alliance, l’engagement. Entrer dans la
maison d’Abraham, c’est entrer dans l’alliance avec Dieu.
Des deux côtés, l’action est faite
par l’homme, qui est validée ensuite par Dieu : les interdits alimentaires
d’Israël, la maison d’Abraham. D’où le « صَدَقَ
اللَّهُ » central : Dieu a vérifié, validé, confirmé. Milat
Abraham, renvoie ici à la « récitation » de la Torah, qui contient, dans
la Genèse, l’histoire d’Abraham. Le terme rappelle aussi le terme hébreu pour
la circoncision, qui est le symbole de l’Alliance. Elle se retrouve dans les
deux parties externes. D’un côté l’homme, Israël, récite[6] la Torah, de
l’autre, Ismaël construit la maison. La foi et les œuvres. D’où peut-être la « formulation »
de la religion, théorique et concrète, l’établissement d’un pays en devenir et
de son peuple, figurés par la maison d’Abraham, que tout croyant est appelé à
rejoindre. En ḥanif, c’est-à-dire en quittant ses propres déterminations
sociales pour rejoindre la communauté d’Abraham et entrer dans sa maison.
On arrive à un nouveau palier de
sens pour ḥanifan, qui valide ce qu’on a vu jusqu’à présent. L’aspect
non-dénominationnel, non-ethnique, de la religion arrive à maturité. L’alliance
non seulement inclue les étrangers, dans une référence continue à la Torah, elle
passe explicitement des « fils d’Israël » à « pour l’humanité »,
à travers la promesse faite à Abraham. Le terme « des univers » corrige
l’expression rabbinique « oum al 3alamein » en montrant l’aspect
universel de Dieu lui-même. Un élément contextuel s’ajoute. L’action d’Abraham
diffère des autres : il ne copie pas ses ancêtres, n’accomplit pas
l’écriture. Abraham « bâtit » la maison. C’est le moment fondateur de
l’alliance, un acte indépendant fait pour Dieu. Nous avons ici l’expression « Milat
Ibrahim ḥanifan ». La religion d’Abraham comme acte positif, originel,
entendu comme une action fondatrice, un nouveau commencement de l’histoire
humaine.
[1]
Dans la Torah la viande est autorisée, sans le sang, depuis Noé. Il y a déjà
des animaux dit impurs dans l’arche. Sont-ils licites ? Le passage suggère
qu’Israël s’est déjà interdit des aliments. Historiquement, les sémites émigrés
à Avaris en Egypte entre 1750 et 1450 semblent déjà avoir le tabou du porc, qui
restera un marqueur archéologique visible par la suite.
[2]
Qui rappel la notion apocalyptique du terme dans le nouveau Testament. La terre
promise, la nouvelle Jérusalem sont déjà dans la maison élevée par Abraham.
[3]
Noter en particulier la différence avec l’habituel : ce n’est pas Dieu qui
fait, c’est Abraham. Les occurrences de rafa3 : c’est toujours Dieu qui
élève, même Jésus, même Muhammad. Abraham est la seule exception : c’est
lui qui élève la maison et Dieu la bénie. Ici maqâm Abraham, l’édification
d’Abraham concerne la maison, et surtout la posture qu’il adopte, comme les
occurrences du terme en 10.71 et 14.14.
[4]
Pour les racines bilitaires comme fondement des mots sémitiques, voir « Pour
une théorie lexique des langues sémitiques », ENS, Paris.
[5]
On remarque que l’hébreu « oum al 3alamein », les peuples du monde,
devient l’humanité devant un seul « Seigneur des univers ».
[6]
Recite, est l’action en réponse de ymll, dicte. On peut se poser la question du
lien avec milat.
Conclusion de la première partie.
Les occurrences de Ḥanifan et ²oummyin dans
les sourates Al Baqarah et Al Imran permettent une première approximation assez
cohérente. Le contexte narratif reste le même : la fondation de la maison
par Abraham et Ismaël, support de la critique des peuples du Livre et d’une
refondation du monothéisme. Les deux termes s’inscrivent dans la critique de l’ethnicisation
des religions précédentes, provoquant injustice, attitude sectaire et conflits
d’intérêts. Le tout les éloignant irrémédiablement du témoignage -impartial- et
du chemin vers Dieu.
La redéfinition coranique des termes Ḥanifan
et ²oummyin porte cette critique et sa solution. Le premier est repris dans son
sens commun – ne pas appartenir aux religions établies – et lui donne une
dimension active : la capacité à dépasser sa culture, sa religion. Sa mise
en relation progressive avec musulman indique le but et le moyen de ce
dépassement : mettre les choses en regard du Dieu unique, transcendant, pour
retrouver leur sens au-delà des contingences, des intérêts immédiats et des
idéologies, et se diriger vers Lui. Le choix de ²oummyyin porte un sens
similaire, ce sont les autres vu en tant que tels, et plus par une désignation
ethnique, moralisante et négative. Comme si l’attitude « hanifan » de
travail sur sa propre culture nettoyait en même temps les préjugés.
Cela accompagne une refondation du
monothéisme sur ses bases, l’extension du droit à l’étranger, son inclusion
dans l’Alliance, le devoir de solidarité porté par l’expérience de la
persécution. Le Dieu unique étant le Dieu de tous. Cette refondation est à la
fois cohérence radicale avec l’élan initial et sa finalisation historique, dans
le prolongement de l’expérience chrétienne. Le texte s’appuie à la fois sur l’histoire
d’Abraham dans la Genèse et la fondation de l’alliance – à travers Ismaël -,
les lois de la Torah et le livre des actes construisant en théologie et en acte
la conversion des nations. Les descendants d’Ismaël, par Muhammad, arrivent
dans l’alliance en y ramenant tous les peuples, universalisant le monothéisme en
le ramenant à ses fondements, non associateur. « Ḥanifan » est « non
associateur », relation qu’il faudra interroger. La maison d’Abraham,
nouvelle Qiblah et lieux de pèlerinage, sert figurativement de nouvel engagement
entre Dieu et les hommes. Entrer dans cette maison, c’est rejoindre la
communauté des croyants, le reste de toutes les nations, à la recherche d’un
nouveau pays. Aussi bien à un reste parmi les peuples
du Livre, appelés à quitter leurs structures politico-religieuses, qu’aux
« ²oummyyin », les membres de tous les peuples, rétablis sur un pied
d’égalité. C’est l’invitation inclusive formulée dans les versets 20 et 64, qui
fonde une communauté de foi, ouverte à tous.
Voilà pourquoi Ḥanifan semble préciser
un « croyant originel » ou une religion « pure » de toute dérive
religieuse. C’est le mouvement original de sortie du religieux et de fondation
d’un monothéisme, qui n’est pas encore fossilisée en une réalisation historique
compromise et contingente. D’où le sens traditionnel de pure ou originel, qui
nous parait autant justifié qu’incomplet. Dans un contexte où le christianisme
s’est assimilé à des empires, dont les limites entre systèmes politiques,
culture et frontières deviennent floues, le modèle
« hanifan musulman » proposé par Muhammad ouvre la possibilité d’un
monothéisme qui s’affranchisse de ces contingences historiques, capable de les
dépasser. Ḥanifan porte en lui le mouvement qui s’échappe des
compromissions historiques du monothéisme avec l’histoire humaine pour
reformuler la religion et rappeler ses bases théologiques. Ainsi le
remplacement de « polythéistes » par « associateurs »,
définit la position coranique. Dans un monde ou le monothéisme s’est imposé[1],
le Coran propose une nouvelle distinction : l’opposition entre des monothéismes
syncrétiques, ethnico-religieux ou politico-religieux, qui s’imposent dans la
religiosité de la fin de l’antiquité, et un monothéisme strict, qui ne peut se
faire qu’en transcendant le religieux existant. Muhammad reprend donc le
dépassement du religieux par lui-même, comme Jésus l’avait fait avec le
judaïsme, et Abraham avec le polythéisme. De fait l’Islam s’est facilement
installé sur toute la bordure des empires, où s’étaient installés le reste des
groupes judéo-chrétiens en exil, dans toute leur variété : nazaréens,
ébionites, ariens, monophysites, nestoriens, jacobites et autres, en conflit
avec les christianismes impériaux.[2]
C’est le renouvellement de l’exode, la sortie d’Egypte d’une multitude mélangée,
à l’époque de Rome et Byzance, vers une nouvelle terre promise, le pèlerinage
vers la maison élevée par Abraham et Ismaël.
Pour en établir une généralisation
anthropologique « ḥanifan musulman » c’est sortir d’une
religion comme appartenance communautaire, par la foi en un Dieu unique qui
transcende les peuples et les systèmes politiques, en conférant à l’homme une
indépendance critique par rapport à son environnement culturel. Cela nous
semble confirmé par l’histoire d’Abraham qui quitte sa communauté de croyance
pour suivre un Dieu transcendant. L’Islam du Coran n’est pas encore la
tradition religieuse d’une communauté, mais le questionnement des constructions
sociales mise en perspective, au fur et à mesure de leur élaboration, par un
Dieu transcendant. Si « musulman » indique Dieu comme un référentiel permettant
de comprendre au-delà des contingences, « hanifan » prend le sens de
la capacité d’Abraham à sortir de, à dépasser les systèmes culturels. Le
rassemblement vers la maison qu’a établi Abraham, le rassemblement d’ahl al bayt, le peuple de l’Alliance, vers le pays que
recherche Abraham, un perpétuel « non encore » qui est la vraie
patrie de l’humanité, l’engagement réciproque de Dieu et des hommes.
Nous avions cité plusieurs
chercheurs européens dont les travaux respectent le Coran dans sa perspective
critique des livres bibliques. C’est cependant la définition de ḥanifan par Angelika Neuwirth, qui nous semble arriver au résultat
le plus proche de l’étude des trois premières occurrences. Elle voit bien le
sens « non établi » et « indépendant » de hanifan, qu’elle
met en regard de la même définition de ²oummyyin, et de l’arrivée de Muhammad
comme prophète des peuples. Cependant elle manque la dimension radicalement
critique des termes, et nous verrons lors de la prochaine partie que le terme
prend d’autres dimension, qui à mon sens n’ont pas encore été remarquées.
[1] Et
ce même en Arabie, comme le montre les travaux de Christian Robin.
[2] La
tradition musulmane à son tour a perdu cette notion critique, en pensant
l’Islam comme un passage du polythéisme au monothéisme, et plus comme un
renouvellement de l’intérieur du monothéisme, critique de sa transformation en
système culturel et politique, ethnique. Critique qui sera forcément
contradictoire avec l’établissement d’un nouvel empire musulman, qui reviendra
à deux oppositions morales plus confortables, polythéisme vs monothéisme des
arabes, et religion du Livre contre religion « pure ». Oppositions morales, qui
sortent l’Islam réel, historique, du champ de la critique, et lui permettra de
dévier à son tour.
Le résumé d’Angelika Neuwirth nous semble valoir la peine d’être présenté, vous en trouverez un extrait ci dessous.


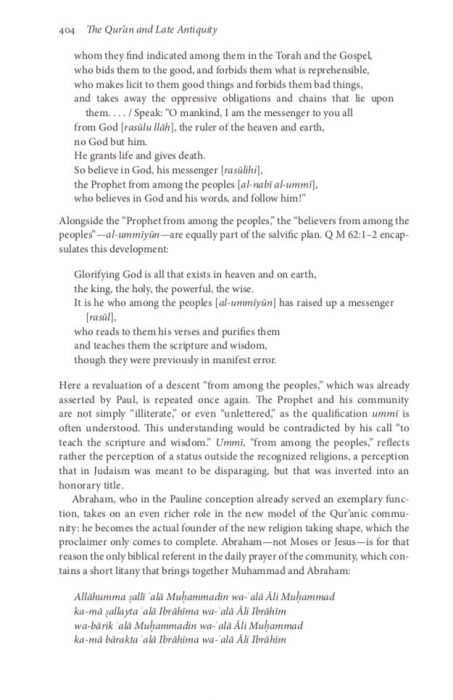

Précédent
Suivant
L’étude des termes Ḥanifan et Oummyyoun dans leur contexte
Nous partageons certains présupposés de la thèse du Dr Al-Ajmi sur l’établissement d’un sens littéral du vocabulaire coranique[1]. L’intérêt certain de sa méthode est d’engager la recherche du sens propre au Coran du vocabulaire utilisé. Si le vocabulaire et les thématiques du Coran ont existé avant lui dans les cultures environnantes et ont continué à être développé ensuite, y compris dans la tradition musulmane, il importe en premier lieu de pouvoir en établir une analyse diachronique : déterminer en contexte quel sens le Coran donne aux termes qu’il emploie.
L’analyse rhétorique a montré la régularité et la systématique de la structure du texte, comment celle-ci construit le sens et induit la réflexion du lecteur. Nous proposons d’utiliser l’analyse rhétorique pour révéler l’articulation de chaque terme avec la structure d’ensemble dont il est partie pour en déduire leur sens dans chaque contexte. Le vocabulaire, la structure et le sens sont un même mouvement, que nous étudierons dans son unité grâce à l’analyse rhétorique. Nous montrerons que le choix coranique du vocabulaire est pensé et que sa mise en relation avec les autres termes via la structure participe à lui forger un sens nouveau.
Il nous importe d’adopter une intentio recta[2] dirigée vers le texte, et d’élaborer une approche qui repose sur les caractéristiques du texte lui-même, ce que fait l’analyse structurale de la Rhétorique sémitique et qu’Al Ajmi appel lui approche littérale. En se méfiant de l’intentio obliqua d’approches parfois trop érudites, qui reposent sur des symboliques et des herméneutiques qui leurs sont propres, et dont les fondements sont d’autres moments de la culture humaine. On pensera bien entendu à la tradition, qui s’est construite sur une, comme une, interprétation particulière du texte. Dont la signification serait définitivement fixée, limitée, par les paraphrases des premiers commentaires. Et qui est donc historiquement située et contingente. Ou encore l’écueil d’une lecture syrianisante[3], hérétisante[4], du Coran, qui interdirait à ce corpus toute réflexion qui lui serait propre.
Pour situer le texte dans l’histoire, pensons à la grammaire. Si le Coran est bien une expression de la langue arabe à un temps donné, il en est également l’événement fondateur. Si le Coran a indubitablement un sens propre et ne peut pas être réduit à un simple lectionnaire hérétique constitué de termes chrétiens dérivés, il ne peut pas non plus être réduit à un événement indépendant, anhistorique, relevant volontairement ou non de la théorie d’un Coran incréé[5].
Une fois établi par le sens littéral le moment que fonde le Coran, nous pouvons ensuite dans un second temps, établir à nouveau frais les relations de celui-ci avec son contexte culturel antérieur et postérieur. Outre Moreno, certains chercheurs travaillent déjà selon ces principes sans les avoirs formulés explicitement. Nous pensons en particulier à Geneviève Gobillot, Holger Zellentin et Emran El Badawe[6] dont les approches comparatives des textes reposent sur une séparation des moments historiques et une inscription du Coran dans l’histoire du monothéisme. Une certaine éthique du respect du texte et de l’objectivité du travail scientifique leur permet déjà d’entrevoir et mettre à jour des rapports complexes[7].
Ces approches restent toutefois perfectibles. Y compris celle du Dr Al-Ajmi. Nous apportons une critique sur la forme prise par sa démarche, en ce qu’elle manque à la fois de l’aspect historique de la révélation coranique et d’une méthode exégétique proprement indépendante pour l’étude du contexte. Ainsi chez lui l’étude d’un mot passe directement de l’étude syntaxique de la phrase qui le contient à l’interprétation traditionnelle de la sourate dans son ensemble. Le rapport des parties au tout sur laquelle repose sa démarche est ainsi. Le tout (la sourate) n’est pas étudié indépendamment avant d’y insérer la partie (la phrase extraite). L’étude du rapport tout et partie est aux mieux intuitif, n’ayant
pas proposé d’étude de l’articulation entre les deux. Le flou de la symbolique sémantique, sortie par la porte grâce à la rigueur d’une approche holistique des occurrences, commentaire du Coran par lui-même, est revenue par la fenêtre du flou sur le sens général. A posteriori, l’ensemble du travail du Dr Al Ajmi recouvre largement une herméneutique française moderne, historiquement située, qui à ce titre peut difficilement prétendre être issue directement du texte. A moins d’expliquer en quoi le Coran a formé la France du XXIe siècle, ce
qu’évidemment, et heureusement, il ne fait pas.
Al-Ajmi connait pourtant les travaux structurels de Michel Cuypers, dont il rejette la démarche. Or l’analyse rhétorique nous semble justement apporter les outils qu’il nous manque pour lier les mots à leur contexte immédiat et à leur place dans l’élaboration du sens des sourates dont ils font parties. Cette méthode, issue de longues recherches sur la structure du texte biblique, fonctionne parfaitement avec le Coran comme l’a montré Michel Cuypers sur une longue sourate et des ensembles de petites sourates.[8]
On peut légitimement supposer aujourd’hui qu’elle permettra de révéler toute l’articulation du texte entre les mots utilisés et le Coran dans son ensemble. Issue de l’étude du texte par et pour le texte, spécifique au monde sémitique, cette méthode répond certainement à notre exigence d’une intentio recta, en vue d’une étude structurelle et ontologique du texte coranique. Il lui manque peut-être encore d’avoir délimité les spécificités structurelles du texte vis-à-vis du texte biblique, bien que Michel Cuypers ai déjà posé quelques éléments de cette différence.[9]
Nous montrerons l’intérêt de la méthode d’analyse de la rhétorique sémitique pour supporter l’établissement du sens du vocabulaire coranique, en ce qu’elle permet pour chaque occurrence d’un terme d’établir le réseau de lien qui le lie au texte. Elle permet plus de précision que la simple grammaire dans la perception des sens induits par la structure syntaxique, une précision accrue de l’interprétation directement induite par le texte, qui nous libère du résumé exégétique présupposé du contexte. La rhétorique sémitique permet d’articuler de façon adéquate le terme avec sa phrase, la phrase avec son paragraphe, et celui-ci dans l’ensemble. Ainsi l’on se débarrasse des relations hasardeuses entre le terme et le sens supposé de la sourate, pour déterminer une place précise dans la construction du sens. La place du terme dans la structure étudiée permet d’encadrer rigoureusement le sens de celui-ci.
Nous pensons que les 2 méthodes proposées se complètent mutuellement et que la recherche des occurrences coraniques d’un terme dont le sens n’est pas certain est un préalable à sa compréhension dans le contexte d’une structure. De plus, nous remarquons par expérience que la recherche des occurrences permet de dégager des parallélismes entre structures qui vont faciliter et enrichir l’analyse rhétorique. Les deux méthodes sont liées in fine : des expressions récurrentes, qu’il s’agisse de mots, d’expressions ou de versets, ont très logiquement des places correspondantes dans différentes structures liées, ouvrant des perspectives sur la structure fractale du Livre[10].
Nous utiliserons donc la méthode d’analyse de la rhétorique coranique développée par Michel Cuypers pour compléter la méthode du Dr Al-Ajmi et étudier dans leurs contextes les termes « ²Oummyyin » et « ḥanifan », établis par la tradition comme signifiant « ignorant » et « pure ».
Nous montrerons la relation qui imbrique ces deux termes dans le texte coranique, à travers une réflexion sur les communautés religieuses existantes, le mouvement initial impulsé par Abraham et le rôle de Muhammad comme prophète pour l’humanité. Ainsi, un parallèle construit à bas niveau entre deux termes forme des ensembles de sens, qui à leur tour forment la théologie coranique.
Dans un second temps, après l’analyse sémantique à proprement parler, nous montrerons que l’évènement coranique prend place dans l’histoire humaine, dans le milieu du proche orient de l’antiquité tardive, et dans l’histoire de l’argumentation des débats monothéistes. Que c’est face à ceux-ci qu’il établit sa propre place, comme fondation d’une nouvelle religion. Nous essaierons de nous inscrire dans la ligne des chercheurs susnommés qui ont su à la fois apporter leur connaissance précise du contexte culturel environnant la révélation coranique et faire sens des remaniements opérés par le texte coranique, démontrant l’indépendance critique de celui-ci envers son environnement culturel.
Du point de vue de la méthode, il nous parait adéquat d’étudier ensemble la structure et le sens, la critique des peuples du Livre et l’intertextualité (le rapport aux textes précédents), l’intertextualité et le vocabulaire emprunté. Ce sont des relations dialectiques avec lesquelles le Coran joue et qu’il rassemble en un tout cohérent, pour former son message. Ainsi les emprunts seront étudiés conjointement avec l’intertextualité et le sens de la structure. Nous montrerons qu’il s’agit toujours d’emprunts volontaires, portant parfois une reformulation du sens conjointement avec une volonté de correction (« naskh ») des textes bibliques : correction de leur interprétation, qui est parfois un retour à leur sens littéral ou d’autre fois une reformulation, une généralisation, de celui-ci.
Comprendre le terme « ḥanifan », c’est comprendre la critique que le Coran fait des cultes juifs et chrétiens et le modèle qu’il propose par cette critique. D’où notre méthode, qui recherchera le sens par son articulation à la fois structurelle et sémantique avec cette critique, qui est toujours le contexte immédiat du terme. Par cette critique le Coran se fixe un but : résoudre les contradictions des religions précédentes. Il se donne pour cela deux contraintes : inclure Abraham et son orientation comme point de départ, formuler une cohérence qui englobe tout le corpus monothéiste. Le moyen qu’il se donne est un monothéisme strict,
qui met tout en regard de Dieu. Le modèle Abrahamique, au fur et à mesure de son développement, va construire le sens de « ḥanifan » [11].
[1] Cyrille Moreno Al Ajmi, « Analyse littérale des termes dîn et
islâm dans le Coran : dépassement spirituel du religieux et nouvelles
perspectives exégétiques ». Sous la direction de Éric Geoffroy. Soutenue
le 29-09-2016 à Strasbourg, dans le cadre de l’École doctorale Humanités. Disponible en ligne http://www.theses.fr/2016STRAC042/document
[2] Nicolai Hartmann base le réalisme de son ontologie sur le principe d’intentio recta. Considérer l’objet pour lui-même, contra intention obliqua : considérer l’objet comme il est accessible dans la pensée. Nous essaierons de préserver l’intentio recta, l’orientation vers la réalité dans son autonomie ontologique, ici le texte lui-même, de l’intentio obliqua, l’attention dirigée vers la réflexivité de la conscience, qui chercherait à comprendre le texte via des présupposés qui lui sont potentiellement étrangers.
[3] Dans les cas extrêmes les thèses de C. Luxemberg.
[4] Il est symptomatique que la recherche sur les liens entre Coran et les
différents courants du christianisme primitif, nazaréens, ébionites, … soit
systématiquement considérés par le biais de l’influence. Sans jamais à notre connaissance poser la question du lien dans son sens inverse : une
préférence pour les nazaréens parmi les autres courants chrétiens, voir même une validation faite d’autorité, même partielle, a posteriori. Qui s’exprimerait entre autres par le choix judicieux de l’appellation originelle pour désigner l’ensemble du mouvement. On peut certainement lire dans les deux sens la relation entre judéo-christianisme, critique coranique des peuples du Livre, et choix paradigmatiques du Coran (unicité de Dieu, humanité de Jésus, place de la loi). A minima on pourra dire qu’une influence est toujours choisie parmi d’autres, et qu’on ne peut parler d’influence sans expliquer les raisons de ce choix.
[5] L’opposition indépassée entre un Coran créée et incréé dans les
premiers siècles de l’Islam ramène à celle actuelle entre les démarches
ontologiques et structurales, dont les approches littérales et rhétorique
mentionnées ici semblent être les archétypes dans le domaine de la recherche textuelle sur le Coran. Nous opposerons que le Coran lui-même inscrit l’action humaine dans l’histoire, cf notre analyse de la sourate Al Naba, P17-20.
[6] Nous pensons bien sûr à l’excellence et l’audace des analyses
intertextuelles de Geneviève Gobillot, qui introduit ainsi l’une de ses
nombreuses interventions ‘’’. Mais aussi au remarquable petit livre de Holger Zellentein qui marque la proximité culturelle du Coran avec le milieu judéo chrétien de la Didache ET l’approche indépendante de celui-ci. Pour ce qui est de l’influence syriaque, El Badawi … outre une riche introduction, montre à travers la reprise du vocabulaire des parallèles justifiés et critiques du Coran vers les évangiles.
[7] Pensons à Kant qui base la rationalité de l’éthique sur la prise en
compte de l’autre comme une fin en soi et pas comme un moyen, comme un guide pour la recherche scientifique à considérer l’objet étudié en soi, et pas seulement à travers nos propres médiations, nos propres herméneutiques. L’éthique du chercheur qui définit le Coran comme objet de sa recherche doit consister à considérer comme un texte en soi, au-delà des visions culturelles afférentes. Considérer le moment particulier du Coran dans l’histoire humaine.
[8] Michel Cuypers, « Le Festin », Lethelieux, Paris 2007.
« Une Apocalypse coranique », Gabalda, Paris, 2014.
[9] Michel Cuypers, « La Composition du Coran », Collection «
Rhétorique sémitique » n°9. Gabalda, 2012
[10] La rhétorique coranique révèle une structure fractale, dont les formes de bas niveaux, au niveau des phrases, forment de nouvelles formes organisées de plus haut niveau, des paragraphes qui a leur tour forment des partiesn, des sourates, puis le livres entier comme structure d’ensemble.
[11] Nous entendons par là le développement textuel, au fîl des pages, et
non pas chronologique. L’analyse rhétorique travaille sur le texte final et pas sur son élaboration, ni la chronologie, encore incertaine, de la
révélation.
Plan de l’étude
L’étude se divisera en quatre parties, découpées selon les 12 occurrences, assez régulières, du terme ḥanifan. L’apparition dans une sourate est suivie d’une double apparition dans une sourate ultérieure. Ce modèle se répète, semblant même inclure les 6 occurrences du terme « ummiyyūna ». La dernière partie de notre étude, dans les petites sourates, semble moins régulière, mais sera peut-être plus compréhensible une fois établie l’analyse de la structure globale du
Coran.
Cliquer sur l’image d’une partie pour accéder à l’article en ligne.
Seule la première est disponible à l’heure actuelle.
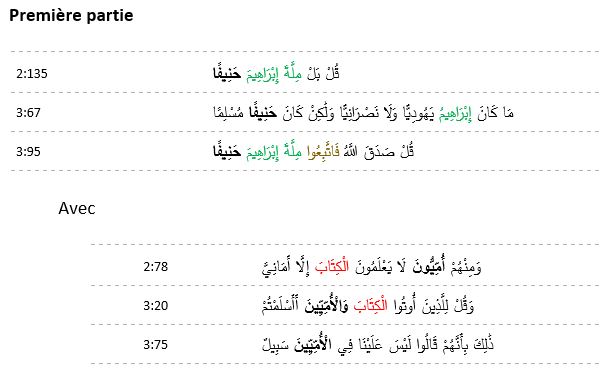
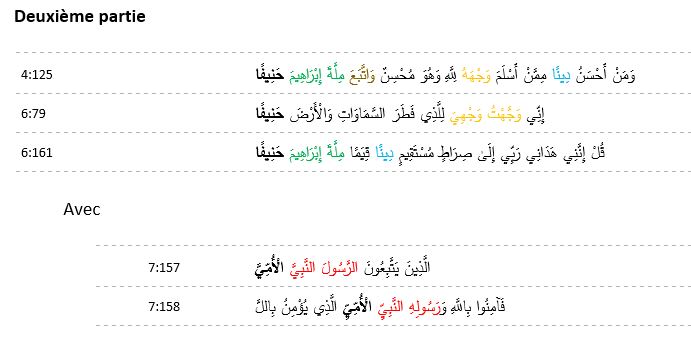
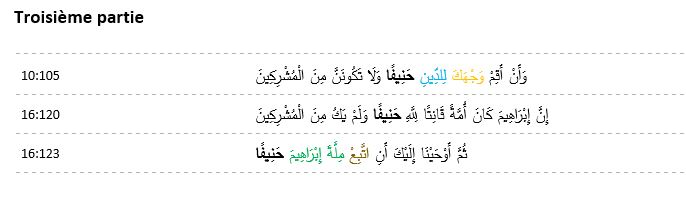
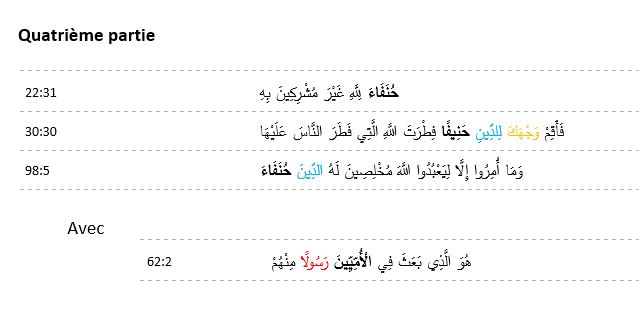
Abraham et les idoles
Nous proposons ici l’analyse rhétorique du passage du Coran où Abraham se confronte à la tradition religieuse de son peuple. La mise en œuvre de cette méthode nous permettra d’interroger en profondeur le Coran sur sa description de la religiosité et l’attitude particulière d’Abraham vis-à-vis de celle-ci. L’intertextualité, fruit sucré de la rhétorique sémitique, nous permettra d’éclaircir certaines formulations et de révéler un parallèle inattendu avec un texte de l’Evangile. Ce premier opus nous permettra d’introduire la quête d’Abraham, mettre à jour le questionnement anthropologique du monothéisme et soulever la question de Dieu.
Nous pensons que cette partie représente un passage indépendant, bien qu’il soit nécessaire d’attendre l’étude complète de la sourate afin de s’assurer du découpage, qui pourrait dépasser le verset 70. Ce texte est traduit ainsi par Hamidullah :
21.51. En effet, Nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin. Et Nous en avions bonne connaissance.
21.52. Quand il dit à son père et à son peuple: « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez? »
21.53. Ils dirent: « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant ».
21.54. Il dit: « Certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident ».
21.55. Ils dirent: « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu? ».
21.56. Il dit: « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c’est Lui qui les a créés. Et je suis un de ceux qui en témoignent.
21.57. Et par Allah! Je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis ».
21.58. Il les mit en pièces, hormis [la statue] la plus grande. Peut-être qu’ils reviendraient vers elle.
21.59. Ils dirent: « Qui a fait cela à nos divinités? Il est certes parmi les injustes ».
21.60. (Certains) dirent: « Nous avons entendu un jeune homme médire d’elles; il s’appelle Abraham ».
21.61. Ils dirent: « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu’ils puissent témoigner »
21.62. (Alors) ils dirent: « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham? »
21.63. Il dit: « C’est la plus grande d’entre elles que voici, qui l’a fait. Demandez-leur donc, si elles peuvent parler ».
21.64. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux: « C’est vous qui êtes les vrais injustes ».
21.65. Puis ils firent volte-face et dirent: Tu sais bien que celles-ci ne parlent pas ».
21.66. Il dit: « Adorez-vous donc, en dehors d’Allah, ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire non plus.
21.67. Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors d’Allah! Ne raisonnez-vous pas? »
21.68. Ils dirent: « Brûlez-le Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose (pour elles) ».
21.69. Nous dîmes: « ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire ».
21.70. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que Nous rendîmes les plus grands perdants.
Première partie
وَلَقَدْ
آتَيْنَا
إِبْرَاهِيمَ
رُشْدَهُ
مِن
قَبْلُ
وَ كُنَّا بِه
عَالِمِينَ
Et certes nous avions donné à ABRAHAM son chemin auparavant
Et nous étions de lui connaissant
Cette courte introduction place notre séquence parmi les autres récits des prophètes. « Nous avions donné » reviens en effet 5 fois successivement dans la sourate pour introduire l’histoire d’un prophète. Remarquons comment la même construction arabe, avec le même sens de don divin est traduite 5 fois différemment en français, alors que la répétition de ce terme est un indice précieux de construction, qui pourrait bien en délimiter les parties.
(21:48) Nous avons déjà apporté à Moïse et Aaron le Livre du discernement (la Thora) ainsi qu’une lumière et un rappel pour les gens pieux,
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ
(21:51) En effet, Nous avons mis auparavant Abraham sur le droit
chemin.
وَلَقَدْ
آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ
رُشْدَهُ
مِنْ قَبْلُ
(21:74) Et Loṭ! Nous lui avons apporté la capacité de juger et
le savoir,
وَلُوطًا
آتَيْنَاهُ
حُكْمًا
وَعِلْمًا
(21:79) Et à chacun Nous
donnâmes la faculté de juger et le savoir.
وَكُلًّا
آتَيْنَا
حُكْمًا
وَعِلْمًا
(21:84) lui rendîmes les
siens et autant qu’eux avec eux
وَآتَيْنَاهُ
أَهْلَهُ
وَمِثْلَهُم
مَّعَهُمْ
Pour Abraham, il n’est pas donné un savoir ou un livre, mais un chemin.
L’expression interpelle. Son chemin signifie-t-il la façon dont il vit sa vie,
une voie en tant que religion ? Dans le texte qui suit, et dont nous
allons faire l’analyse, le Coran donne en exemple une histoire du prophète.
C’est par ses actions, par une pratique, qu’Abraham est donné en modèle, dans
un acte fondateur, ayant pour but d’amener son peuple à réfléchir.
La première partie n’est composée que d’un seul segment de deux membres, qui sert d’introduction à tout le passage. Nous trouvons deux membres parallèles, construits autour de verbes dont Allah est le sujet et Abraham l’objet. Ces deux membres sont apposés par parataxe : le lien entre les deux n’est pas explicité, il n’est fait par la lecteur que par leur forme similaire. C’est ensuite parce que la structure est semblable, d’Allah vers Abraham, que nous pouvons observer une différence. Dans le premier Allah agit, il intervient pour Abraham. Dans le second Allah sait à propos d’Abraham. Les verbes qui construisent cette opposition se trouvent aux deux extrémités du morceau : donner et savoir. Abraham est au centre des deux propositions.
Dans un second temps, nous observons une structure en miroir :
– les verbes dont Allah est le sujet sont aux extrémités du passage, la narration en part pour y revenir
– les termes indiquant le passé sont au centre du passage, on y aboutit pour en repartir, ce passé marque l’origine de l’histoire racontée.
– Abraham est au cœur de chaque morceau, c’est de lui qu’on va parler. Son chemin est mis en valeur par l’absence de vis-à-vis. C’est l’objet principal du morceau.
Et certes Nous avions donné
à ABRAHAM son chemin (-hu)
Auparavant.
Et Nous étions
de lui (-hi)
Connaissant.
La simple superposition des termes se révèle une structure complexe, portant le sens : l’action divine est à l’origine de l’histoire qui se produit, elle a pour objet Abraham, et particulièrement « son chemin » terme énigmatique, qui ressort de l’ensemble.
La parataxe laisse au lecteur la possibilité de faire lui-même le lien entre ces deux membres. Le premier indique Allah et ce moment passé du don comme l’origine du chemin, de l’histoire d’Abraham. Le second donne une autre origine : la connaissance préalable qu’avait Allah d’Abraham. Par la mise en opposition de ces deux propositions, une tension est créée à propos de l’origine de ce qui va suivre. Que le lecteur est invité à résoudre par lui-même. Comme dans d’autre passages du Coran, il y a un parallèle entre la volonté divine et son accomplissement ainsi dans la sourate YaSin « Nous faisons sortir d’elle des grains » puis plus loin « de ce que la terre fait pousser ». Il n’y a que l’apparence d’un paradoxe, le texte propose au lecteur de suivre un chemin entre les deux propositions : C’est Allah qui a dessiné le chemin pour Abraham, et c’est connaissant Abraham qu’il lui a proposé ce chemin.
Deuxième partie
Le premier morceau
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ
مَا
هَذِهِ
التَّمَاثِيلُ
الَّتِي
أَنتُمْ
لَهَا
عَاكِفُونَ
—————————————-
قَالُوا
وَجَدْنَا آبَاءنَا
لَهَا عَابِدِينَ
—————————————-
قَالَ
لَقَدْ
كُنتُمْ
أَنتُمْ
وَآبَاؤُكُمْ
فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ
Quand il dit A SON PERE ET A SON PEUPLE
que sont ces semblances (statues) ?
Celles
que VOUS
les adorez.
————————————————————————————-
Ils dirent
Nous avons trouvé NOS PERES les servant
————————————————————————————–
Il
dit
Certes vous êtes VOUS ET VOS PERES
dans un égarement manifeste
Analyse
structurelle
Le morceau est composé de trois segments introduits par le verbe dire. Le sujet est Abraham dans les segments externes et son peuple dans le segment central. Trois parallèles constituent la structure du morceau :
D’abord le parallèle entre les deux expressions « vous les adorez » et « nos pères les servant ». La première précise l’objet de la question : en désignant l’adoration dont les statues font l’objet, Abraham interroge sur leur nature. La seconde constitue la réponse : c’est l’adoration elle-même qui est sa propre justification. Il n’y aura pas de réponse sur la nature des statues, c’est simplement un mimétisme : c’est l’attrait dont elles sont l’objet qui provoque l’intérêt des suivants. Première rencontre significatif de notre texte et de la théorie de René Girard sur le mimétisme et le religieux.
Ensuite, deux termes encadrent le morceau, dont le point commun est l’apparence : dans le premier segment les statues, (tamathil, sur la même racine que mithal, exemple, ces statues sont des objets « à l’exemple de ») sont des objets dont l’importance est la ressemblance. Dans le dernier segment ‘mubyn’ signifie manifeste / clair /. La caractéristique de ce doute est d’être visible, apparent ; il n’a pas besoin d’être deviné. Ainsi pour Abraham, ces statues sont la manifestation de l’égarement de son peuple ; elles sont le phénomène qui le rend visible.
Enfin le peuple est défini par un assemblage de deux termes, dont « père » fait partie à chaque fois. « Son père et son peuple » dans le premier segment devient « vous et vos pères » dans le dernier, marquant la séparation progressive d’Abraham. La place de « nos pères » au centre lui donne une place importante comme élément de réponse à la question d’Abraham : « nos pères » apparait comme le fondement de la société, à la fois l’origine et la raison de sa pratique. En formulant « vous et vos pères » Abraham marque dans le dernier segment un rejet définitif du fondement de la société « nos pères » et de son lien avec eux, il abandonne « son père et son peuple» du premier segment.
Interprétation
Quand Abraham pose sa question, celle-ci repose sur la nature des statues, la seconde proposition, subordonnée, sur leur adoration ne sert formellement qu’à les désigner. Il observe le système religieux de son peuple, et interroge sur son objet, la nature des divinités que sont les statues, désignées par un terme prosaïque, que l’on pourrait traduire par reproductions, imitations. La question posée par Abraham suppose les statues comme origine de leur adoration.
Son peuple répond le contraire : un système ancestral avec une origine récursive (nos pères) comme seule justification. L’on peut remonter ainsi jusqu’à la nuit des temps, on n’atteindra jamais une origine du système. La question sur la nature des divinités est totalement évacuée. Ils les ont en quelque sorte trouvé là. C’est un préexistant, dont on témoigne une certaine ignorance (la question du tabou se pose alors). On a ainsi un phénomène (l’adoration) qui se reproduit de lui-même, sans relation de causalité avec sa raison d’être (les statues), qui lui préexisterai. Or on trouvera chez René Girard, une explication de l’adoration par mimétisme, qui frappera d’autant plus qu’elle colle de près à la suite des évènements.
La question d’Abraham révèle sa pertinence dans la réponse qui lui est faite : elle mettait en relation la divinité et son adoration. La réponse du peuple à deux composantes : une ignorance de la nature des statues et donc de l’origine de leur religion, et la pratique d’un système d’imitation : seule l’adoration dont elles sont sujet en fait des divinités. A ce moment Abraham doit choisir d’être inclus dans le système récursif « nos pères » en imitant « son père », ou pas. N’ayant pas obtenu sa réponse, il reprend les deux termes de sa question (adoration, ressemblance) dans une nouvelle formulation (égarement manifeste) qui fera office de réponse.
Contexte
coranique
Abraham, qui entreprend une critique de sa propre religion, en vient à la critique de ces reproductions du monde, et ne trouve pas de réponses auprès de son peuple aux questions qu’il s’est posé à lui-même. Ces reproductions, présentées comme un préexistant, un toujours-étant, finalement n’ont rien de spécial et leur service (leur apporter de la nourriture, sacrifier des enfants, adorer, etc) n’a pas d’autre justification que de faire comme ceux d’avant. Abraham s’était éloigné des choses qui disparaissaient, ici, en qualifiant la pratique de son peuple d’égarement manifeste, il finit par s’éloigner aussi des choses qui continuent, sont installées dans la durée par une transmission traditionnelle.
Le second morceau
قَالُوا
أَجِئْتَنَا بِ الْحَقِّ
أَمْ
أَنتَ مِنَ
اللَّاعِبِينَ
Ils dirent tu viens à nous avec la vérité
Ou bien toi de ceux qui jouent
Au centre de la partie, nous avons une question. Le morceau est composé de deux propositions dont l’opposition est l’enjeu de la question. Est-ce qu’Abraham agit volontairement dans une démarche qui s’inscrit dans le sens, la vérité, par laquelle ( ou bien avec laquelle) il viendrait, ou bien fait-il partie de l’inutile. L’opposition se retrouve dans les prépositions ‘bi’, avec, par, opposé à min (de). Ces deux pronoms désignent deux intentions qui pourraient l’animer, être à l’origine de sa démarche : la vérité ou le jeu.
Le troisième morceau
قَالَ
بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ
السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ
الَّذِي
فَطَرَهُنَّ
وَ أَنَا عَلَى
ذَلِكُم مِّنَ
الشَّاهِدِينَ
Il dit, plutôt, votre Seigneur Le Seigneur des cieux et de la terre
Celui qui a
conçu eux
Et moi, de
cela, de ceux qui témoignent
La réponse d’Abraham est un morceau composé de deux segments. C’est dans un discours vers son peuple qu’Abraham introduit sa divinité, et cela lui permet de se placer par rapport à son peuple.
Le lien entre les deux membres du premier segment est fait par les cieux et la terre, les deux mots juxtaposés désignent la totalité de l’univers, du monde réel, qui est repris dans le deuxième membre par un pronom. Abraham part de ce monde réel pour désigner sa divinité : Celui qui a créé le monde réel. Cette précision permet de comprendre comment Abraham conçoit sa divinité : elle n’est pas issue du monde matériel, mais elle en est la cause. Elle l’a conçu et c’est à ce titre qu’elle le dirige, d’où son titre : Seigneur des cieux et de la terre. Et donc à ce titre qu’elle dirige son peuple : votre Seigneur. Abraham établit une direction, un sens : la divinité créé le monde, et l’homme dans le monde.
C’est à partir de ce constat, et de son énonciation, qu’Abraham se situe par rapport à son peuple : je suis quelqu’un qui témoigne, qui s’exprime sur vous, par rapport à vos actions, et témoigne vers vous d’une divinité non pas incluse dans le monde mais supérieure au monde. En posant la divinité comme l’origine des choses, Abraham rend caduque la divinisation des choses produites.
L’ensemble de la partie
إِذْ
قَالَ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ مَا
هَذِهِ
التَّمَاثِيلُ الَّتِي
أَنتُمْ
لَهَا عَاكِفُونَ
قَالُوا
وَجَدْنَا آبَاءنَا
لَهَا عَابِدِينَ
قَالَ
لَقَدْ كُنتُمْ
أَنتُمْ
وَآبَاؤُكُمْ
فِي
ضَلَالٍ
مُّبِينٍ
—————————————————————–
قَالُوا
أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ
أَمْ
أَنتَ مِنَ
اللَّاعِبِينَ
————————-–—————————————
قَالَ
بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ
السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ الَّذِي
فَطَرَهُنَّ
وَ أَنَا
عَلَى
ذَلِكُم مِّنَ
الشَّاهِدِينَ
Quand il dit à son père et à son peuple que sont ces STATUES, celles que vous adorez ?
Ils dirent Nous avons trouvé nos pères les servant.
Il dit Certes vous êtes, vous et vos pères dans un doute manifeste
————————————————————————————————
Ils dirent tu
viens à nous avec la vérité Ou bien toi DE
CEUX QUI JOUENT ?
————————————————————————————————
Il dit,
plutôt, votre Seigneur est LE SEIGNEUR DES CIEUX ET DE LA TERRE Celui qui les a créées
et moi de cela DE CEUX
QUI TEMOIGNENT
La partie est de forme ABA’. Les trois morceaux sont structurés par la répétition du verbe « dire », terme initial de chacun. La partie ressemble dans sa forme au premier morceau : deux interventions d’Abraham encadrent une de son peuple. La question cette fois est posée par le peuple, elle au centre de la partie.
L’opposition entre les parties externes
On observera tout d’abord l’opposition entre les deux morceaux externes. La composition du texte met en miroir deux interventions d’Abraham, mettant en opposition deux types de divinités : « les statues » qui ouvrent le premier morceau, et « le Seigneur » dans le dernier. Nous remarquerons la même conjonction qui définit les divinités (celles que, celui qui), qui articulent les premiers segments respectifs de chaque morceau. Répétition qui accentue le parallèle fait entre les deux et introduit ce qui définit la divinité : dans un cas c’est l’adoration du peuple qui fait le dieu, dans l’autre le dieu l’est par lui-même, parce qu’Il a créé le monde. La fin de ces morceaux est encore en opposition : la conclusion d’Abraham sur son peuple (le doute) s’oppose à ce qu’il choisit pour lui-même (le témoignage, donc la vérité). On remarquera enfin que le « sur cela » dans l’affirmation finale réponds à « qu’est-ce que cela » dans la question initiale et encadre la partie.
L’opposition est subtile mais très significative entre le couple « ces semblances » / « doute manifeste » qui encadre le premier morceau et le « témoignage » qui termine le dernier. Il y a tout un jeu visuel dans les mots d’Abraham qui deviennent langage à la fin. Le terme vérité au centre sert de pivot entre les deux :
– ”Ces semblances”, les statues sont des choses faîtes pour ”ressembler à” (d’où le terme tamathilan), leur artisan a mis ”en elle” un sens. Elles incarnent quelque chose, elles ont une valeur symbolique.
– ”Manifeste” renvoie expressément à cette idée, dans la direction opposée : ce qui ressort d’elles, c’est à dire ce qu’elles expriment. Abraham affirme douter de ce qu’elles expriment, pour lui ce qui est visible, c’est un doute.
– ”Vérité” vient dans la bouche de son peuple. Ce mot sort du lexique du visuel, c’est un sens qui est derrière le réel. Ce terme fait pivot entre les sens exprimés visuellement de la première partie, en particulier par son opposition directe avec le terme doute, et le sens du témoignage.
– « Témoignage » c’est ce qui ressort d’Abraham, qu’il oppose au « doute manifeste »
Il y a une reprise implicite des statues dans la dernière partie, dans l’opposition entre « celles que vous (les) adorez » et « Celui qui les a créés ». Si le second parle bien évidemment des cieux et de la terre, il inclut dedans les statues. Deux points en découlent directement :
– Par rapport à la question d’Abraham « que sont ces statues » il n’a pas eu de réponse sur leur nature. En particulier sur leur apparition. Qui a créé ces statues ? Y répondre créerait un paradoxe : l’homme sert comme divinité ce qu’il a lui-même créé.
– Abraham pose, sur le principe non-dit de création, une divinité supérieure aux statues : celle qui a créé les cieux et la terre, c’est-à-dire l’ensemble du réel (cf. 16. 5), dont font parties les statues, Abraham et son peuple, et le reste. Ainsi il postule un ordre des choses : celui qui créé est supérieur à ce qu’il créé, votre Seigneur est celui qui vous a créé, vous êtes maitres des choses que vous fabriqués. Implicitement : vous êtes responsables du sens que vous produisez.
”Votre seigneur” est mis en opposition avec ”vos pères”, système sans origine de la première partie, Abraham propose une origine commune à toute chose. L’imitation des pères comme l’imitation des choses est remise en cause.
La question centrale
Etudions maintenant le rôle particulier jouée par la question, placée au centre de la partie. Comme dans le premier morceau, l’intervention du peuple utilise la première personne du pluriel, le « nous » qui forme le groupe. Nous avions vu qu’Abraham s’était mis en dehors par sa réponse. Ici les pronoms utilisés marquent que la séparation entre « nous » et « toi », ou plutôt la question porte sur cette séparation : « tu viens à nous » ou bien « toi » ?
Structurellement, « la vérité » reprend le thème du doute définit juste avant (termes médians) et le terme « de ceux qui jouent » prépare « de ceux qui témoignent » à la fin de la partie. Dans cette lecture, le peuple pose « la vérité » comme ce qui les rassemble, une solution au doute qui divise, proposé précédemment, alors que l’attitude d’Abraham le met à part et ne peut être prise au sérieux. Inversement, au niveau du sens, l’utilisation du terme « témoignage » employé par Abraham renvoi à « la vérité », et renvoi « jouer », au service des statues, comme un enfant avec ses jouets.
La question ainsi placée au centre s’insère dans les deux discours :
– En tant que réponse du peuple, elle s’oppose au « doute », en remettant en cause la capacité d’Abraham à apporter « la vérité ». Pour son peuple face aux choses sérieuses (« servir »), il « joue ».
– Une fois posée la réponse dans le troisième morceau, Abraham assume son « témoignage », le terme entre en parallèle avec « vérité » et renvoie « le jeu » au « service des statues ». On obtient alors un retournement au centre.
La question au centre joue ici un rôle de pivot : la réponse du peuple est reprise par Abraham qui reprend à son compte l’invitation du peuple. La question de la vérité devient l’enjeu centrale de la partie :
– Abraham met en doute son peuple dans la première partie
– Son peuple s’interroge : vient-il avec la vérité (dans ce cas nous sommes dans l’erreur) ou rigole-t-il (peut-on ne pas faire attention à lui ?). Dans cette interrogation, il y a une échappatoire pour le peuple : reporter la faute sur Abraham (il n’est pas sérieux). Cet échappatoire est aussi proposé à Abraham : vas-tu t’obstiner sur la vérité ?
– Abraham reprend à son compte la proposition énoncée au centre, qui le pousse à préciser son discours.
L’ensemble de la partie
Il y a trois fils notables que l’on suit tout au long de cette partie, définissant des oppositions : l’appartenance au groupe et l’extériorité, le service du matériel ou la création du matériel, l’apparence des choses ou la vérité. L’opposition proposée entre les deux divinités est située par le texte dans le cadre de ces trois oppositions. D’un côté le peuple est définit, rassemblé, par le service d’objets visibles : de l’autre Abraham est mis à part pour le témoignage d’une divinité invisible mais créatrice de tout l’univers, dont les objets visibles.
Dans un texte narratif très court, l’articulation intriquée des oppositions ses ramifications et ses enjeux. Tout l’enjeu est là : par sa structure faîte d’un jeu de miroir et d’opposition, le texte articule ses concepts sui sont présents, à fleur de texte, sans être tout à fait énoncés. D’où l’impression d’une grande richesse et de niveaux de lectures, atteignables par imprégnation, par la méditation ou par la réflexion. Par l’apposition successives de binarités, le texte construit des structures complexes. Le chemin parcouru par le lecteur dans les fractales de la structure du texte lui permet d’expérimenter progressivement des niveaux de sens.
Ainsi les trois morceaux articulent trois niveaux de savoir :
– Dans le premier, on est dans l’apparence, le symbolisme des statues. La statue n’est qu’une copie du monde, elle représente. L’homme imite la nature et imite ses ancêtres. Il ne fait que reproduire, en moins bien. Pour Abraham la statue en n’étant qu’apparence est mise en évidence de l’égarement : l’homme n’a pas à servir des choses mortes. En mélangeant divin et objet, il se met à servir des objets, montrant qu’il inverse l’ordre des choses. Il devrait utiliser les objets et être lui-même porteur du sens.
– Dans le second, on est dans l’interrogation entre recherche de vérité et jeux.
– Dans le troisième, Abraham entre dans le témoignage, la parole du témoignage remplace le symbolisme qui imite, le sens prime sur l’apparence. Le langage est porteur du sens et dépasse le symbolisme. Une divinité invisible et un monde réel priment sur l’imitation. Il y a une dichotomie entre le réel et le divin, l’univers ne peut pas être dieu de l’univers. En terme kantiens, le Coran sépare le noumène, l’inconnaissable du monde, sa création, et le phénomène, la partie observable du monde.
Contexte Coranique
Nous avons vu que la première réponse à la question posée sur les statues révèle l’imitation des ancêtres comme fondement de la religion. Cette reproduction de la religion est régulièrement critiquée par le Coran :
5,104. Et quand on leur dit : “Venez vers ce qu’Allah a fait descendre, et vers le Messager”, ils disent : “Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres.” Quoi ! Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n’étaient pas sur le bon chemin… ?
43,22. Mais plutôt ils dirent : “Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion, et nous nous guidons sur leurs traces”.
5,38. “Entrez dans le Feu”, dira [Allah,] “parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés.” Chaque fois qu’une communauté entrera, elle maudira celle qui l’aura précédée. Puis, lorsque tous s’y retrouveront, la dernière fournée dira de la première : “ô notre Seigneur ! Voilà ceux qui nous ont égarés : donne-leur donc double châtiment du feu.” Il dira : “A chacun le double, mais vous ne savez pas”.
A travers le thème du jour du jugement, point focal de la transcendance coranique, jour où toute chose devient claire, le texte déroule l’imitation des pères comme un système récursif. On retrouve ce jour-là le moment premier, absent de notre texte. On pourrait faire un parallèle entre 5,38 et 6,128.
Troisième partie
وَ تَاللَّهِ
لَأَكِيدَنَّ
أَصْنَامَكُم
بَعْدَ
أَن
تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ
فَجَعَلَهُمْ
جُذَاذاً
إِلَّا
كَبِيراً
لَّهُمْ
لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
+57a Et par Allah
+57b
je vais comploter (contre) vos idoles
=57c Après que vous partiez tournant votre dos
+58a Alors je vais en faire des morceaux
+58b sauf la plus grande d’entre elles
=58c afin qu’ils vers elle retournent
La partie est faîte d’un seul morceau composé de deux segments trimembres symétriques. Chaque segment est composé dans une forme AA’B, avec deux membres mettant en opposition Allah et les idoles, et un dernier parlant du peuple (vous, 57c ; ils 58c) et construit autour d’un verbe de mouvement. Ainsi « tournant votre dos » et « retournent » sont les termes finaux de chaque segment.
Dans le premier segment « Allah » est mis en opposition avec « vos idoles » marquant l’opposition désormais établie entre les deux dans l’esprit d’Abraham. Le 3e membre, complément de temps de la proposition, n’a pas de miroir dans ce segment, hormis un lien de causalité : qu’ils « partent » est nécessaire pour pouvoir « comploter », ainsi l’action se fait dans le « dos » de son peuple.
Le second segment est construit sur la même forme, deux segments en opposition et un complément de causalité. Les termes utilisés sont des termes concernant l’aspect matériel des statues. L’opposition se fait maintenant dans les deux premiers membres entre statues, entre les « morceaux » et « la plus grande d’entre elles ». Il y a deux sens dans l’affirmation d’Abraham, en réduisant les statues en « morceaux », il parle explicitement de les détruire, mais aussi de les ramener à leur réalité : ce sont des morceaux de bois. Comme de laisser la plus grande, c’est une action purement symbolique, il utilise le langage symbolique des statues de son peuple pour transmettre son message : ce sont de simples morceaux de bois, revenez vers la divinité. Ce que formalise le dernier membre.
Les deux segments sont construits sur le même modèle AA’B. Le plan d’Abraham est énoncé une première fois dans l’idée, par des mots. Il est ensuite repris dans sa réalisation en utilisant les statues pour exprimer l’idée première. C’est par le parallélisme des deux structures que le texte laisse deviner que « les morceaux » et « la plus grande » représentent les idoles et Allah. Abraham prévoit le départ de son peuple, qui se détourne après la discussion précédente, et organise son retour vers Allah. Ainsi les deux verbes de mouvements allégorisent les choix spirituels de son peuple.
Contexte coranique
Nous n’avons envoyé aucun prophète qui n’ait utilisé la langue de son peuple pour les éclairer. Après quoi, Dieu égare qui Il veut et guide qui Il veut. Il est le Tout-Puissant, le Sage.
Après s’être enquis des fondements de la religion de son peuple, Abraham choisit les statues comme vecteur de son message. L’utilisation de la symbolique des statues, alors que la parole ne passe pas, nous semble un bon exemple d’utilisation du langage vernaculaire proposé ci-dessus.
4.
Quatrième Partie
4.1 Premier morceau
قَالُوا مَن
فَعَلَ هَذَا
بِآلِهَتِنَا
إِنَّهُ لَمِنَ
الظَّالِمِينَ
قَالُوا سَمِعْنَا
فَتًى
يَذْكُرُ هُمْ
يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
59a Ils dirent qui
a fait cela à nos dieux
59b Certes celui-là des malfaisants
60a ils dirent nous avons entendu un
jeune
médire d’eux
60b est
appelé celui-là
Abraham
Le morceau est construit en trois segments, tous introduits par une forme du verbe « parler ». Les deux premiers ont pour objet ce qui arrive à leurs divinités, maintenant appelées par leur nom fonctionnel « dieux » et plus par un terme matériel (statues, idoles, morceaux). Dans le discours du peuple, ce sont des divinités. Le troisième présente Abraham.
Dans le premier segment, en face de l’affirmation précise « qui a fait cela », l’utilisation du mot « malfaisant » parle d’intentionnalité et est une condamnation morale. En partant du fait constaté, ils cherchent un coupable.
Dans le second segment, les deux premiers membres sont symétriques et présentent les deux pendant du discours, écouter et parler. Leurs objets sont opposés, le jeune que l’on entend, les dieux dont on médit.
Le dernier, avec une forme passive du verbe dire, signifiant ici « appelé », désigne Abraham.
Les deux premiers segments sont parallèles, commençant par « ils dirent ». Ils donnent chacun un aspect de l’action d’Abraham, le premier évoque l’action physique sur les statues de la partie précédente, qu’ils découvrent à l’instant, le second rappel la critique d’Abraham sur leur adoration dans la seconde partie. Les deux actions d’Abraham avaient ciblé les aspect physique et symboliques des divinités, regroupés ici dans le terme « dieux ». Le dernier désigne Abraham comme acteur de ces deux critiques, le morceau est construit selon une forme AA’B.
Le morceau évolue progressivement du constat de l’acte, en passant par les on-dit, pour ensuite désigner Abraham. Celui-ci est d’abord appelé « un jeune », quand il s’agit de dire ce qui l’incrimine, puis par son nom « Abraham » pour le désigner.
L’accusation n’est pas très bien construite. L’acte nécessite un coupable et les rumeurs vont permettre de le désigner. Cependant la chose est claire et elle tombe sur la bonne personne. Il y a un caractère accusateur, mis en place par les connotations négatives des termes utilisés : malfaisant, jeune, médisance. Abraham est un jeune qui réfléchit sur les pratiques de son peuple et les siennes et intervient pour faire réfléchir sur le but et l’origine de la tradition. Le vocabulaire utilisé ici présente un peuple qui réagit à la pensée critique par l’accusation et le dénigrement.
4.2 Second morceau
قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ
أَعْيُنِ
النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ
يَشْهَدُونَ
61a Ils
dirent amenez-le sous
les yeux des gens
61b Afin
qu’eux témoignent
Le morceau central ne contient qu’un seul segment bimembre, qui redéfinit la relation entre Abraham et son peuple. Le premier est amené « sous les yeux des gens », on l’imagine au centre ou devant la foule. Il y a un parallèle entre « sous les yeux des gens » et « témoignent », entre l’observation et le constat oral de celle-ci. Deux remarques sur ce parallèle :
– Les gens sont appelés à témoigner ici selon ce qu’ils observent lors du moment du jugement, c’est un jugement sur la personne et sur le moment de la mise en scène du jugement.
– C’est un témoignage visuel, le lien est direct ici entre l’observation et le jugement, il n’y a pas de processus critique ou pratique, qui serait équivalent par exemple à la recherche personnel entreprise par d’Abraham dans les autres récits.
C’est le morceau central du passage. A la fois le cœur de l’espace narratif, qui peut servir à dégager le sens de l’histoire, et un point de pivot, le tournant de l’histoire. Ici le stratagème d’Abraham amène son discours à son apogée puisqu’il est devenu le centre de l’attention et qu’il va pouvoir s’exprimer à tous de manière décisive. Le peuple de son côté, n’a pas vraiment accroché au message, et a commencé un processus d’accusation, excédé par l’attaque sur ses statues. En l’amenant au centre, « sous les yeux des gens », il entend surtout « témoigner » sur Abraham, plus que l’écouter.
4.3 Troisième Morceau
قَالُوا أَأَنتَ
فَعَلْتَ
هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا
إِبْرَاهِيمُ
قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ
هَذَا
فَ اسْأَلُو هُمْ
إِن يَنطِقُونَ
62 ils
dirent est-ce
toi qui a fait cela à nos dieux Ô ABRAHAM
63a il
dit non,
plutôt a fait la plus grande d’entre elles cela
63b donc demandez- leurs
63b si elles sont s’exprimant
Le morceau est composé de deux segments, une question et sa réponse. Les deux premiers membres de chaque sont quasiment identiques, leur parallélisme est construit sur la répétition de « dire » et de « faire ». La question du premier segment accuse Abraham d’avoir fait « cela », le crime reproché n’est pas prononcé.
Abraham reprend exactement les termes de la question. Il n’y a que deux différences entre les membres. Le terme Abraham disparait et les divinités sont remplacées par « la plus grande d’entre elles ». C’est celle-ci qui prend sa place en tant que sujet de « faire », ainsi Abraham et les statues sont évacuées au profit d’un Dieu unique.
Les deux derniers membres de la réponse mettent en miroir deux actions symétriques : poser des questions vers les statues et qu’elles y répondent. Les deux membres externes sont aussi symétriques : si les statues parlent elles peuvent aussi se disputer entre elles. Le raisonnement déployé par Abraham semble être le suivant : puisque le peuple leur parle, c’est qu’elles doivent certainement répondre, si elles répondent, c’est qu’elles peuvent interagir entre elles. Ainsi pour casser l’alibi d’Abraham, il faudrait rappeler l’évidence que les statues sont inutiles et montrer qu’il a raison à leur sujet, et que son crime n’en est pas un, mais qu’il a prouvé à son peuple leur inutilité.
Abraham exprime Allah dans le langage religieux et symbolique de son peuple, cette fois de manière explicite. Allah devient ainsi « la plus grande des statues », qui a réduit les autres à n’être que des morceaux de bois. Le divin passe de l’objet réel à une divinité transcendante, extérieure au monde. En prenant également la place d’Abraham, qui inscrit ce discours dans le réel, cette transcendance est le noumène de l’action, dont Abraham est le phénomène. Si le sacrifice du mouton marque dans la tradition monothéiste la fin des sacrifices d’enfants, dans ce morceau, le Coran raconte, toujours par le biais d’Abraham, la fin des divinités matérielles. On trouve là une critique du polythéisme qui le résume à un simple fétichisme. Abraham est à chaque fois le représentant du passage des religions païennes au monothéisme. En reprenant son histoire, le Coran donne un cadre historique et religieux au discours prophétique de Muhammad face au peuple mecquois.
Ensemble
de la partie
قَالُوا مَن
فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ
لَمِنَ
الظَّالِمِينَ
قَالُوا سَمِعْنَا
فَتًى يَذْكُرُهُمْ
يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ
———————————————————–
قَالُوا
فَأْتُوا
بِهِ عَلَىٰ
أَعْيُنِ
النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَشْهَدُونَ
———————————————————–
قَالُوا أَأَنتَ
فَعَلْتَ
هَذَا بِآلِهَتِنَا
يَا
إِبْرَاهِيمُ
قَالَ بَلْ
فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن
يَنطِقُونَ
59a Ils
dirent qui a fait cela à nos dieux, Certes celui-là des malfaisants
60a ils
dirent nous avons
entendu un
jeune médire d’eux
60b est
appelé celui-là ABRAHAM
————————————————————————————————————————-
61a
ils
dirent amenez-le sous les yeux des gens afin
qu’eux témoignent
———————————————————————————
62 ils
dirent est-ce toi qui a fait cela à
nos dieux Ô ABRAHAM
63a il
dit non, plutôt a fait cela la plus
grande d’entre elles donc demandez–leurs
si elles s’expriment
La partie est construite de trois morceaux concentriques. C’est un seul long débat et tous les segments commencent par le verbe dire qui structure les interventions. Les verbes concernant des moyens d’expression sont repris tout au long de la partie. «Nos dieux » sont placés en terme initiaux des morceaux externes, tandis qu’Abraham, terme médian entre les morceaux externes, encadre le morceau central. L’opposition entre « Nos dieux » et « La plus grande d’entre elles » encadre la partie.
Les deux morceaux externes tournent autour de la question « qui a fait cela », qui revient en tout trois fois. Ces morceaux opposent un dialogue interne qui charge et accuse Abraham, et le dialogue avec celui-ci, et l’aboutissement de son stratagème qui les pousse à reconnaitre soit la grandeur d’un Dieu unique, soit l’inutilité des morceaux de bois. Nous remarquons aussi deux jeux de verbes d’élocutions symétrique, portant sur le récepteur puis l’émetteur du discours : « entendre un jeune médire » opposé à « demandez-leur si elles s’expriment ». Ainsi sont mis en opposition deux autres discours, à destination du peuple, celui d’Abraham et celui des statues.
Ce sont les gens qui sont appelés à s’exprimer, pas les statues.
Ce passage reprend un autre thème de la pensée Girardienne : la recherche d’un coupable et l’accusation de celui-ci par la foule. Abraham est ici amené à subir la vindicte la populaire, suite au trouble qu’il a créé. Le centre du passage marque le point culminant de ce processus : « amenez-le sous les yeux des gens ».
Les meneurs
Dans le texte on voit deux groupes se détacher parmi le peuple d’Abraham. Ils se parlent l’un à l’autre, et l’un semble commander à l’autre, le diriger. Qui sont-ils, comment comprendre ? Cette distinction entre deux groupes, qui n’est que sensible dans le passage que nous étudions, se retrouve décrite à d’autres endroits dans le Coran et dans la Bible.
Contexte coranique
Ainsi, dans la sourate 43 se sont toujours les notables qui incitent à tuer les messagers. Au début de la sourate, un passage insiste sur cet aspect :
23. Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en une cité sans que ses gens aisés n’aient dit : “Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces”.
24. Il dit : “Même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vous ancêtres ? ” Ils dirent : “Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés”.
25. Nous Nous vengeâmes d’eux. Regarde ce qu’il est devenu de ceux qui criaient au mensonge.
26. Et lorsqu’Abraham dit à son père et à son peuple : “Je désavoue totalement ce que vous adorez,
27. à l’exception de Celui qui m’a créé, car c’est Lui en vérité qui me guidera”.
28. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils ?
29. Mais à ces gens ainsi à leurs ancêtres, J’ai accordé la jouissance jusqu’à ce que leur vinrent la Vérité (le Coran) et un Messager explicite.
30. Et quand la Vérité leur vint, ils dirent : “C’est de la magie et nous n’y croyons pas”.
31. Et ils dirent : “Pourquoi n’a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l’une des deux cités ? ” (la Mecque et Taef) .
32. Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur ? C’est Nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grades les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux, cependant, que ce qu’ils amassent.
33. Si les hommes ne devaient pas constituer une seule communauté
(mécréante), Nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas
au Tout Miséricordieux, de toits d’argent avec des escaliers pour y
monter ;
34. (Nous aurions pourvu) leurs maisons de portes et de divans où
ils s’accouderaient,
35. ainsi que des ornements. Et tout cela ne serait que jouissance
temporaire de la vie d’ici-bas, alors que l’au-delà, auprès de ton Seigneur,
est pour les pieux.
On peut lire dans la sourate 34, versets 31-34
31. Et si tu pouvais voir les injustes seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres ! Ceux que l’on considérait comme faibles diront à ceux qui s’enorgueillissaient : "Sans vous, nous aurions certes été croyants".
32. Ceux qui s’enorgueillissaient diront à ceux qu’ils considéraient comme faibles : "Est-ce nous qui vous avons repoussés de la bonne direction après qu’elle vous fut venue? Mais vous étiez plutôt des criminels".
33. Et ceux que l’on considérait comme faibles diront à ceux qui s’enorgueillissaient : "C’était votre stratagème, plutôt, nuit et jours, de nous commander de ne pas croire en Allah et de Lui donner des égaux". Et ils cacheront leur regret quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans aux cous de ceux qui ont mécru : les rétribuerait-on autrement que selon ce qu’ils œuvraient ?"
34. Et Nous n’avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ses gens aisés n’aient dit : "Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés".
Dans le premier morceau, nous avons vu la distinction entre le peuple et les pères, ici entre ceux qui ordonnent au peuple et les suiveurs. Allah les ramènent tous vers un même résultat, ne faisant d’eux finalement qu’un seul groupe. ”C’est vers Lui que vous retournerez tous” (C 10,4 ; 43,14). Derrière la menace, se trouve mis en valeur le choix d’Abraham contre tous. C’est clairement un appel à la responsabilité personnelle. Donc à la liberté.
Nous verrons dans la partie suivante à quoi correspond ”stratagème” et ce qu’ils œuvraient. Ainsi nous avons deux passages se complétant, permettant de comprendre l’un et l’autre. Derrière l’apparente disparité du Coran, apparaît une intertextualité très riche.
Contexte biblique
Le Psaume 74 décline également ce thème de la réussite des mauvais :
1 Psaume d’Asaph. Oui, Dieu
est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur.
2 Pour moi, le pied m’a presque
manqué, et peu s’en est fallu que mes pas n’aient glissé ;
3 Car j’ai porté envie aux insensés,
voyant la prospérité des méchants.
4 Car ils ne sont point liés jusqu’à
leur mort, et leur force est en son entier.
5 Quand les mortels sont en peine,
ils n’y sont point ; ils ne sont point frappés avec les humains.
6 C’est pourquoi l’orgueil les
entoure comme un collier, la violence les couvre comme un vêtement.
7 Leurs yeux sont enflés à force
d’embonpoint ; les désirs de leur cœur se font jour.
8 Ils sont moqueurs et parlent méchamment d’opprimer ; ils
parlent avec hauteur.
9 Ils portent leur bouche jusqu’au
ciel, et leur langue parcourt la terre.
10 Aussi son peuple en revient à
ceci, quand on leur fait boire les eaux amères en abondance,
11 Et ils disent : Comment
Dieu connaîtrait-il ? Et comment y aurait-il de la connaissance chez le
Très-Haut ?
12 Voici, ceux-là sont des méchants,
et, toujours heureux, ils amassent des richesses.
13 Certainement c’est en vain que
j’ai purifié mon cœur, et que j’ai lavé mes mains dans l’innocence.
14 Car je suis frappé tous les
jours, et mon châtiment revient chaque matin.
15 Si j’ai dit : Je parlerai
ainsi ; voici, j’étais infidèle à la race de tes enfants.
16 J’ai donc réfléchi pour
comprendre ces choses, et cela m’a semblé fort difficile ;
17 Jusqu’à ce qu’entré dans les
sanctuaires de Dieu, j’aie pris garde à la fin de ces gens-là.
18 Car tu les mets en des lieux
glissants ; tu les fais tomber dans des précipices.
19 Comme ils sont détruits en un moment ! Enlevés et consumés par une
destruction soudaine !
20 Tel un songe quand on s’éveille,
ainsi, Seigneur, à ton réveil tu mets en mépris leur vaine apparence.
21 Quand mon cœur s’aigrissait
ainsi, et que je me tourmentais en moi-même,
22 Alors j’étais abruti et sans
connaissance ; j’étais devant toi comme les bêtes.
23 Mais moi, je serai toujours avec
toi ; tu m’as pris par la main droite.
24 Tu me conduiras par ton conseil,
puis tu me recevras dans la gloire.
25 Quel autre que toi ai-je au
ciel ? Je ne prends plaisir sur la terre qu’en toi.
26 Ma chair et mon cœur
défaillaient ; mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à
toujours.
27 Car voici : ceux qui
s’éloignent de toi périront. Tu retranches tous ceux qui se détournent de toi.
28 Mais pour moi, m’approcher de
Dieu, c’est mon bien ; j’ai placé mon refuge dans le Seigneur, l’Éternel,
afin de raconter toutes tes œuvres.
Nous avons également dans Actes 19 une situation similaire, où une raison financière les notables s’en prennent à Paul pour défendre leurs idoles. Jacques 5, met en garde les riches contre leurs richesses car ils ont privé le travailleur de son salaire et tué le juste.
Cinquième partie
فَ رَجَعُوا
إِلَى
أَنفُسِهِمْ
فَ قَالُوا إِنَّكُمْ
أَنتُمُ الظَّالِمُونَ
ثُمَّ
نُكِسُوا
عَلَى
رُؤُوسِهِمْ
لَقَدْ
عَلِمْتَ
مَا
هَؤُلَاء يَنطِقُونَ
=Alors ils
retournèrent vers leurs âmes
::Alors ils dirent : Ainsi vous êtes injustes
=puis ils furent tournés sur leurs têtes
::certes tu savais que celles-ci ne s’expriment pas
Le morceau est composé de deux segments bimembres symétriques. Les verbes « retournèrent » et « fûrent tournés » servent de terme initial commun à chaque segment. Le second segment est toujours un discours. Chaque segment raconte une volte face et son expression orale.
Dans le premier segment, « retourner vers son âme » indique une prise de conscience, conséquente à l’affirmation d’Abraham qui précède. Le second membre précise les termes de cette prise de conscience, affirmés entre les membres du groupe formé.
Dans le second segment, la volteface semble subie, comme l’indique la forme passive. « Tourné sur sa tête » dans le premier membre, va avec l’affirmation vers Abraham de la compréhension de son piège dans le second membre.
La similarité de la forme des deux segments met en valeur les deux étapes successives de la réception de la mise en scène d’Abraham. La première montre une compréhension interne du message transmis par Abraham, marquée par le terme « âme » qui accompagne l’expression d’une prise de conscience « vous êtes les malfaisants ». Dans un second mouvement, en sens inverse, « Tourné sur leur tête » montre le passage vers l’extérieur et le retour vers Abraham. La prise de conscience donne lieu à la compréhension du moyen utilisé par Abraham pour la provoquée. Critiquer celle-ci leur permet d’annuler celle-là, comme le montre la succession des retournements. Le message lui-même bien reçu, il est instinctivement (d’où la forme passive) rejeté par le biais de la critique du messager.
La structure du morceau décrit l’aspect intérieur et extérieur du mécanisme d’un thème récurrent du Coran : le rejet du messager, le plus souvent appliqué directement ou indirectement au rejet de Muhammad par le peuple Mecquois. Le point ici est que le message est rejeté après avoir été compris, et que le rejet du messager est la conséquence de ce rejet. C’est donc un choix de recouvrir la vérité de la prise de conscience plutôt que d’avancer à partir de celle-ci. Le peuple ne semble comprendre de la démarche qu’une accusation « Ainsi c’est vous les malfaisants », peut-être un peu excessive, mais qui explique le point pivot entre la foi et son rejet : l’acceptation d’une critique extérieure.
6. Sixième partie
6.1 Premier morceau
قَالَ
أَفَ تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ
مَا لَا
يَنفَعُكُمْ شَيْئاً
وَ لَا
يَضُرُّكُمْ
أُفٍّ لَّكُمْ
وَ لِمَا تَعْبُدُونَ
مِن
دُونِ
اللَّهِ
أَفَ لَا
تَعْقِلُونَ
il dit fi vous adorez en dehors d’Allah
ce
qui ne
vous sert en rien
et ne vous nuit pas
fi de
vous
et de
ce que vous adorez
en dehors d’Allah
fi vous ne raisonnez pas
Le morceau est composé de 3 segments, marqués par la récurrence de « af » dans deux formes différentes : grammaticalement il s’agit … Cependant il semble possible d’y voir trois fois « fi », qui marque le rejet. Les trois segments sont de taille de plus en plus réduite, celle-ci passe de 3 à 1 seul membre.
Le premier segment est composé de trois membres. Le premier reprend l’adoration des statues, cette fois ci décrite comme « en dehors d’Allah », on ne parle plus du monde réel pris comme divinité, mais de la divinité prise en dehors de La divinité. Les deux derniers membres sont construits sur l’apposition de deux négations, « ne sert pas » / « ne nuit pas », qui, misent ensemble, forment un tout et déterminent ces divinités par leur inutilité. Ces deux membres, comme le complément du premier membre suivent tous les trois le verbe adorez : un est un complément, les deux autres des subordonnées complément d’objet. La différence entre les deux derniers, le rajout de « chose » dans « ne vous sert pas à quelque chose » permet de faire le lien avec le complément du premier membre : « en dehors de » / « ne sert pas ». Ce lien énonce implicitement le corollaire : seul Allah peut quelque chose, aider ou nuire. Ce segment à lui seul rassemble le thème de la seconde partie puis la conclusion des 3e et 5e : la démonstration d’Abraham et l’aveu subséquent avaient amené cette conclusion.
De la même manière, les deux membres du second segment expriment chacun un objet du rejet d’Abraham « fi » introduits par le même « lam » le peuple, « vous », et les statues, « ce que vous adorez ».
Le dernier est un simple membre qui conclue le morceau. Vous ne raisonnez pas.
Pris ensembles ces trois segments énoncent le constat d’Abraham sur les évènements précédents et ses conclusions quant à la pratique de son peuple. Le constat d’une pratique (l’adoration des statues) rendue caduque par l’inutilité des divinités dans le premier produit le jugement d’Abraham sur l’aspect théorique dans le dernier : vous ne raisonnez pas. Le lien entre ces deux constats est fait par la reprise de formes verbales négatives. Ce lien laisse deviner que le troisième est la conclusion du premier, donc de l’histoire entière. La nuance avec le morceau central est marquée par la forme différente prise par les deux lettres « af » : support interrogatif de la négation du verbe dans les segments externes, marqueur du rejet dans le segment central. Le segment central est différencié par cette forme, il marque la conséquence de l’ensemble : le rejet. Il marque un renversement au centre : le premier segment est repris dans son second membre, le dernier annoncé dans le premier.
6.2 Second morceau
قَالُوا
حَرِّقُو هُ
وَ انصُرُوا
آلِهَتَكُمْ
إِن
كُنتُمْ
فَاعِلِينَ
ils dirent brûlez- le
et secourez
vos divinités
si vous
êtes faisant
Nous trouvons dans ce morceau un seul segment trimembre, introduit comme les autres morceaux de la partie par le verbe « ils dirent », qui introduit le discours, ici du peuple.
Les deux premiers membres sont de la même forme verbe / objet et sont simplement liés par la conjonction « et ». Suggestion par parataxe de l’égalité des deux propositions : bruler Abraham c’est sauver / aider / rendre victorieuse les divinités. En effet, aider les divinités répond à 2 évènements précédents, présentés en parallèle dans les 3e et 5e parties : répondre à la destruction physique des statues par Abraham, et répondre à la destruction du sens des divinités par sa question, reconnue par son peuple dans la 5e partie. D’où l’opposition présentée ici entre les divinités et Abraham, les deux ne peuvent être vrais conjointement. La suite logique du retour sur leur tête de la 5e partie, qui rejetait la compréhension en reportant la faute sur Abraham, est maintenant de se débarrasser de lui. On notera le rapport entre la victoire des divinités et le feu.
Le 3e membre est une expression qui revient 3 autres fois dans le Coran. Ce sont toujours dans des discours, et le sens est de proposer une action de substitution, ainsi Lot présente ses filles à la place des étrangers sous son toit (15,71), le frère de Joseph propose de le descendre dans un puit plutôt que de le tuer (12,10), ou au début de notre sourate dans un contexte semblable, Allah aurait créé autre chose plutôt que le monde – si (law) il avait voulu un divertissement plutôt que le triomphe de la Vérité -. Ici il s’agit très certainement de tuer Abraham plutôt que de perdre les divinités, si vous devez faire quelque chose. Autrement dit, puisque nous devons agir dans un sens ou dans l’autre, nous devons agir dans ce sens-là. Cette proposition vient tout à fait à l’opposé des 3 autres occurrences, dans lesquelles il s’agissait dans les faits d’éviter le meurtre d’un prophète (Joseph) ou des anges envoyés à Lot. Elle s’oppose aussi à l’intention donnée au début de la sourate, dans le cadre général de l’action prophétique, dont la finalité est de faire surgir la vérité pour qu’elle fasse disparaitre le mensonge. Ici il s’agit de l’exact opposé : faire disparaitre Abraham (et la vérité) plutôt que de laisser le doute qu’il incarne désormais sur les divinités.
قَالَ هَٰؤُلَاءِ
بَنَاتِي إِنْ
كُنْتُمْ
فَاعِلِينَ {71}15 Lot
قَالَ
قَائِلٌ
مِنْهُمْ لَا
تَقْتُلُوا
يُوسُفَ
وَأَلْقُوهُ
فِي غَيَابَتِ
الْجُبِّ
يَلْتَقِطْهُ
بَعْضُ
السَّيَّارَةِ
إِنْ
كُنْتُمْ
فَاعِلِينَ {10}12 Joseph
لَوْ
أَرَدْنَا
أَنْ
نَتَّخِذَ
لَهْوًا
لَاتَّخَذْنَاهُ
مِنْ
لَدُنَّا إِنْ
كُنَّا
فَاعِلِينَ {17}21
Les prophètes
Ainsi les deux situations précédentes trouvent ici leur solution pratique. Quand Abraham remet en cause la divinité des statues, il remet en cause la signification ce que le peuple a attribué à ces statues et qui justifie de les servir. Il révèle alors un certain inconscient collectif que le peuple défend dans la 5e partie en rejetant la logique d’Abraham. Le peuple n’est pas prêt à laisser la démarche logique d’Abraham révéler l’impensé et l’inconscient de sa pratique. Il n’est pas prêt à passer du figuratif au langage. Défendre leurs divinités, c’est défendre les statues et tout ce qui a été ajouté comme valeur significative sur les objets-statues. Défendre leur inconscient dans sa matérialité suppose détruire la critique dans sa matérialité, c’est-à-dire détruire Abraham par le feu pour qu’il n’en reste rien. Le feu aurait donc pour leur inconscient un pouvoir salvateur. D’où le parallèle entre « bruler » et « secourir », qui intervient dans l’opposition entre Abraham et les divinités. Cependant en sauvant eux-mêmes les statues, ils abondent dans le sens d’Abraham : les statues ne peuvent rien.
Il s’agit ici de recouvrir la vérité, l’enfouissement de l’aspect injuste de leurs actions, de leur égarement, après sa reconnaissance formelle. Ce recouvrement théorique, ici idéologique même, qui reprend les sens coraniques de mensonge et de kafir, se fait dans la pratique par la violence. Nous avons ici une expression du moment de basculement des punishment stories, l’archétype des histoires prophétiques qui sous-tend celle du prophète Muhammad, quand la limite est franchie. Dans ce zoom sur cet instant particulier, c’est le dépassement matériel de la limite, le meurtre, qui prouve non seulement l’erreur dans la théorie, mais surtout sa gravité. Nous pensons en particulier au meurtre de la chamelle, qui justifie à lui seul la condamnation de la cité. Il est étonnant d’ailleurs qu’il n’y ai jamais de retour sur la fin du peuple d’Abraham.
Contexte coranique
L’on trouve une perspective en miroir de notre extrait à la fin de la sourate Al A’raf. L’affirmation que les divinités associées « ne créent rien et sont créés » rappellent le témoignage d’Abraham (56b, 58a, 63). NSR est utilisé dans le sens opposé : dans notre texte ce sont les hommes qui doivent les secourir, dans celui d’Al’raf il est dit qu’elles ne peuvent aider les hommes, affirmations complémentaires, l’invitation à leur demander des réponses rappelle la question d’Abraham. Last but not least, « faites-les répondre, si vous êtes véridiques » propose le choix exactement opposé plus haut à « brulez Abraham (…) si vous devez agir ». La présence de ce texte miroir semble valider le sens que nous avons tiré de la construction, cad du sens créé par l’apposition des trois propositions et de leur place dans le passage. Elle participe selon nous de deux caractéristiques du Coran. D’une part la répétition d’une même idée, parfois complètement développée, parfois simplement évoquée ou convoquée comme partie d’un autre ensemble. L’histoire d’Abraham dans Les Prophètes pourrait être un exemple du passage d’Al A’raf. D’autre part cette reprise de termes et d’expression fait peut-être partie d’une échelle supérieure de la construction du Coran dans son ensemble, ce que l’on pourra vérifier ou infirmer par la progression de l’étude rhétorique du livre.
أَيُشْرِكُونَ
مَا لَا
يَخْلُقُ
شَيْئًا
وَهُمْ
يُخْلَقُونَ {191}
وَلَا
يَسْتَطِيعُونَ
لَهُمْ نَصْرًا
وَلَا
أَنْفُسَهُمْ
يَنْصُرُونَ
{192}
وَإِنْ
تَدْعُوهُمْ
إِلَى الْهُدَىٰ
لَا
يَتَّبِعُوكُمْ
ۚ سَوَاءٌ
عَلَيْكُمْ
أَدَعَوْتُمُوهُمْ
أَمْ
أَنْتُمْ
صَامِتُونَ {193}
إِنَّ
الَّذِينَ
تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ
اللَّهِ
عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ
ۖ فَادْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا
لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ
صَادِقِينَ {194}
6.3 Troisième morceau
قُلْنَا
يَا
نَارُ
كُونِي بَرْداً
وَ سَلَاماً
عَلَى
إِبْرَاهِيمَ
nous dîmes ô
feu
soit froid
et salutaire
pour ABRAHAM
Nous avons ici encore trois propositions, et deux césures possibles qui marquent :
– Soit le feu comme l’aspect important, marqué par la particule « ya » introduisant un destinataire, et froid et salutaire comme un seul syntagme s’opposant au feu, brulant et destructeur.
– soit le feu et le froid deux facteurs contingent, qu’Allah annule pour marquer l’importance transcendante du salut pour Abraham.
Les deux premiers membres sont opposés par leur signification matérielle. Le froid est l’opposé de l’aspect brulant du feu. Salutaire est l’opposé de l’aspect destructeur du feu. Il y a une différence de nature ici entre les deux derniers membres. « Froid » ne représente que l’aspect matériel et circonstanciel, l’annulation du bûcher prévu pour Abraham. Salâman donne une perspective plus allégorique. Dans le Coran, Salâm est la promesse faîte à Abraham, le chemin de l’homme l’Islam et le salut, parole paradisiaque. On peut voir ici pointer une opposition entre le feu et l’absence de froid de la géhenne à la paix paradisiaque. Ainsi l’intervention divine fait du bûcher dont il est victime la marque du salut pour Abraham.
Le Coran présente l’action divine comme conclusion d’une histoire a posteriori de sa conclusion humaine. Le Nous divin n’intervient ici qu’après le débat et sa conclusion. Comme dans les punishment stories, ce n’est qu’après la violence humaine actée qu’Allah intervient. Comme nous l’avons déjà remarqué, il n’intervient pas pour détruire le peuple mais pour sauver Abraham. Par sa parole, qui est le moyen de son action sur le monde, Allah ordonne au feu et soumet ce dernier à Abraham, restaurant l’ordre des choses divinité/homme/choses. La promesse divine de paix donnée à Abraham prend ici forme, à la fois comme secours circonstanciel, aboutissement de la confrontation théologique par la parole divine restaurant l’ordre des choses, promesse transcendante prouvée par sa réalisation matérielle.
6.4 Ensemble de la partie
قَالَ
أَفَ تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا
يَضُرُّكُمْ
أُفٍّ لَّكُمْ
وَلِمَا
تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ
اللَّهِ
أَفَ لَا
تَعْقِلُونَ
——————————————————————–
قَالُوا
حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن
كُنتُمْ
فَاعِلِينَ
——————————————————————–
قُلْنَا
يَا
نَارُ
كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً
عَلَى
إِبْرَاهِيمَ
Il dit fi
vous adorez en dehors
d’Allah ce qui ne vous sert en
rien et ne vous nuit pas
Fi de vous
et de ce que vous adorez en dehors
d’Allah
Fi
vous ne raisonnez pas
——————————————————————————————-
Ils dirent brûlez-le et secourez vos divinités
si vous devez faire quelque chose
——————————————————————————————-
Nous dîmes ô feu soit froid et salutaire
pour Abraham
La partie est composée de trois morceaux, dans une forme AA’B. Les trois sont introduits par le verbe dire, terme initial.
Les deux premiers morceaux opposent les conclusions réciproques d’Abraham et de son peuple. Elles portent sur l’utilité des divinités, l’affirmation d’Abraham qu’elles ne servent ni ne nuisent est confirmée par sa reprise dans le second morceau, c’est le peuple qui se propose de les aider et de nuire à Abraham. De même à la question d’Abraham, dont le peuple est sujet de deux verbes : « choisissez-vous d’adorer et de ne pas raisonner ? », nous avons vu que sa volonté « d’agir » répondait positivement à cette question, en opposition à l’autre choix qui était de prendre conscience. Si « agir », qui maque ce choix termine le morceau et est ainsi mis en parallèle avec les deux questions qui encadrent le premier morceau, ce sont ses conséquences pratiques : bruler Abraham et secourir les divinités qui répondent concrètement à adorer et ne pas raisonner. Ainsi leur choix n’est pas seulement un choix théorique, relevant de la simple croyance, mais s’inscrit dans la réalité et se traduit par le meurtre du prophète.
Le dernier morceau reprend en un seul membre les termes du débat. L’aspect nuisible des parties précédentes, incarné – probablement avec les divinités – par le feu, est réduit à son matériel et annulé au profit d’un secours immédiat et transcendant, le salut de la promesse divine.
Les deux morceaux externes se font face par la réalisation de la promesse divine, qui confirme l’inutilité des divinités posée par Abraham, la nocivité morale et pratique de leur religion étant mis en valeur au centre.
Contexte coranique
Le feu
Le feu est utilisé dans différents contexte dans le Coran. Celui du buisson, celui sous la marmite qui fait ressortir les impuretés, celui de l’enfer et celui du bûcher. La sourate 85 fait le lien entre le bûcher que ”les gens de la fosse” ont allumé pour les croyants, et celui de l’enfer dans lequel ils brûleront.
85.3. Par les témoins qui, ce jour-là, se présenteront ainsi que ceux contre qui ils témoigneront !
85.4. Maudits soient les gens de la Fosse ardente,
85.5. au feu sans cesse renouvelé,
85.6. qui s’étaient installés tout autour du bûcher,
85.7. pour jouir du spectacle des croyants suppliciés,
85.8. et auxquels pourtant ils n’avaient rien à reprocher, si ce n’est leur foi en Dieu, le Tout-Puissant, le Digne de louange,
Il est un autre lien qui nous intéresse, dans la troisième sourate, entre ”une offrande que le feu consume” et ”pourquoi les avez-vous tués” ?
3, 181. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit : “Allah est pauvre et nous somme riches”. Nous enregistrons leur parole, ainsi que leur meurtre, sans droit, des prophètes. Et Nous leur dirons : “Goûtez au châtiment de la fournaise.
182. Cela, à cause de ce que vos mains ont accompli ! ” Car Allah ne fait point de tort aux serviteurs.
183. Ceux-là mêmes qui ont dit : “Vraiment Allah nous a enjoint de ne pas croire en un messager tant qu’Il ne nous a pas apporté une offrande que le feu consume”. –
Dis : “Des messagers avant moi vous sont, certes, venus avec des preuves, et avec ce que vous avez dit. Pourquoi donc les avez-vous tués, si vous êtes véridiques” ?
184. S’ils te traitent de menteur ; des prophètes avant toi, ont certes été traités de menteurs. Ils étaient venus avec les preuves claires, les Psaumes et le Livre lumineux.
185. Toute âme goûtera la mort. Mais c’est seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes réussi. Et la vie présente n’est qu’un objet de jouissance trompeuse.
Ce lien entre le meurtre des prophètes, et l’offrande consumée par le feu, rappelle que le sacrifice, parfois humain, est au centre des religions païennes. On lit implicitement dans leur parole, que l’offrande, donc le sacrifice, reste la partie la plus importante de leur religion. Dans le même contexte (riche, meurtre-acte, feu, prophète, parole d’Allah), c’est avant tout le sacrifice que la foule réclame. Si l’on suit leur dire, le prophète n’est accepté que s’il amène une offrande à la (sa) place, une victime de rechange.
Le secours d’Allah
Ce complot échoue, et renvoie à l’histoire du prophète Daniel, lui aussi sauvé du feu.
Nous abordons ici un des thèmes majeurs du Coran, le stratagème d’Allah : jugement contre idolâtres (les plus grands perdants) et secours des prophètes, qui parfois sont assassinés (Abel, …), parfois comme Abraham, Daniel et Jésus en réchappent. Ainsi le Coran en parlant de Muhammad :
8,30 le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t’emprisonner ou t’assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagèmes.
Allah décide de sauver Abraham du feu. Il raconte ailleurs la mort de certains prophètes, mais insiste :
2,154 Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d’Allah qu’ils sont morts. Au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients.
Le rôle du messager est rarement la conversion en masse, mais plutôt un rôle d’avertisseur, puisqu’il appartient à chacun de se convertir ou pas. La logique n’est pas celle d’une victoire terrestre, mais de faire parvenir le message, afin que le jugement contre les criminels soit rendu en toute justice. Puisque la réponse à la révélation est si souvent le meurtre, il importe à Allah de protéger ses envoyés. En évoquant le sort de Ninive, la seule cité à s’être convertie après avoir reçu un envoyé, le Coran l’affirme : il est du devoir d’Allah de secourir les croyants :
10,98. Si seulement il y avait, à part le peuple de Jonas, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité ! Lorsqu’ils eurent cru, Nous leur enlevâmes le châtiment d’ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps.
99. Si ton Seigneur l’avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?
100. Il n’appartient nullement à une âme de croire si ce n’est avec la permission d’Allah. Et Il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas.
101. Dis : “Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre”. Mais ni les preuves ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas.
102. Est-ce qu’ils attendent autre chose que des châtiments semblables à ceux des peuples antérieurs ? Dis : “Attendez ! Moi aussi, j’attends avec vous”.
103. Ensuite, Nous délivrerons Nos messagers et les croyants. C’est ainsi qu’il Nous incombe de délivrer les croyants.
Le secours qu’Allah apporte à ses messagers, contre la violence de la foule, permet de mieux comprendre ce que le Coran relate de la mort de Jésus :
3,52. Puis, quand Jésus ressentit de l’incrédulité de leur part, il dit : “Qui sont mes alliés dans la voie d’Allah ? ” Les apôtres dirent : “Nous sommes les alliés d’Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous Lui sommes soumis.
53. Seigneur ! Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent”.
54. Et ils se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c’est Allah qui sait le mieux leur machination !
55. (Rappelle-toi) quand Allah dit : "Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t’élever vers Moi, te débarrasser de ceux qui n’ont pas cru et mettre jusqu’au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c’est vers Moi que sera votre retour, et Je jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez.
4,157. et à cause leur parole : “Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager d’Allah”… Or, ils ne l’ont ni tué ni crucifié ; mais ce n’était qu’un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l’incertitude : ils n’en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l’ont certainement pas tué.
158. mais Allah l’a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage.
Ainsi dans le Coran enlève à la mort de Jésus toute valeur symbolique, elle s’inscrit dans le processus de rejet des messagers, et son sort est le même que celui des autres : il est sauvé par Allah.
L’ensemble du passage
51a Et
certes nous avons donné à ABRAHAM son chemin auparavant,
et nous avions de lui bonne connaissance
52a Quand il dit à son père et à son
peuple, que sont ces semblances, celles que vous adorez
53 Ils dirent
nous avons trouvé nos pères les servant
54 Il dit certes vous êtes, vous et vos
pères dans un doute manifeste
—————————————————————————————————
55b Ils
dirent viens-tu à nous avec la
vérité, ou bien es-tu de ceux qui jouent
—————————————————————————————————-
56a Il dit, votre seigneur est le
seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créées et moi de
cela de ceux qui témoignent
57a Et par Allah je
vais comploter contre vos idoles après
que vous partiez tournant votre dos
58a Alors je
vais en faire des morceaux sauf la plus grande
d’entre elles afin qu’ils retournent vers elle
59a Ils
dirent, qui a fait cela à nos
dieux ? Certes celui-là est des malfaisants
60a ils
dirent nous avons entendu un
jeune médire d’eux
60b ils
l’appellent ABRAHAM
———————————————————————————————
61a ils
dirent amenez-le sous les yeux des gens afin
qu’eux témoignent
———————————————————————————————
62 ils
dirent c’est toi qui a fait cela à nos
dieux Ô ABRAHAM
63a il dit
non a fait cela, la plus grande d’entre elles, demandez-leurs,
si elles s’expriment
ils retournèrent vers leurs âmes, disant certes vous êtes injustes
puis ils fûrent tournés sur leurs têtes : certes tu savais qu’elles ne s’expriment pas
il dit : fi, vous adorez en
dehors d’Allah ce qui ne sert vous en rien
ni ne vous nuit ?
fi
de vous et de ce que vous adorez en
dehors d’Allah
fi
vous ne raisonnez pas
——————————————————————————————-
ils dirent brûlez-LE et secourez
vos divinités si vous devez faire quelque chose
——————————————————————————————-
nous dîmes : ô feu
soit froid et salutaire pour ABRAHAM
ils voulaient
contre lui un complot et nous avons fait
d’eux les plus grands perdants
وَلَقَدْ
آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ
رُشْدَهُ مِن
قَبْلُ وَكُنَّا
بِه عَالِمِينَ
إِذْ
قَالَ
لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ
مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُالَّتِي
أَنتُمْ
لَهَا عَاكِفُونَ
قَالُوا
وَجَدْنَا آبَاءنَا
لَهَا عَابِدِينَ
قَالَ
لَقَدْ
كُنتُمْ
أَنتُمْ
وَآبَاؤُكُمْ
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
—————————————————
قَالُوا
أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ
أَنتَ مِنَ
اللَّاعِبِينَ
—————————————————
قَالَ
بَل رَّبُّكُمْ
رَبُّ
السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ الَّذِي
فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا
عَلَى ذَلِكُم
مِّنَ الشَّاهِدِينَ
وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ
أَن تُوَلُّوا
مُدْبِرِينَ
فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا
كَبِيراً
لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ
يَرْجِعُونَ
قَالُوا
مَن فَعَلَ
هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ
لَمِنَ
الظَّالِمِينَ
قَالُوا
سَمِعْنَا فَتًى
يَذْكُرُهُمْ
يُقَالُ
لَهُ
إِبْرَاهِيمُ
—————————————–
وا فَأْتُوا بِهِ
عَلَى
أَعْيُنِ
النَّاسِ قَالُ لَعَلَّهُمْ
يَشْهَدُونَ
——————————————–
قَالُوا
أَأَنتَ
فَعَلْتَ
هَذَا بِآلِهَتِنَا
يَا
إِبْرَاهِيمُ
قَالَ
بَلْ
فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ
هَذَا فَ
اسْأَلُو هُمْ
إِن يَنطِقُونَ
فَ
رَجَعُوا إِلَى
أَنفُسِهِمْ فَ
قَالُوا
إِنَّكُمْ
أَنتُمُ الظَّالِمُونَ
ثُمَّ نُكِسُوا
عَلَى
رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ
عَلِمْتَ مَا
هَؤُلَاء يَنطِقُونَ
قَالَ
أَفَ تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ مَا
لَا
يَنفَعُكُمْ
شَيْئاً وَلَا
يَضُرُّكُمْ
أُفٍّ
لَّكُمْ وَ
لِمَا
تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ
أَفَ
لَا
تَعْقِلُونَ
—————————————————
قَالُوا
حَرِّقُو هُ وَ انصُرُوا
آلِهَتَكُمْ إِن
كُنتُمْ فَاعِلِينَ
—————————————————
قُلْنَا
يَا نَارُ كُونِي
بَرْداً وَ سَلَاماً
عَلَى
إِبْرَاهِيمَ
وَ
أَرَادُوا بِهِ
كَيْداً فَ
جَعَلْنَا هُمُ الْأَخْسَرِينَ
L’ensemble du passage. Autre possibilité, à valider par l’étude complète de la sourate
51a Et certes nous avons donné à ABRAHAM son
chemin auparavant, et nous avions de lui bonne connaissance
52a Quand il dit à son père et à son peuple, que sont ces
semblances, celles que vous adorez
53 Ils dirent : nous avons trouvé nos pères les servant
54 Il dit certes vous êtes, vous et vos pères dans un doute
manifeste
—————————————————————————————————
55b Ils dirent viens-tu à nous avec la vérité, ou bien es-tu de ceux qui
jouent
—————————————————————————————————-
56a Il dit, votre
seigneur est le seigneur des cieux et de la terre, celui qui les a créées
et moi de cela de ceux qui témoignent
57a Et par Allah je vais comploter
contre vos idoles après que vous partiez
tournant votre dos
58a Alors je vais en faire des morceaux sauf la plus grande d’entre elles afin qu’ils
retournent vers elle
59a Ils dirent : qui a fait cela à
nos dieux ? Certes celui-là est des
malfaisants
60a ils dirent : nous avons entendu un jeune médire d’eux
60b ils l’appellent ABRAHAM
———————————————————————————————
61a ils dirent amenez–le sous les yeux des gens afin qu’eux témoignent
———————————————————————————————
62 ils dirent c’est toi qui a fait cela à
nos dieux Ô ABRAHAM
63a il dit non a fait cela, la plus grande d’entre elles, demandez-leurs, si elles s’expriment
Ils retournèrent vers leurs âmes, disant certes vous
êtes injustes
Puis ils furent tournés
sur leurs têtes : certes
tu savais qu’elles ne s’expriment
pas
——————————————————————————————————
Il dit : fi,
vous adorez en dehors d’Allah ce qui ne sert vous en rien ni ne vous
nuit ? fi de vous et de ce que vous adorez
en dehors d‘Allah, fi vous ne raisonnez
pas ? ils dirent brûlez-LE et secourez vos divinités si vous
devez faire quelque chose
Nous dîmes : ô feu soit froid et salutaire pour ABRAHAM
——————————————————————————————————-
Ils voulaient
contre lui un complot et nous avons fait d’eux les plus grands perdants
21.71. Et Nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que Nous avions bénie pour tout
l’univers.
21.72. Et Nous lui donnâmes Isaac et, de
surcroît Jacob, desquels Nous fîmes des gens de bien.
21.73. Nous les
fîmes des dirigeants qui guidaient par Notre ordre.
Et Nous leur
révélâmes de faire le bien, d’accomplir la prière et d’acquitter la Zakat.
Et ils étaient Nos serviteurs.
Le chemin
Dans l’introduction Allah a donné un ”chemin” à Abraham. Il est décrit ici : Abraham ”vient à son peuple avec la vérité”. Il est ensuite ”amené sous les yeux des gens” pour être accusé. Le chemin qu’Allah lui a donné est celui du témoignage.
A l’inverse la réaction de son peuple est de ”partir tournant le dos”. Et sa façon de ”revenir” ”vers la plus grande d’entre elles” et son messager, c’est de l’amener au centre de la foule pour l’accuser. Mais de cette manière, c’est son témoignage, et donc Allah, qui est amené au centre de l’attention générale.
Contexte Coranique
Ce passage renvoi directement au passage qui lui fait face dans la sourate précédente, celui du veau que le samaritain fait sortir du feu :
«Pourquoi, Moïse, t’es-tu hâté de t’éloigner de ton peuple?»
«Ils suivent mes pas, dit Moïse.
Je me suis hâté vers Toi, Seigneur,
pour que Tu sois satisfait de moi.»
Le Seigneur dit alors :
« Nous avons mis à l’épreuve ton peuple, après ton départ,
et le Samaritain les a égarés.»
Courroucé et plein d’amertume, Moïse revint vers son peuple :
«Ô mon peuple, s’écria-t-il, votre Seigneur ne vous a-t-Il pas fait une belle promesse?
Avez-vous trouvé cette promesse trop longue à se réaliser ?
Ou avez-vous voulu que la colère de Dieu s’abatte sur vous,
pour avoir trahi votre engagement envers moi?»
«Nous n’avons pas manqué à notre engagement envers toi, répondirent-ils, de
notre propre gré.
Mais on nous a fait porter des charges de bijoux appartenant au peuple de Pharaon.
Nous les avons jetées au feu, le Samaritain en a fait de même,
et il leur a fait sortir des flammes
un veau sous forme d’un corps mugissant.
Et aussitôt l’assistance s’est mis à crier :
“Voilà votre dieu et celui de Moïse qui l’a tout simplement
oublié !”
«Quoi ! Ne voyaient-ils pas que ce veau était incapable de leur répondre
et qu’il ne pouvait ni leur nuire ni leur être utile ?
Pourtant, Aaron leur avait bien dit auparavant :
«Ô mon peuple ! Ce veau n’est qu’une tentation pour vous,
car votre vrai Seigneur est le Miséricordieux.
Suivez-moi et obéissez à mes ordres !»
«Nous ne cesserons pas de l’adorer, avaient-ils répliqué,
tant que Moïse ne sera pas de retour parmi nous !»
Dès son retour, Moïse s’adressa à son frère :
«Ô Aaron ! Qui t’a empêché, lorsque tu les as vus prendre le chemin de l’erreur, de me rejoindre ?
Est-ce par désobéissance à mes ordres?»
«Ô fils de ma mère, dit Aaron, ne me prends ni par la barbe ni par la tête.
J’ai simplement craint que tu ne m’accuses d’avoir jeté la discorde entre les fils d’Israël
et de n’avoir pas observé tes recommandations.»
«Et toi, Samaritain, dit Moïse, quelle raison t’a poussé à agir ainsi?»
«J’ai vu, dit-il, ce qu’ils n’ont pas vu,
J’ai alors pris une poignée de la trace de l’Envoyé
et je l’ai jetée selon ce que mon âme m’a suggéré.»
«Va-t’en, lui dit Moïse. Ton lot dans cette vie sera de dire à quiconque te rencontrera : “Ne me touche pas !”,
sans parler du rendez-vous qui t’est fixé pour l’autre monde et auquel rien ne pourra te soustraire.
Considère ton dieu que tu as tant adoré avec assiduité.
Nous allons le brûler en totalité et en éparpiller les cendres dans
la mer.
En vérité, votre Dieu est Dieu l’Unique, en dehors de qui il n’y a point de divinité.
Il embrasse de Sa science toute chose.»
On retrouve ”un chemin” et des verbes de mouvement, la même thématique contre les idoles incapables, et la même stratégie contre les idoles réduites à néant. Et le feu, au centre du processus d’idolâtrie.
Mais nous verrons aussi dans notre étude sur la théorie de René Girard que ces deux passages représentent deux parties de la théorie mimétique : le meurtre de la victime et la divinisation, toute deux liées par le feu sacré "secourez vos idoles" d’une part, et auparavant "et il leur a fait sortir des flammes (…) “Voilà votre dieu".
Contexte biblique
Nous avons dans l’évangile un passage quasiment identique à celui-ci, de par sa construction, son vocabulaire, et le thème : l’accusation du messager par la foule. Ici encore, il en réchappe. C’est le passage de la femme adultère :
At
dawn again he shows himself to the temple
and
all the people comes to him
and
sitting he taught them
———————————————————————————————————————————————————————–
bring the scribes and the pareses one
women in adultery
was surprise
and
placing her in the middle
said
to him teacher this
women was surprise doing adultery
and in the law to us
Moses taught to stone her
you what
say
all
this they say testing
him
for they can accuse
him
_________________________________________________________________________________________________________
But Jesus down stoop
from his finger writing on earth
as they persist asking him
he stand and
say to them
——————————————————————————————————————————————————–
the one without sin first to her
throw
the stone
——————————————————————————————————————————————————–
and
again stooping
writing on earth
them hearing
and turning to their
conscience
went out one
by one
beginning from
the older to the younger
_______________________________________________________________________________________________
and stayed Jesus and the women in the middle
stand Jesus
and no one was seen except
the women
said
to her women
where are they
nobody
condemn you
she
said nobody
Lord
say
Jesus not
me you I
condemn
go and
from now don’t sin again
Les similarités entre les deux textes sont extraordinaires. La première partie montre l’accusation, l’accusée est placée ”au milieu” comme Abraham était ”sous les yeux des gens”. La partie centrale montre la stratégie de Jésus, comme celle d’Abraham, elle ridiculise l’accusation et la pousse à réfléchir. La dernière partie montre les accusateurs réfléchissants, et leur complot échoué.
Il y a encore les deux chemins : Jésus dans celui-ci reste immobile : il ”se montre au temple”, ”s’assoit”, ”se relève”. C’est le peuple qui ”vient à lui” cette fois. Comme dans notre texte, les accusateurs (des notables encore ! Dont fait maintenant partie la prêtrise) font ”amené” la victime, puis ils ”tournent sur leur conscience”, comme auparavant ils ”retournaient vers leurs âmes”.
Tout ici tourne autour du débat, puisque Jésus enseigne. L’aspect visuel (les statues) a presque disparu, mais reste présent (”surprise”, personne ”n’est vu”).
2000 ans après Abraham, des choses ont changées, ”la loi de Moïse” a transformée la situation. Il n’y a plus de statues, les hommes ont un écrit auquel se référer. Pourtant, le processus d’accusation demeure, la foule continue à rechercher une victime. Mais la connaissance du pêché, et la responsabilité individuelle ont fait leur chemin chez les enfants d’Israël. Ils permettent à Jésus d’éviter le lynchage de la femme. Puisqu’ils ont conscience de leur propres pêchés, et ”qu’un autre ne peut pas porter leur charge” la foule ne peut plus ”tourner sur sa tête”, c’est à dire faire semblant de retrouver son innocence par un assassinat collectif.
Jésus n’est pas accusé directement, les notables utilisent la femme comme un piège contre lui. Il aurait pu l’accuser lui aussi, mais s’il le faisait, il cédait aux accusateurs, participait au jeu du meurtre collectif, et aurait tué la femme pour sauver sa vie. Or il vient pour guérir (l’aveugle, le lépreux, les pêcheurs). Comme tous ceux qu’il sauve, la femme le reconnaît (”Lord”). Comme à l’infirme, il lui enjoint de ne plus pêcher. ”Si vous saviez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices, vous n’auriez pas condamné des innocents.”
”Eux écoutant et se tournant vers leur conscience” est présente dans certains manuscrits, mais n’est pas gardée dans la recension de Nestlé Allant. Le passage coranique, et sa proximité importante avec ce passage nous a incité à les gardés dans cette analyse. Le Coran semble faire référence aux manuscrits de types byzantins, notamment les familles m5 et m7, privilégiées par les tenants de la "théorie majoritaire", voir Wilbur Pickering (1980/2014), Hodges & Farstad (1982/1985), and Robinson & Pierpont (2005).
Jésus ne déplace pas, son seul mouvement est de se relever. Il écrit sur la terre (ici ”terre” renvoit à ”pierre”, et à ”femme”, les deux mots sont presque similaire en grec et ils occupent la même place), ces trois termes correspondent dans notre texte aux statues (la pierre, la femme placée au milieu) et à la création (la terre et le ciel). Dieu est absent du texte, mais présent en arrière-plan par ses messagers (Moïse, Jésus) et parce qu’il est l’objet de la dispute dans les deux cas : entre les prêtres et l’envoyé, qui est sur la bonne voie ? Or la bonne voie est accessible à tous, elle n’a pas à faire l’objet d’une dispute. On retrouve le même problème qu’entre Abel et Caïn, c’est parce que Dieu accepte le sacrifice d’Abel qu’assassine son frère par jalousie. Et effectivement les scribes et les parisiens en arriveront à vouloir tuer Jésus, comme son peuple Abraham. La suite du passage confirme la proximité des deux textes, notamment en renvoyant à Abraham, les deux premiers vers sont une accusation redoutable, quand on lit le texte du Coran.
Ils lui répondirent : Notre père, c’est Abraham. Jésus leur dit : Si vous étiez enfants d’Abraham, vous feriez les œuvres d’Abraham.
Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j’ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l’a point fait.
Vous faites les œuvres de votre
père. Ils lui dirent : Nous ne sommes pas des enfants
illégitimes ; nous avons un seul Père, Dieu.
Jésus leur dit : Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens ; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé.
Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds ; car il est menteur et le père du mensonge.
Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas.
Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?
Celui qui est de Dieu, écoute
les paroles de Dieu ; vous n’écoutez pas, parce que vous n’êtes pas de Dieu.
Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui ; mais Jésus se cacha, et il sortit du temple.
78 La Grande prophétie – Analyse rhétorique de la Sourate Al Naba
Article disponible sous format PDF :
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ {1}عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ {2}الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ {3}كَلَّا سَيَعْلَمُونَ {4}ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ {5}أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا {6}وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا {7}وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا {8}وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا {9}وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا {10}وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا {11}وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا {12}وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا {13}وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا {14}لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا {15}وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا {16}إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا {17}يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا {18}وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا {19}وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا {20}إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا {21}لِلطَّاغِينَ مَآبًا {22}لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا {23}لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا {24}إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا {25}جَزَاءً وِفَاقًا {26}إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا {27}وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا {28}وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا {29}فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا {30}إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا {31}حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا {32}وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا {33}وَكَأْسًا دِهَاقًا {34}لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا {35}جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا {36}رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا {37}يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا {38}ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا {39}إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا {40}
Le texte français de la sourate, selon notre traduction :
Au nom de Dieu, le Miséricordieux, le tout Miséricordieux
1 Sur quoi s’interrogent-ils ? 2 Sur la grande prophétie, 3 celle dont ils se détournent. 4 Non ! Ils sauront. 5 et encore non ! Ils sauront. 6 N’avons-Nous pas établi la terre un berceau 7 et les montagnes des piliers ? 8 Et Nous vous créâmes par paire 9 et établîmes votre repos sabbatique. 10 Et nous établîmes la nuit une couverture. 11 Et nous établîmes le jour avec la vie. 12 Et nous construisîmes au-dessus de vous sept firmaments, 13 et établîmes une lampe éblouissante. 14 Et Nous descendîmes des nuages une eau abondante, 15 et sortîmes par elle des graines et des pousses 16 et des jardins luxuriants. 17 Ainsi le jour de la séparation était appointé, 18 le jour où sera soufflé dans la trompe ; et vous êtes amenés, multitudes. 19 Et s’ouvrent les cieux ; et adviennent des portes, 20 et déplacées, les montagnes, deviennent mirages. 21 Ainsi la géhenne était à l’affût. 22 Pour les transgresseurs, un refuge 23 ils résident en elle pour toujours 24 et n’y goûteront ni fraîcheur ni breuvage 25 mais chaleur et obscurité. 26 Une récompense agréée 27 Ainsi eux n’auraient pas rendu compte ? 28 Et ils proféraient sur nos versets des mensonges ! 29 Et toutes choses avons-nous dénombrées par écrit. 30 Goutez donc, nous n’ajouterons pour vous que du tourment. 31 Ainsi pour les pieux, une consécration, 32 un verger et des vignes, 33 et des arrondies pulpeux, 34 et des verres remplis. 35 Ils n’y entendent ni futilités 36 ni mensonges, 37 une récompense de ton Seigneur, donnée pour compte. 37 Le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux ; Le Miséricordieux, dont ils ne possèdent pas l’attention. 38 Le jour où se lève l’esprit, et les anges en rang ; ils ne parleront pas. Sauf celui qu’écoute Le Miséricordieux, qui avait dit (une vérité) percutante. 39 Tel le jour de Vérité. Alors celui qui l’avait voulu prendra refuge en son Seigneur. 40 Ainsi, nous vous avions averti d’un tourment proche, le jour où contemple l’homme ce qu’a avancé sa main, et dit le dénégateur : « si seulement j’étais poussière ».
Nous allons étudier ici la 78e sourate du Coran, Al Naba, selon les principes de la rhétorique sémitique, systématisée pour la Bible par Roland Meynet dans son « Traité de rhétorique sémitique »[1], puis pour le Coran par Michel Cuypers, dont l’excellente étude de la sourate al-Mā’ida[2] nous a amené à découvrir un monde rigoureux et savoureux, ou le sérieux de l’étude permet d’ouvrir les portes de la compréhension et le voyage parmi les fils des références.
Nous voyons dans cette sourate un incipit et 3 parties, de la façon suivante :
La grande prophétie (v. 1 à 5)
Le jardin de la création (v. 6 à 16)
Le jour de la séparation (v. 17 à 36)
Le jour de vérité (v. 37 à 40)
Al Naba al Aḍem – Incipit
Cette première partie, qui introduit la sourate n’est composée que d’un morceau.

Ce premier morceau est composé de trois segments (versets 1, 2-3 puis 4-5). Les deux premiers segments sont introduits par la préposition « sur », terme initial, qui porte l’intérêt du lecteur sur « la grande prophétie ». Les deux premiers verbes marquent l’effet de la prophétie sur le peuple (« s’interrogent », « divergent ») entre incompréhension et division. Le troisième segment redouble sa négation définitive (« non, et encore non ») en un segment bimembre. Le verbe répété de ce dernier segment, « ils sauront », répond à l’interrogation du premier segment. Il marque une certitude et une réponse à l’avenir. Ainsi la réalisation de l’annonce remédiera à l’état d’incertitude qu’elle créé. Au centre, la réponse du peuple (diverger, se détourner) est au contraire de s’éloigner du message. Le dernier verset de la sourate sera explicite sur le sens à donner ici.
La grande prophétie et son effet dans le segment central (2-3) génèrent ce qui se passe aux extrémités. Le membre central joue un rôle de pivot entre la question (1) et sa réponse (4-5). Le sens de « al nabâ », trouve son cadre entre questionnement interne à la société[3] et annonce d’un avenir. Plutôt que la traduction traditionnelle « la grande nouvelle », le sens de « prophétie » nous parait imposé par le contexte. « Nabâ » provient de la même racine que prophète[4]. Nous verrons plus loin la pertinence de ce choix.
La seconde partie
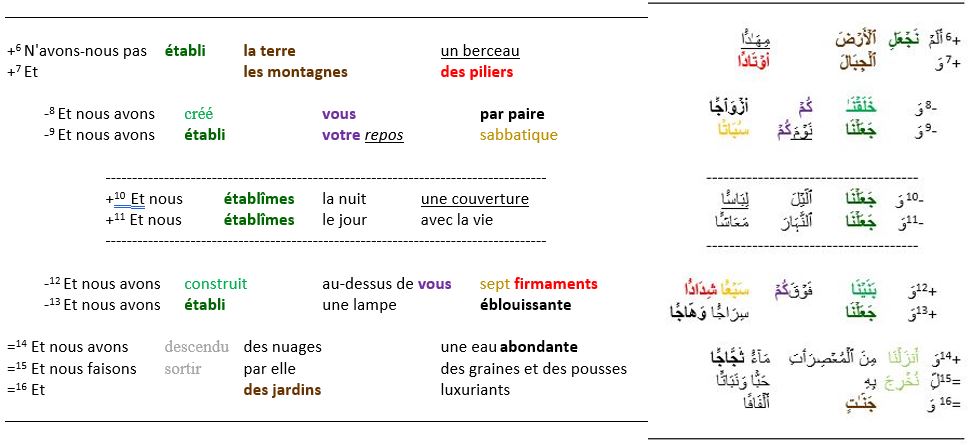
L’ensemble de la partie est rythmé par des segments bimembres incluant plusieurs paires (la terre et les montagnes, le jour et la nuit, les cieux et le soleil), à l’exception du dernier segment trimembre. Et par la rime en « ân » qui termine chaque membre. Les verbes indiquent l’action divine, « établir » revient 5 fois, avec « créer » et « construire ». Le parallèle fort entre les segments 8-9 et 12-13 marque la construction de cette partie et lui donne sa forme concentrique : la reprise de « vous » par trois fois, le parallèle entre « créer » et « construire », l’assonance entre « أَزۡوَٲجً۬ا » et « وَهَّاجً۬ا » et entre « sabbatique » et « sept ». Ces symétries marquent la structure concentrique de cette partie : trois morceaux agencés dans une forme ABA’, avec les segments de A et A’ formant un chiasme. Les « piliers » qui tiennent la terre et les « sept renforçant » qui maintiennent les astres, la terre et les cieux, sont les termes initiaux des parties A et A’.
Le morceau A (6-9), a pour thème la terre, dans laquelle l’homme est créé. Les deux occurrences de « établi » ainsi que « berceau » et « repos » encadrent le morceau, et font de celle-ci un creuset pour l’homme.
Les sept cieux donnent le cadre du morceau A’ (12-16). L’assonance entre la lampe éblouissante « وَهَّاجً۬ا » et l’eau abondante « ثَجَّاجً۬ا » fait le lien entre les deux segments (terme crochet). Dans le dernier segment, l’action divine se fait par médiation des nuages et de l’eau, avec deux verbes dans des directions opposées (descendre, sortir), qui produisent le « jardin luxuriant ». « Luxuriant » avec « abondante » encadre ce dernier segment. Tout comme les « cieux » et le « jardin » encadrent l’ensemble du morceau A’.
Au centre, l’opposition entre le jour et la nuit structure l’ensemble de la partie. Dans la première partie la « couverture » renvoi à des noms évoquant le repos : « berceau », « repos sabbatique », qui protègent l’homme sur terre. Tandis que la « vie » du jour renvoie à des adjectifs actifs : « renforçant », « éblouissant », « abondant », « luxuriant », aux « graines et plantes » qui foisonnent dans le jardin. Cette dualité des effets du jour et de la nuit organise le mouvement qui transforme la terre en jardin où la vie abonde. Sous l’action de Dieu, qui anime ces dualités, la terre devient fertile, en particulier par la descente de l’eau, exemple récurrent dans le Coran.
Les sept cieux
Le terme « shidadân » désigne d’évidence les cieux. Il est issu de la racine SHDD qui signifie « renforcer ». Ce sens renvoi à tous les termes utilisés dans l’antiquité pour traduire l’hébreu רָקִיעַ, l’étendue des cieux qui supporte les astres, ici le soleil.[5] Ainsi du grec στερέωμα (support, fondation, ferme)[6] de la septante, du latin firmamento de la vulgate (de firmāre renforcer et mentum, suffixe indiquant un instrument, un moyen)[7], qui donnera « firmament » en français.
Comme le remarque Tommaso Tesei, le Coran reprend à la fois l’idée biblique de firmament qui supporte les astres et sépare la terre des eaux primordiales, et l’idée des 7 sphères concentriques des mondes gréco romain et babyloniens, dans chacune desquels un astre évolue[8]. Ces « sept cieux » du monde gréco-romain s’étaient imposés dans les textes apocryphes, par exemple les apocalypses de Baruch et d’Enoch. On les retrouvera également dans la sunna, en particulier dans l’épisode du voyage de nuit de Muhammad. Ces 7 sphères ont donné lieu dans l’empire romain, aux sept jours de la semaine, nommés en fonction des divinités associées à leurs astres respectifs. Ici ils disparaissent ici au profit d’une simple semaine de 7 jours terminés par as-sabt, repos commémorant un Dieu unique Créateur des cieux et de ses astres.
Ces deux conceptions, en débat sous le ciel byzantin, sont corrigées l’une par l’autre dans le Coran : le dôme éloignant les eaux du dessus est remplacé par des sphères concentriques, qui se sont imposés tant dans la littérature que dans la compréhension du monde de l’époque. Tandis que, mise en regard du Dieu biblique, les planètes et les étoiles ne sont plus des divinités, mais des luminaires et des planètes, tous placés dans le ciel inférieur. Ils ne sont associés à aucune divinité, et sont dépourvus de tout aspect mystique. Cette démystification est transcrite littérairement et figurativement dans l’idée que les jinns ne puissent plus y monter chercher des informations à transmettre aux magiciens ou devins, comme ils le font dans la littérature énochienne, les astres leur barrant désormais le passage.
Contexte Coranique
Cette partie développe le verset 22 de la sourate la vache, qui en rappelle le sujet : “C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit ; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir“. Voir aussi en 31.10, 39.21. L’utilisation du terme arabe « janat » (16, jardin), habituellement utilisé pour le paradis, renvoi ici au jardin d’Eden cadre de la création de l’homme.
Contexte Biblique
L’objet de cette partie est la création des cieux et de la terre, la création de l’homme et le jardin. Nos quatre premiers segment reprennent le premier chapitre de la Genèse : les cieux et la terre (G.1:7-10), le jour et la nuit (G.1:5), les plantes (G. 1:11-12), les luminaires (G.1: 14-18), l’humanité par paire (G.1:27) et la cessation des activités au 7e jour (G2:2-3). Notre dernier segment (14-16) rassemble en trois versets plusieurs du second chapitre : à la suite des 7 jours de la création, vient directement le jardin d’Eden (G. 2.8 et 2.15) dans lequel est créé l’homme (G. 2.5-15). Avec la même référence à la descente de la pluie (G. 2.5-6) ainsi qu’aux plantes (G. 2.5 et 2.9).
L’ordre est différent, tandis que le récit biblique se fait selon un ordre chronologique linéaire, la structure du texte coranique établit une dynamique d’ensemble faite d’opposition, entre la terre comme abris, réceptacle, et les cieux source de lumière et d’eau. Cette dynamique, qui transforme la terre en jardin se retrouve au centre dans l’opposition entre le jour et la nuit. Le repos de la nuit précède la lumière du soleil, faut-il y voir une référence discrète au tout début de la création ?
Le lexique choisit ici est également une référence au texte biblique. Ainsi, si l’on se réfère à l’étude de Catherine Pennacchio, le mot arabe « janat » est un emprunt à l’hébreu gan, utilisé dans le texte de la Genèse (G. 2.8 et 2.15). Le Coran l’utilise pour le jardin d’Eden ainsi que pour les jardins du paradis. De même « subâtân », de la racine SBT, signifie “cessation des activités” fait certainement partie de la référence générale au texte de la genèse (G. 2:2).[9] L’institution du Shabbat, le 7e jour de la semaine, parmi les dix commandement est elle-même une référence à la création[10]. Le terme français gardant cette équivalence avec l’idée de cessation du travail (année sabbatique), nous le choisissons comme traduction.
Le terme “sirâjân” (13, « lampe ») trouverait son origine première du perse[11], il conserve cependant comme l’hébreu “meo’rot” (G. 1.14) l’idée monothéiste de réduire l’astre solaire à sa fonction de luminaire, à l’exclusion de toute divinité. E. El-Badawi, trouve dans les Evangiles araméens l’origine de l’emploi de “sirâj” dans le Coran : alors que le terme arabe “miṣbâḥ” correspond à la sphère divine dans le passage central de la sourate Al Nour (C 24.35), “sirâj” est employé pour la sphère humaine, notamment pour le prophète (C 33:41-46), comme il est utilisé dans les évangiles araméens pour les croyants (Mat 5:14-16), Jésus et Jean le Baptiste (Jean 5:35-36)[12]. Il y a ainsi un lien ténu entre la lumière des astres ici, et celle de la prophétie, qui sera repris par la suite.
Interprétation
Cette partie reprend en condensé la description de la création du monde et du jardin d’Eden telle que décrite dans les deux premiers chapitres du livre de la Genèse. La structure permet de mettre en valeur la dynamique de la création, qui par l’action de Dieu passe d’une terre à un jardin luxuriant, sans toutefois faire appel à des divinités ou une compréhension mystique. Le parallèle central entre la nuit et le jour permet de distinguer entre une première création qui donne le cadre dans le premier morceau, et l’action continue de Dieu, relayée par les éléments actifs, le soleil, la descente de l’eau, les plantes luxuriantes dans le dernier. La nature décrite ici n’est plus ni inerte ni expression de divinités, elle acquiert sa propre place et participe d’une dynamique d’ensemble rythmée par la succession du jour et de la nuit. Il reste possible de voir en filigrane une métaphore de la révélation divine dans la descente de l’eau et de la parole prophétique dans la lumière des astres, qui nourrissent l’intelligence comme ceux-ci donnent la vie.
La troisième partie
La première sous partie
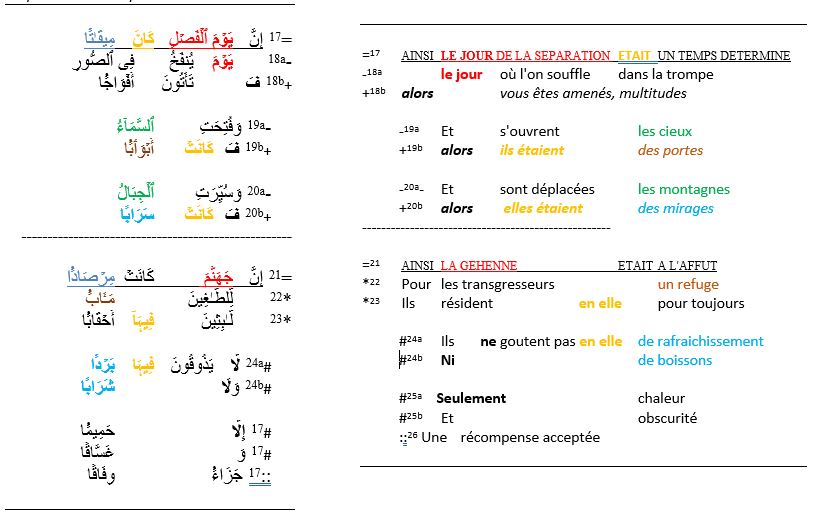
Cette sous partie est composée de deux morceaux semblables, construits sur un même rythme ABB’, où BB’ est le développement du segment A. Les trois segments du premier morceau sont trois actions suivies de leur résultat annoncé par la conjonction « fa (alors) ». Les trois segments du second morceau sont constitués d’un sens redoublé.
Les segments A de chaque morceaux (17-18 et 21-23) sont semblables, en particulier leur premier membre est quasi identique, présentant respectivement le jour de la séparation et la géhenne. Celui du premier est en mouvement (souffle, amenés), celui du second une arrivé (refuge, résident).
Les segments BB’ du premier morceau présentent ce qui disparait au jour de la séparation, ceux du second morceau ce qui sera dans la géhenne. Les deux derniers segments sont parallèles dans le premier morceau (les cieux et les montagnes ne sont plus), et sont opposés dans le second morceau (eau contre chaleur) par une répétition de négations.
Seul le tout dernier membre du second morceau (« Une récompense acceptée ») n’a pas d’équivalent ici mais fait partie des liens avec la dernière partie (« récompense »). Il est conclusion de l’ensemble : c’est toute la séparation effectuée ce jour qui est acceptée. La porte du premier et le refuge du second morceau sont deux images sur le thème du bâtiment. La porte du jour de la séparation ouvre sur la demeure dernière.
Interprétation
Le souffle dans la trompe marque un renversement, la disparition des deux éléments solides et protecteurs décrits dans la première partie : les cieux et les montagnes. Leur disparition entraine le changement de contexte : les cieux devenant des portes dans le ciel sont un élément typique de l’Apocalypse[13], les montagnes deviennent des mirages, notion du désert, qui préfigurent le manque d’eau et la chaleur intense de la géhenne.
Yaom al Faṣl
Comment traduire « yaom al Faṣl » ? J. Berque traduit par démarcation, M. Gloton par séparation. Yusufali, en anglais par “sort out”, le tri. Le sens matériel du terme, en 2.249 et 12.94 est « partir » (« 12.94 Quand la caravane partie, leur père dit … »). Qui pourrait induire « séparation » en sens figuré. La forme II, « rendre séparé », veut dire détailler en 6.97 : « Certes Nous détaillons les versets pour un peuple qui comprend ». En 2.249, le sens pourrait être ambigu, quelque part entre « départ » et « trier », Saul fait à ce moment à ce moment le tri dans son armée, départageant ceux qui l’écoutent des autres[14]. Quatre références explicites au jour du jugement vont permettre d’approcher le terme dans notre contexte :
En 32.25 « C’est ton Seigneur qui distinguera entre eux, au jour de la résurrection, en ce sur quoi ils divergeaient. »[15] : leurs divergences sont à l’origine de la distinction entre les personnes. La forme prise par ce verset (entre eux, les divergences) le rapproche des expressions de la forme II de FSL : « expliquer, détailler ». La sourate 42 présente un parallèle intéressant. L’occurrence du verset 21 (« 21. Et sans la parole déterminante, il serait jugé entre eux ») synthétise le verset 14 : « De fait ils ne se sont divisés qu’après que leur soit venue la connaissance. Et sans une parole précédente de votre Seigneur vers un temps spécifique, il serait jugé entre eux. » Cette parole déterminante précède les action et renvoi leur jugement à un temps ultérieur, noter les divisions que provoque déjà la connaissance. Ce double aspect fait de la parole donnée à Adam en 2.37-39 un candidat pour cette parole. Dans le verset 44.40, qui nomme « le jour de la séparation » ce temps appointé que nous retrouverons dans la sourate Al Naba : « Certes le jour de la séparation est leur terme, à tous rassemblés. (« إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ »). Noter l’opposition entre « séparation » et « tous rassemblés », redoublée par le verset suivant : « 41. Un jour où aucune relation ne peut pour une autre quelque chose, et où ils ne pourront être aidés. ». En 60.3, au jour dernier, on retrouve explicitement ce sens de séparation : « Vos proches et vos enfants ne vous servirons de rien au jour de la résurrection, Il séparera entre vous ». Ces versets aident à déterminer le sens du terme : un rendez-vous pour toute la multitude (verset 78.18) successivement rassemblée, individualisée et séparée par le jugement. Comme dans l’incipit, la connaissance provoque cette séparation, qui est différée.
Ce jour al-faṣl est le jour du jugement, où les gens sont séparés à partir de leurs divergences[16], où les routes qu’ils ont prises trouvent leur aboutissement. La notion d’explication en 32.25 fonde cette séparation, qui fait que le jugement est accepté, logique. Parmi tous les synonymes, nous choisirons séparation, comme M. Gloton, terme qui présente l’avantage de pouvoir être réutilisé pour toutes les autres occurrences.
La seconde sous partie

Le premier segment est construit de 3 membres organisés dans une forme concentrique ABA’. Les deux membres externes opposent l’illusion d’impunité des hommes au décompte de toute chose par Dieu, opposition marquée par le parallèle entre « compte » à rendre et « décompte » de toute chose. Le membre central fait le lien entre l’écriture du décompte et les versets divins (« verset », « écrit »), qu’il oppose au mensonge et à l’irresponsabilité (« mentir », « ne pas rendre compte »). Le texte fonde ainsi une égalité de sens entre mentir sur les versets et rejeter cette responsabilité individuelle des actions, que ces versets affirment de façon récurrente. La simple revendication que toute chose est écrite fonde les versets comme représentant d’une réalité objective et pose leur rejet comme refus des conséquences potentiellement négatives de l’action humaine.
Dans le second segment, les verbes goûter et ajouter renvoient au même complément, qui n’est pas mentionné (à quoi goutent-ils ?). Suggérant un lien entre ce dont ils jouissent de manière injuste et le « tourment[17] » qui s’ajoutera à cela. Le terme « goûter » figure la nourriture, évoquée dans la première partie où l’homme avait de tout en abondance. L’injustice n’est donc pas nécessaire et montre l’ingratitude et à l’insouciance de l’humanité en regard de ce qu’elle avait reçu. Ce qui explique le tourment, établi à partir d’un compte strict, alors que le don, lui, n’était pas compté.
Le parallèle entre l’addition, le compte à rendre, et le tourment encadre le morceau, avec la reprise du pronom « ils » en « vous ».
Les actions
Il y a un non-dit fort dans ce premier verset, c’est l’action des hommes, mentionnée indirectement par “rendre des comptes” : sur quoi l’homme doit il rendre des comptes ? Parmi “toutes les choses” du 3e membre, qu’il y-a-t-il que Dieu note qui soit mis en parallèle avec ces comptes ? Pourquoi l’homme rejette les versets ? Ce verset de l’Evangile de Jean vient à l’esprit : 3:19 “La lumière est venue dans le monde mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.” Ainsi s’explique le lien entre le mensonge sur les versets et « ne pas rendre de compte » : les versets sont le révélateur des actions.
Les versets et l’écrit, placés au milieu de cette partie et de toute la sourate, sont une lumière, qui révèle les actions des hommes. Or le texte créé une difficulté, car il s’attache non pas à cette lumière, mais à sa négation par l’homme. Ce que le texte révèle, c’est le mécanisme par lequel l’homme nie ce qui lui a été révélé pour ne pas comprendre ce qu’il fait.
La troisième sous partie
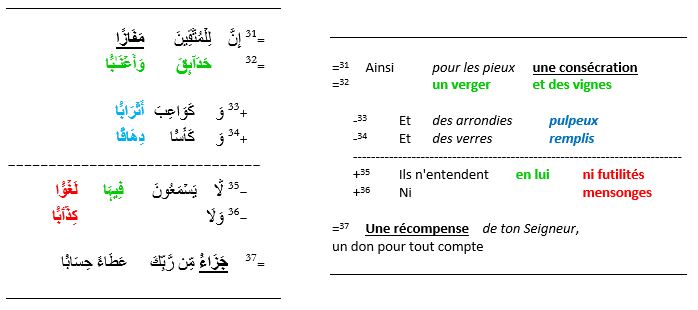
Deux morceaux, dont les quatre segments sont arrangés en chiasme ABB’A, forment cette dernière sous partie. La « consécration » fait inclusion avec « la récompense », les deux encadrent l’ensemble. Le « verger », repris par « en lui » dans le verset 35, est terme initial des deux morceaux.
Le premier segment du premier morceau pose comme cadre du paradis un verger[18], avec ses produits dans le second segment. « كَوَاعِبَ أَتْرَابًا » est difficile à traduire, l’on peut cependant s’appuyer sur le parallèle avec les verres remplis et le contexte coranique qui sera étudié plus bas. La racine K3B décrit la forme arrondie (la bosse des chevilles). Le parallèle avec « verres » est habituellement occupé par « des coupes », أَكْوَابٍ, fortement assonnant avec كَوَاعِبَ. Pour « أَتْرَابًا », toujours qualificatif des houris, le parallèle ici avec « remplis », et la racine sémitique TRB signifiant gras, ou pulpeux, en hébreu et en syriaque, font de « pulpeux » un sens très probable[19]. Ces quatre versets très rythmés condensent les références paradisiaques aux houris, mais aussi aux fruits et aux nectars.
Le second segment porte la négativité de la sous partie. En même temps qu’elle port une critique du monde, l’absence des vanités et des mensonges décrit ceux qui y sont reçus. Le fait que les pieux, les respectueux[20], reçoivent cette absence comme une récompense fait d’eux des personnes véridiques, fatigués par la fausseté du monde. A l’opposé de celle-ci, c’est « Ton Seigneur » qu’ils ont préféré.
Les deux morceaux apposés présentent les bonnes choses produites sur terre, dont sont retranchés la vanité et les querelles, alors que la sensualité et le goût ont conservés. Le tout est un don « pour les pieux » « de ton Seigneur », qui ont su Le préférer à l’inutile.
Contexte Coranique
Le Coran développe en plusieurs textes ce thème du jardin, et la lecture attentive de ceux-ci nous ont été nécessaires pour comprendre et traduire le premier morceau. Les variations sur le thème échangent les places des termes et les façons de les assembler. Il nous parait utile de les citer ici en long, tellement ces autoréférences sont parlantes entre elles[21].
Danis un court segment de la sourate 56, ce sont des garçons et plus des filles qui apportent les nectars. Autre variation, c’est le nectar lui-même qui, à l’opposé de l’alcool, ne provoque pas les vanités. Ainsi 56.17-19 (notez le parallèle entre les coupes et les verres) : « Parmi eux circuleront des garçons inaltérables[22], avec des coupes, des jarres et un verre de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. » suit son parallèle, plus proche de notre texte : 56.22-26 « Et ils auront des houris aux grands yeux, pareilles à des perles cachées, en récompense pour ce qu’ils faisaient. Ils n’y entendront ni futilité ni blasphème ; seulement la parole « Salam ! Salam ! ». Le parallèle est fort entre les houris et les garçons du paradis, aussi comparés à des perles en 52.23-24« Là, ils se passeront les uns les autres des verres sans vanité en eux ni incrimination. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service, pareils à des perles cachées. » Cette longue continuité dans les récits du paradis nous pousse, plutôt qu’à faire disparaitre les houris, à y voir un parallèle masculin, agréables aux yeux des femmes accédant au paradis.
Dans ces jeux de références croisées, on retrouve également en lien avec les coupes et les verres les différents nectars du paradis. « Les vertueux boiront d’un verre dont le mélange sera de camphre, d’une source de laquelle boiront les serviteurs d’Allah et ils la feront jaillir en abondance. » et surtout 15-19 : « Et l’on fera circuler parmi eux des vaisselles d’argent et des coupes cristallines, en cristal d’argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d’un verre dont le mélange sera de gingembre, puisé là-dedans à une source qui s’appelle Salsabil. Et parmi eux, circuleront des garçons inaltérables. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. ». Ou encore en 37.45-49, un parallèle joliment construit entre les sources et les houris[23], qui donne un cadre à celui entre nos versets 33 et 34 :
« On fera circuler entre eux de verre d’une source vive (مَعِينٍ) ; blanche, savoureuse à boire.
Elle n’offusquera point leur raison et ne les enivrera pas.
Et auprès d’eux, au regard chaste, des yeux (عِينٌ)
Semblables au blanc caché de l’œuf. ».
Ainsi les arrondis pourraient renvoyer aux perles que sont les jeunes, filles et garçons du paradis.
Chaque mot utilisé ici est chargé de références à d’autres passages du Coran, qui amplifient la densité et le pouvoir d’évocation de l’ensemble, et alimentent sa cohérence propre : préférer les bonnes choses que Dieu approvisionne à la vanité conflictuelle du monde. On pourrait voir un paradoxe dans l’opposition entre l’évocation sensuelle des bonnes choses et la futilité, sauf à remarquer que le Coran appuie sa logique, et ses valeurs, sur la beauté du réel, provision divine servie par les descriptions naturalistes. Dont le partage[24] s’oppose à la perte du sens, du réel, de l’important, et trouve ici sa récompense.
L’ensemble de la troisième partie

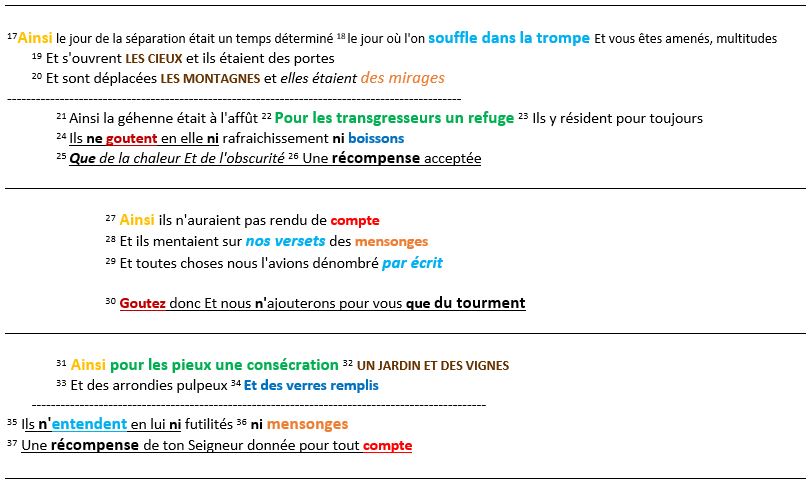
La partie est construite de trois sous parties commençant par le terme initial « ainsi ». Les deux sous parties externes sont constituées chacune de deux morceaux. L’ensemble des morceaux forme un chiasme AB x B’A’ autour de la sous partie centrale. Les « cieux » et les « montagnes » puis le « jardin » sont les termes initiaux des deux parties externes, qui se terminent ensuite par le même terme final « récompense », auquel fait écho le « tourment » de la partie centrale. Ces limites initiales et finales délimitent les trois unités principales. Chaque sous partie externe est terminée par une construction négative « Il n’y a en elle/lui ni … ni » et le morceau central par « Nous n’ajouterons que ». Dieu récompense d’un monde qui est conséquence directe des actions humaines.
Le « souffle dans la trompe » (18) disperse les « mirages » dans le morceau A. Il trouve sa réalisation dans « entendre » (35) quand il n’y a plus de « futilités » dans le morceau A’. Les deux morceaux encadrent la partie. Ce thème d’une vérité sonore fait ressortir « les versets » et « l’écrit » dans la partie centrale.
Les deux morceaux B et B’ mettent en opposition la géhenne et le jardin à travers les deux membres opposés « Pour les transgresseurs une cache » et « pour les pieux une consécration ». L’atmosphère étouffante, sans « boisson » et avec des « mirages » trouve son opposé dans les « verres remplis » du jardin. Le résultat pour chacun est étroitement lié à la présence (ou l’absence) d’eau.
La sous partie centrale est composée d’un seul morceau. Nous y lisons un renversement au centre car les parallèles avec les autres sous parties y apparaissent dans l’ordre inversé[25]. « Compte » et « mensonge » du premier membre se retrouveront dans les « futilités » et « mensonges » de la dernière sous partie, alors que « goûter » dans le dernier membre se retrouvent dans « ils goutent » dans la première sous-partie. Ce centre, un commentaire extérieur sur le monde d’aujourd’hui, est le pivot des deux parties externes qui elles se passent au jour dernier.
Contexte
Cette partie reprend plusieurs thèmes apocalyptiques. Les nombreuses trompettes de l’Apocalypse de Jean, annonçant les étapes de la fin du monde, sont ici rassemblées en une seule. Nous allons voir ci-dessous comment la connaissance des contextes bibliques et coraniques permet de mieux saisir les enjeux évoqués dans la sourate.
Les portes
Les portes sont déjà présentes dans le contexte apocalyptique biblique. Les portes de la Jérusalem céleste (Apocalypse 21.9-22.25). Et surtout dans l’Evangile de Mathieu, une invitation faite aujourd’hui à entrer au jour dernier par la porte dans le royaume des cieux. Mathieu 7.13-23 : « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. (…) 21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »[26]. La dernière phrase met ici aussi en avant les œuvres.
Le thème de la porte revient plusieurs fois dans le Coran. D’abord dans la sourate Le Festin des portes terrestres, pour l’entrée des fils d’Israël en terre sainte, qui précèdent l’invitation faite aux musulmans à entrer dans la religion[27]. Mais aussi, comme portes du paradis : “7.40 Ceux qui traitent Nos signes de mensonges et s’en détournent avec dédain, ceux-là ne verront jamais s’ouvrir devant eux les portes du Ciel, ni n’auront accès au jardin que quand le chameau aura traversé le chas d’une aiguille !“. Également en 57.13, “Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient : “Attendez que nous empruntions de votre lumière“. Il sera dit : “Revenez en arrière, et cherchez de la lumière”. C’est alors qu’on éleva entre eux une muraille ayant une porte dont l’intérieur contient la miséricorde, et dont la face apparente a devant elle la damnation.“
Les montagnes étaient des mirages
Les montagnes sont très présentes dans les contextes apocalyptiques bibliques. Ainsi chez Isaïe « 2.18 Toutes les idoles disparaîtront. 19 On entrera dans les cavernes des rochers Et dans les profondeurs de la poussière, Pour éviter la terreur de l’Eternel et l’éclat de sa majesté, Quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Le thème est directement repris dans l’Apocalypse de Jean « 14 Et le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leurs places ; 15 Et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes; 6.16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’agneau; 17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? ». En parlant de montagnes « déplacées », le Coran évoque une phrase devenue célèbre de l’évangile de Mathieu où l’invocation des montagnes attendue des disciples est au contraire 17.19 : « si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible » [28].
Le Coran met en relief le parallèle entre ces deux invocations des montagnes, ceux qui y cherchent refuge contre Dieu, ceux qui devraient les déplacer par la foi. Le verset dit : « et sont déplacées les montagnes et elles étaient des mirages ». Le texte de la sourate donne alors un sens particulier à l’expression « déplacer des montagnes », voir dans les obstacles une illusion au lieu de s’y abriter. On comprendra un peu plus ces montagnes si l’on regarde ce que le Coran dit du « mirage » dans la sourate An-Nour : « [39] Et ceux qui dénégateurs, leurs œuvres sont semblables à un mirage du désert que l’homme assoiffé prend pour de l’eau ; mais quand il y arrive, il s’aperçoit qu’il n’en est rien. Ce qu’il trouve, c’est Dieu qui lui donne ce à quoi il a droit, car Dieu est prompt dans Ses comptes. [40] Leurs œuvres sont encore semblables à des ténèbres entassées au-dessus d’une mer profonde où des flots tumultueux se chevauchent et s’entrechoquent ; ténèbres si épaisses et si sombres qu’un homme qui y étend la main peut à peine l’apercevoir. C’est ainsi que celui que Dieu n’a pas pourvu de lumière ne la trouvera nulle part. » Ainsi les œuvres mauvaises paraissent insurmontables et s’y réfugient les mécréants. Tandis que la foi doit amener à voir à travers et les dépasser. Ce qui ne se réalisera complètement que par le souffle dans la trompe qui rendra visible leur futilité.
Cet exemple montre à nouveau la densité figurative de cette sourate. Le sens porté par la construction structurée du texte est multiplié par sa capacité à y organiser les références.
Interprétation
Le souffle dans la trompe provoque le changement à l’œuvre dans cette partie. C’est une vérité sonore, active, qui fait disparaitre les illusions et rend visible les conséquences. Cela aboutit sur le jardin, un lieu accompli et sans mensonges. Ce thème de la vérité trouve son point d’appui dans les versets du morceau central : à travers l’écrit de Dieu, les principes de réalité et de responsabilité font pivot et permettent la réussite de la situation finale. D’où la sévérité contre ceux qui les rejettent.
Les actions humaines sont le grand implicite de cette partie, mis en cause par l’expression centrale « rendre compte ». Cette responsabilité rendue inéluctable par le compte divin révèle les conséquences des actions humaines en deux lieux symétriquement opposés. La récompense divine s’inscrit ici encore dans une continuité de l’action humaine. Plus « qu’acceptée », elle semble même choisie. En tout cas juste et logique[29]. La partie centrale pointe le rejet conjoint de la réalité, de la responsabilité et des versets. Alors que le compte, c’est-à-dire la responsabilité[30] refusée dans la partie centrale, devient récompense dans l’abondance du jardin.
La présence ou l’absence d’eau marque la différence entre les deux lieux. Le contexte permet de saisir l’ouverture des portes dans le ciel comme entrée au paradis et le mirage, ces œuvres néfastes « que l’homme assoiffé prend pour de l’eau ; mais quand il y arrive, il s’aperçoit qu’il n’en est rien ». La descente de l’eau semble une allégorie de la parole divine, l’absence d’eau renverrai alors au rejet des versets au centre. Cependant, avant de descendre du ciel, l’écrit est d’abord écriture du réel[31].
Cette partie est très conséquentialiste, sans intervention de la miséricorde. Elle justifie le jugement par l’action humaine et insiste sur la présence des versets comme rappel à la réalité. Le souffle dans la trompe provoque la dissipation des illusions. Desquels le croyant est déjà averti et invité à se tourner vers le ciel, où se trouve l’écriture du réel. Et engagé à orienter ses actions en fonction. Pas de morale ici, mais une dynamique de l’action, comprise par ses conséquences.
La quatrième partie

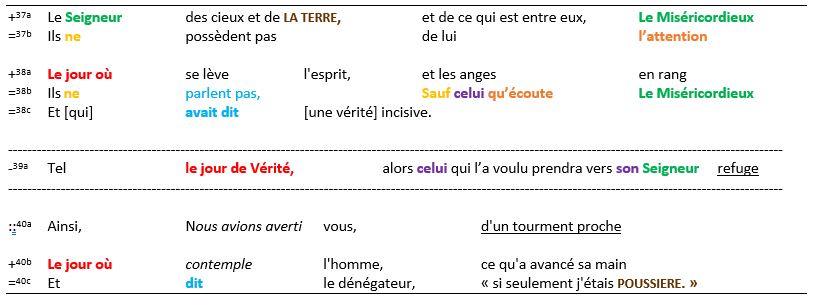
Vocabulaire et contexte coranique
Le terme «صَوَابً۬ا »est utilisé dans le Coran pour décrire les afflictions « qui atteignent » les incroyants, souvent dans le contexte du jugement dernier. C’est aussi la « tempête » qui effraie les infidèles en 2.19. Dans la sourate Les Abeilles, le verset 34 la reprend dans un contexte proche : « 33. Attendent-ils que les Anges leur viennent ? ou que survienne l’ordre de ton Seigneur ? Ainsi agissaient les gens avant eux. Allah ne les a pas lésés ; mais ils faisaient du tort à eux-mêmes. 34. Alors les atteindront (« فَأَصَابَهُمْ ») leurs méfaits, et se réalisera ce dont ils se moquaient. ». Ce parallèle entre « atteindre » et « réaliser » met dans un même mouvement le résultat de leurs propres actions et la réalisation de l’avertissement qu’ils ont reçu. Dans notre texte, au jour dernier, c’est cette parole qui atteint l’homme qui voit (enfin) ses actions. Comment traduire non seulement sa justesse mais aussi son effectivité à rendre l’homme conscient ? Il faudrait un adverbe. A défaut, une parole qui fait mouche, percutante, incisive ?
De la même racine que « oreille », « أَذِنَ لَهُ » fait référence à l’écoute autant qu’à la permission, qui pourrait en être un sens figuratif. En français « écouter » porte aussi deux sens. Ainsi « 84.1. Quand le ciel se déchirera 2. Et écoutera son Seigneur et réalisera (« وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ») ». Le verset 20.109 reprend mot pour mot l’expression du verset 38 : « 20.109 Ce jour-là, ne profite l’intercession qu’à celui qu’écoute le Tout Miséricordieux (« إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ ») et dont il accepte la parole. ». L’attention de Dieu et Sa permission sont liées à ce qu’il accepte la parole. Au contraire en 9.43 : « Qu’Allah te pardonne ! Pourquoi les as-tu écoutés avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs ? » 44. Ceux qui croient en Allah et au Jour dernier n’insistent pas sur toi quand il s’agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. ». La forme X « يَسْتَأْذِنُكَ », « considérer comme entendu » signifie là forcer l’écoute, insister auprès du prophète, ce que ne font pas les croyant. Dieu ne laisse exister une parole que parce qu’elle est juste, ici la parole incisive.
Analyse
Trois morceaux forment la structure concentrique ABA’ de cette partie. Les trois parlent du « Jour de vérité », terme initial du morceau central, il ouvre les deuxièmes segments des morceaux externes A et A’. « La terre » et « poussière » font inclusion et encadrent la partie. Le verbe « dire » termine les deux parties externes (terme final). Si l’on se réfère à la constance de la rime en ‘ân’ qui rythme cette sourate, plusieurs membres présentent sont des phrases longues, avec une césure entre deux propositions parallèles (37a, « l’esprit » puis « les anges », 38a, « ne parlent pas » « sauf celui qu’écoute », 40b parallèle entre « observer » et « faire », l’homme comprend enfin ce qu’il fait).
Dieu est enfin nommé dans le premier morceau. « Seigneur », puis deux fois « Le miséricordieux », terme repris dans chacun des deux segments. Le second segment présente l’apparition fantastique des anges et la montée de l’esprit. La construction du premier morceau est faite autour du parallèle entre deux négations : les hommes ne peuvent s’imposer à Dieu, et ils ne parlent pas. C’est la présence de Dieu qui impose le silence, puis son oreille distingue une voix parmi les autres. Les deux derniers membres (38b et c) sont opposés (« ne parlent pas » , « avait dit ») et parallèle : Dieu écoute, et laisse dire la parole juste. Son autorité s’exprime ici comme sélection de la seule parole qui fasse sens. L’accompli du verbe « dire » nous laisse penser que Dieu écoute celui qui avait dit – dans le monde ici-bas – une parole juste, pertinente[32].
Le dernier morceau est centré sur l’homme. Il y a une proximité dans la forme et la sonorité de « nous vous avons averti » « أَنذَرۡنۡ » et « l’homme contemple » « يَنظُرُ », qui relie les deux segments : la sourate se conclut comme elle a commencé sur ce parallèle entre l’annonce et sa réalisation, qui se concrétise finalement. Le tourment du premier segment se trouve dans le double constat de l’homme : il contemple son résultat et souhaite ne pas avoir été.
Le premier morceau parle de l’humanité de façon indifférenciée à la troisième personne (« ils »), le dernier la questionne directement (« vous »). Les deux distinguent une personne dans leur second segment : celui qui est agréé dans le premier morceau et le dénégateur dans le dernier. Ces deux orateurs expriment chacun une vérité sur l’homme, qui fondent la proposition centrale.
Le morceau central joue le rôle de pivot en plaçant aujourd’hui l’enjeu de ce jour futur. Le terme « celui » fait le lien entre « celui qui l’a voulu » et « celui … qui avait dit » du le premier morceau. Le passé des deux verbes renvoie à la situation présente, le lecteur est invité à écouter aujourd’hui la parole percutante, qui sera entendue par Dieu au jour dernier. Et qui est également invitation à prendre « refuge » contre « le tourment » du dernier morceau. Cette double référence du morceau central au morceaux qui l’entourent met en opposition celui qui parlait aujourd’hui – qu’a-t-il dit ? – et celui qui regarde sa main – qu’a-t-il fait ? – [33]. Ces deux questions ont surement la même réponse : la parole incisive, dite par le prophète, avait déjà pour but de révéler à l’homme son action. La « vérité » de ce jour-là est une invitation à la comprendre aujourd’hui.
Contextes
La poussière
Dans la Bible comme dans le Coran, l’homme est créé à partir de poussière, ou d’argile. Dans le second chapitre de la Genèse, à partir de poussière : « 7 Et l’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines une respiration de vie ; et l’homme devint une âme vivante. ». C’est également une malédiction, d’abord pour le serpent : « 14 Alors l’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs ; tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. 15 Et je ferais de vous des ennemis entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t’écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon. » Aussi pour l’homme : « 19 Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras vers la poussière. »
On retrouve cette origine dans le Coran : « 3.59 Ainsi l’exemple de Jésus pour Dieu comme celui d’Adam qu’il créa de poussière. ». Le Coran la reprend comme image, non pas de malédiction mais de l’ostentation, dans sa reprise de la maison construite sur le sable[34] : « 2.264. Ô les croyants ! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au Jour dernier. Son exemple un rocher recouvert de poussière ; qu’une averse l’atteigne, elle le laisse dénué. » Quand s’y ajoute l’eau, la poussière donne la vie, comme la terre desséchée qui reçoit l’ondée : « 22.5. Ô hommes ! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, C’est Nous qui vous avons créés de poussière, puis d’une goutte de sperme, puis … De même tu vois la terre desséchée : dès que Nous y faisons descendre de l’eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. » Ce parallèle entre la résurrection de l’homme et une plante qui sort d’une terre morte[35], explique aussi la présence des plantes en début de sourate et le regret de l’homme à la fin.
La parole percutante
Nous étudierons plus loin le réseau de relations tissé par la sourate Al Naba. Cette voix fait partie des références forte aux autres textes apocalyptique. En particulier dans l’Apocalypse de Jean : « comme la voix de grands tonnerres », « une épée qui sort de sa bouche ». Une voix forte, de destruction et de vérité, noter « l’esprit de prophétie » qui la précède.
Le Coran propose un jeu de références semblables à celles du contexte biblique, en particulier la tempête de 2.19. La parole ce jour-là est « percutante », le terme fait dans le Coran le lien entre le jour dernier et la destruction des citées du passé, pour leurs méfaits. Moins imagée que dans le texte biblique, « صَوَابً۬ا » est surtout définie par sa précision à décrire la réalité et à atteindre son auditeur.
Le refuge
Cette partie fonctionne en miroir inversé avec le Psaume 31. Ce psaume développe comme beaucoup d’autres la prière du juste persécuté, qui cherche en Dieu un refuge. Qui espère sa délivrance en Dieu. Ici il Lui demande de lui « prêter l’oreille » :
3 Incline ton oreille (אָזְנְךָ֮) vers moi ; hâte-toi de me délivrer ; sois mon rocher, mon refuge, ma forteresse où je puisse me sauver ! 4 Car tu es mon rocher et ma forteresse ; pour l’amour de Ton Nom, Tu me guideras et me conduiras. 5 Tu me tireras du piège qu’on m’a tendu ; car tu es mon refuge. 6 Je remets mon esprit entre tes mains ; tu m’as racheté, ô Éternel, Dieu de vérité ! 7 Je hais ceux qui s’adonnent aux vanités trompeuses ; pour moi, je me confie en l’Éternel. 10 Éternel, aie pitié de moi, car je suis dans la détresse ! (…) 18 Éternel, que je ne sois point confus, car je t’ai invoqué ; que les méchants soient confus, qu’ils aient la bouche fermée dans le Sépulcre ! 19 Qu’elles soient muettes, les lèvres menteuses qui profèrent contre le juste des paroles impudentes, avec orgueil et mépris !”
La sourate Al Naba formule la réalisation de cette attente au jour de vérité. La lecture du psaume permet de mieux cerner qui parle et qui se tait ce jour-là. La souffrance exprimée ici et l’oppression que subit le juste expliquent le tourment pour ses oppresseurs. Lui aussi hait – et pour cause – le mensonge et les vaines paroles[36]. La parole des persécuteurs n’a plus cours ce jour-là, le mythe structurant leur mensonge aujourd’hui ne tient plus devant un Dieu de vérité.
Il faut bien convoquer ici René Girard[37] : pour lui le monothéisme fonde la parole de la victime, et le Coran selon lui n’appartient pas aux religions sacrificielles. Nous en fournissons ici un exemple. Ainsi puisque le mythe n’est plus, l’accusation d’autrui n’est plus, et les dénégateurs sont renvoyés à leur propre comportement, et plus à celui d’autrui. Pour R. Girard, la résurrection de Jésus fonde le renversement du mythe. Dans le Coran, c’est la résurrection des morts qui est « jour de vérité ».
L’Ensemble de la sourate
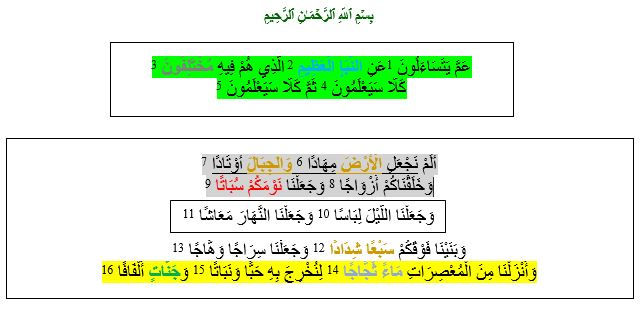
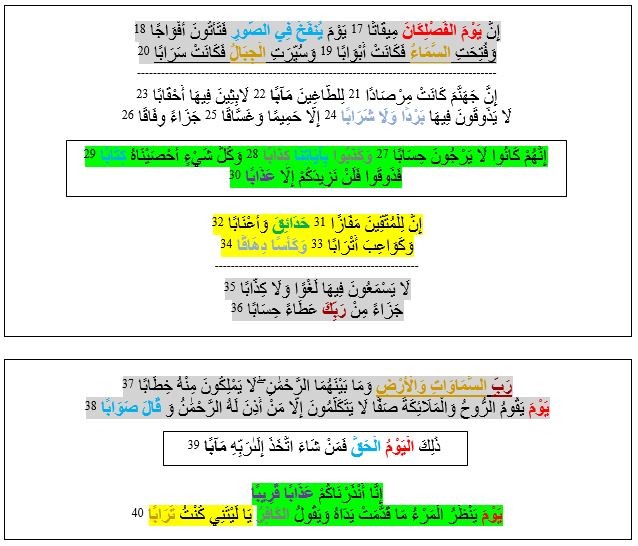
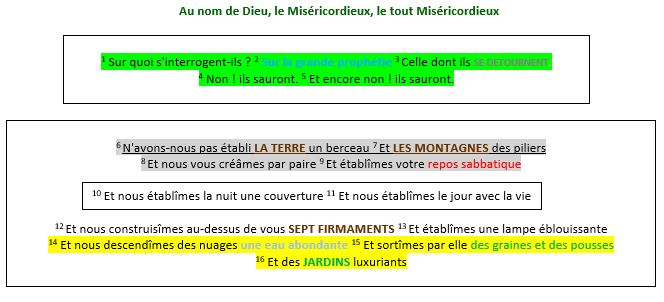
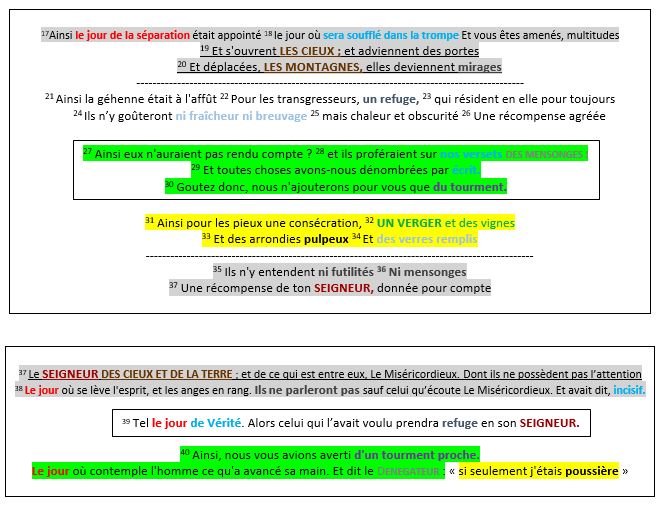
L’incipit de la sourate Al Naba rappel les serments qui ouvrent les autres sourates. Ici cependant le propos n’est pas figuratif mais explicite. Le verset 2, qui a donné son nom à la sourate, annonce le contenant et son contenu : l’annonce du jugement comme rapport à la vérité. Cette introduction forme le premier passage.
Le corps de la sourate forme un second passage de trois parties. La première partie montre la création matérielle de la terre, qui devient un jardin pour l’humanité. En face, la dernière partie parle des éléments spirituels du « jour de vérité », où l’on retrouve Dieu, l’esprit, les anges, les voix de la conscience humaine. Au centre un monde anticipé, qui oppose deux avenirs possibles dans la disparition du premier. Le morceau central interpelle l’humanité. Deux termes crochets font le passage d’une partie à l’autre. La multitude indéfinie des plantes (« abondante », « luxuriant ») devient dans la seconde partie la « multitude » indéfinie de l’humanité rassemblée, et sert de termes médians entre les deux premières parties. De même la mention du « Seigneur » fait le lien entre la seconde et la troisième partie.
Ces trois parties sont ouvertes par trois morceaux semblables, surlignés en gris, qui évoquent l’action de Dieu pour l’humanité. Chacun fait référence à deux termes parmi : les cieux, la terre ou les montagnes. Et à un jour particulier. Le shabbat pour la création, le jour de la séparation pour la révélation des mirages et la disparition des futilités, et le jour de vérité pour la mise en valeur d’une parole humaine. Ces trois morceaux évoquent un Dieu souverain de sa création[38], capable de la faire disparaitre ou de la transformer. Il faut rajouter à ces trois ouvertures le dernier morceau de la partie centrale (35-37), qui prépare l’ouverture de la dernière partie, le terme « Seigneur » faisant la liaison entre les deux (terme crochet), la disparition du mensonge préparant « ils ne parleront pas ». La forte ressemblance de ces trois morceaux, leur régularité en début de partie, son aspect progressif et sa cohérence comme structure thématique nous pousse à voir plus que des symétries de termes. Nous pensons qu’il faut ici évoquer quatre morceaux parallèles entre eux et placés à des endroits clés du passage[39].
A ces trois ouvertures répondent trois conclusions. Le segment 14-16 et le morceau 31-34 terminent les deux premières parties par la transformation de la terre en jardin, avec des plantes et de l’eau. La terre et les montagnes deviennent d’abord le jardin d’Eden fait pour l’humanité, puis le paradis pour les pieux, finalités des deux créations. A l’opposé la dernière partie sonne comme un échec terrible : la « poussière » est l’opposée du jardin, une terre morte, desséchée et émiettée. Cette opposition se retrouve dans l’opposition des deux termes quasi identiques « أَتْرَابًا » et « تُرَابًا », « pulpeux » et « poussière ». Deux devenirs possibles de la poussière à partir de laquelle Dieu créa l’homme. Avec ou sans eau.
La sourate dans son ensemble est articulée autour de trois morceaux. L’incipit (1-5), le morceau central (27-30) et le dernier (40). Les trois interrogent le rapport de l’homme à la vérité : ceux qui s’en « détournent », ceux qui « mentent » et ceux qui la « recouvrent ». Dans les deux premiers la vérité est figurée par la « prophétie », puis par les « versets ». L’écriture fait place au « tourment » et finalement l’homme, face à lui-même « contemple ce qu’a avancé sa main ». L’opposition de départ entre « ils se détournent » et « ils sauront » se termine tragiquement dans celle entre « nous vous avions averti » et « il contemple ». Le morceau central est la charnière entre les deux quand il lie « Ils n’auraient pas rendu compte ? » avec « ils proféraient sur nos versets des mensonges. ». L’écrit y figure la réalité objective et les conséquences de l’action humaine. L’Auteur décrit ici précisément le rôle qu’Il donne à Son livre. C’est une sagesse qui montre à l’homme sa place dans le monde, et le rôle de son action dans la transformation du monde. C’est pour ne pas voir son action que l’homme rejette cette sagesse, mais cela le mène irrémédiablement au tourment, qui lui révèle, avec les conséquences, donc trop tard, ce qu’il a fait[40].
La réalisation de la prophétie est amenée par deux voix, celle de la « trompe », qui fait disparaitre les illusions et celle qui « tonne », « le jour où se lève l’esprit ». L’annonce « Non ! ils sauront » de l’introduction, n’annonce pas seulement l’avènement du jour promis, mais surtout la conclusion finale, « le jour où contemple l’homme ce qu’a avancé sa main ». Dont l’énonciation rend intelligible dès aujourd’hui au lecteur l’aspect réel, objectif, des actions humaines et de leurs conséquences. L’annonce du jour dernier, les versets, la trompe, la voix incisive, provoquent la disparition des illusions de l’être humain sur lui-même et sa réalisation finale de ses possibilités gâchées. Le terme prophétie porte ce double sens, révélation d’un futur qui est critique du jour présent. Cette révélation des actions humaines est figurée par la descente de l’eau, dont la présence ou non détermine les devenirs de l’homme, sa capacité à vivre et pousser.
Interprétation
La structure permet au texte d’articuler deux dynamiques. Au niveau de chaque partie, l’évolution historique du monde, qui évolue de la terre vers un devenir soit jardin, soit désert ou poussière. Au niveau de la sourate entière, l’interdépendance entre la réception du texte, l’activité humaine réelle et les choix spirituels, tels que mis en valeur dans les dynamiques des différentes parties.
La dynamique de la première partie présente la transformation de la terre à un jardin. Au centre de cette dynamique l’alternance du jour et de la nuit, générée par la course des astres, participe à structurer l’activité humaine[41]. Cette partie sert de modèle qui fonctionne : Dieu établi la nature de sorte qu’elle produise un jardin où l’homme peut vivre.
La dynamique de la seconde partie aboutit en désert ou en jardin, avec pour centre l’action humaine révélée par « les versets ». Le cadre naturel de la première partie est désormais conséquence de l’action humaine, qui est invitée à considérer le réel dans lequel elle s’inscrit plutôt que de se perdre en se prenant elle-même comme référence, comme le figure le mirage et l’effacement des montagnes. Les portes du ciel ouvertes, sont à la fois les nuages d’où descende l’eau et l’écrit qui permet à l’humanité de comprendre et changer son activité. En fonction de ce choix, Dieu sépare entre les hommes et leurs avenirs.
La dynamique de la troisième partie est spirituelle, devant Dieu, l’Esprit et les anges. Elle met en opposition, si l’on suit le parallèle avec les psaumes, la parole du juste persécuté (en particulier la parole prophétique dans le récit coranique[42]) et la violence de ses adversaires. Cette dynamique est articulée par le choix central de se tourner vers Dieu.
Prises ensembles, elles articulent un grand récit, dans lequel l’action humaine s’inscrit dans le prolongement de la nature, qui transforme le jardin en désert ou en verger. Le moteur de cette action humaine se trouve dans les relations entre les hommes, en particulier la réception de la parole prophétique et des versets de Dieu, qui ouvrent les yeux de l’homme sur lui-même et les causalités de son agir. Prendre refuge en Dieu, c’est prendre cette responsabilité, en cherchant protection contre les retours violents.
Ces trois dynamiques préparent la dynamique d’ensemble. Celle-ci part de l’opposition initiale entre « Sur quoi s’interrogent-ils » et « ils sauront » qui trouve sa résolution finale dans celle entre « Nous vous avions averti d’un tourment proche » et « Le jour où contemple l’homme ce qu’a avancé sa main. ». Comme pour les trois dynamiques, le pivot est le morceau central 27-30 : si l’homme refuse cette compréhension, c’est dans le vain espoir de ne pas rendre compte de ses actions. La « grande prophétie » a pour objet ce jour particulier où l’homme devient clairvoyant sur lui-même, le « jour de vérité ». La catastrophe annoncée est de se « rendre compte ».
Le « miracle » du Coran tient pour nous dans cette structure et la façon dont elle permet d’articuler les idées. Au lieu d’une catégorisation trop rigide qui aurait figé les rapports et tenter de préciser chaque sens, le texte présente une articulation, par nature plus flexible, des dynamiques historiques qui mobilisent l’homme. Ces rapports entre l’homme et son monde résistent assez bien à l’épreuve du temps. Ainsi des rapports entre les astres et leurs conséquences sur terre, qui donnent le jardin : le lien, déjà fait pendant l’antiquité, en particulier pour les saisons, subi un profond travail de démystification. Cette vision historique présente même une étonnante modernité en plaçant l’action humaine au centre du devenir du monde. Puis en suggérant que le moteur de la pratique humaine se trouve dans les relations sociales. Et que c’est cette pratique, qui influe sur l’idéologie et la possibilité individuelle d’approcher la vérité. Ce récit développe donc sa propre philosophie, et l’on y redécouvre avec plaisir cet aspect du monothéisme, qui en démystifiant les dynamiques naturelles inscrit l’homme dans l’histoire et se rapproche d’un étrange « matérialisme spirituel » dont Dieu est le pivot, si l’on me pardonne cet oxymore.
En face de Dieu, il n’est plus question du monde, mais seulement de l’homme. C’est le temps et plus le lieu qui nous situe au « jour de vérité ». L’évolution du monde physique vers le monde vivant, s’accompagne d’une rencontre spirituelle de l’homme vers son Seigneur, nécessitant que l’homme se connaisse lui-même. Rappel qu’il est aussi animé par le souffle[43] (« رُوحِ », « esprit »), la vie que le Seigneur lui avait insufflé, et qu’il avait négligé. La possibilité d’une éthique positive, proposée dans les versets rejetés, devient au jour dernier la négativité qui balaie les constructions mensongères, et fait de ce jour un « jour de vérité ». La voie de tempête, tonitruante et incisive, est déjà préparée par la trompe qui ébranle le monde.
La réalité objective, « berceau » de l’action humaine dans la première partie, est aussi description allégorique de l’action divine : la « lampe éblouissante », figure la lumière divine et la parole prophétique, tandis que la descente de l’eau qui donne la vie figure la descente des versets qui donne l’intelligence. Il paraît légitime d’affirmer que la croissance des plantes figure celle de l’homme et de l’esprit. Si la dimension spirituelle de la dernière partie représente des réalités humaines, la réalité décrite dans la première partie figure des aspects spirituels. Cette représentation dialectique du monde et de sa représentation, est présentée deux fois : la nécessité d’un rapport objectif au réel pour que l’homme se comprenne et celle de l’effort spirituel pour approcher l’objectivité. Dieu provoque les deux.
En se plaçant au jour dernier, l’homme contemple sa propre action dans ce jardin. « Connaitre la fin, combattre les débuts », est possible pour l’homme qui regarde au loin, tandis que l’homme pressé est aveuglé par ce qu’il fait. Atteindre cette vision extérieure, globale, impose un regard critique sur ses actions. La prophétie met en miroir la vie sur terre rendue possible par l’eau, et l’intelligence rendue possible par la révélation. Cet aspect spirituel permet à l’homme d’envisager les fins possibles et de choisir son action. Elle le rend responsable devant Dieu.
Le contexte Apocalyptique de la sourate Al naba.
La voix
Dans l’Évangile de Jean, une voix est liée par deux fois à la résurrection des morts : celle de Lazare en 11.43, et celle de l’heure dernière en 5.25. Un passage étonnant associe la voix et la porte 10.1-16, tout en évoquant les plantes du pâturage (10.9) et le rassemblement des hommes (10.16). Nous souhaitons renvoyer ici à l’étude de Javier Lopez dans les quatrièmes rencontres de la rhétorique biblique[44]. Il relève que le verset 1:10 de l’Apocalypse de Jean (« j’entendis derrière moi une grande voix, comme celle d’une trompette ») associe le son de la trompette avec la “grande voix”, associant ainsi deux voix de l’ancien testament, “qol shofar” et “qol IHWH”. La première, voix de la trompette, annonce la venue de Dieu. Ainsi au Sinaï, la présence divine détruit presque la montagne. Ses deux apparitions, en Exode 19:16 et 20:18, encadrent les commandements donnés à Moïse. La seconde, la voix du Seigneur, est celle qui fait le prophète, comme en Ezéchiel 3:12 et Apocalypse 1:10. Elle est omniprésente dans l’Apocalypse, et revient accompagnée d’autres de nos thèmes tout au long des chapitres 4 à 7.
Ainsi la parole « ṣawâbân », en parallèle avec le son de la trompette reprend un thème majeur de la littérature apocalyptique. On peut la lier avec la disparition de la montagne, qui pourrait discrètement annoncer la venue de Dieu dans la partie suivante. Dans le Coran l’expression « وَ قَالَ صَوَابًا » est énigmatique, on ne sait pas qui parle, et l’idée de voix ou d’une parole n’est qu’implicite, dans le lien entre le verbe et son adverbe. Et elle est dépourvue de toute dimension fantastique. En parallèle avec la trompe qui fait disparaitre le mensonge, elle n’est définie que par sa seule particularité, qui est de rendre compréhensible la vérité à celui qui l’écoute.
As-Sabt et le jour de vérité
Le jour dernier est le thème structurant, la grande prophétie mentionnée dans l’incipit. Dans la partie centrale en tant que “jour de séparation” qui distingue ce qui est véritable du futile. Dans la dernière partie, « jour de vérité ». On le retrouve implicitement dans le jour de repos, le septième jour de la création, dont la mention discrète ne peut pas être anodine. En effet, le verset 16.124, avec un vocabulaire similaire, fait déjà le parallèle entre « as-sabt » et le « jour de la résurrection ». Le verset 4.154 entre « la porte » et « le jour du sabbat ». Ces parallèles rappellent la perspective millénariste qui fait du 7e jour la réalisation du règne de Dieu sur terre[45]. Cette perspective prend naissance dans les textes apocalyptiques juifs et chrétiens, Enoch ou IV Esdras. Elle est développée ensuite par des auteurs chrétiens tels Iréné, Hyppolyte puis Lactance. On la retrouvera dans des courants judéo-chrétiens, nazaréen. « As-sabt », jour crucial des révélations bibliques et de la perspective apocalyptique, reste mentionné 4 fois dans le Coran, qui n’hésite pas à intégrer les représentations de ces courants. Il en renouvelle le sens[46], chez lui c’est le jour dernier qui s’impose à travers ses variations[47]. La sourate Al Naba efface légèrement « as-sabt »[48], commémoration de la création, pour placer l’importance sur le « jour de vérité » qui devient l’horizon de la révélation coranique. Le point transcendant d’où Dieu porte la critique de l’humanité. Est-ce que toute réalisation terrestre est abandonnée au profit de ce jour dernier ? Nous lisons plutôt que le Coran prend appuie sur ce jour-là pour révéler la réalité du monde : la sagesse montre que toute action est conséquente sur l’avenir, qu’une éthique est indispensable pour guider l’action et prendre en charge la continuité entre le jardin d’Eden et le jardin des pieux[49].
Mathieu 24
La séquence dont fait partie 24:20-33[50] commence par une question sur la date et le signe de la venue de Jésus et de la fin du monde. Le passage 24:20-33 au centre de la séquence répond à la question. Il n’est pas question donc du jour du jugement, mais des évènements qui le précède. Cette différence permet de saisir le rapport entre les deux textes, la sourate Al-Naba propose des thèmes ou des figures similaires, mais positionnées en miroir par rapport au jour dernier, transformée par celui-ci. (le syriaque est donné en caractères arabe pour faciliter la lecture et les comparaisons avec le vocabulaire coranique).
[24.3 Il s’assit sur la montagne des oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question : Dis-nous, quand cela adviendra, et quel sera le signe de ton arrivée et de l’accomplissement du monde (شولمه دعلما) ?
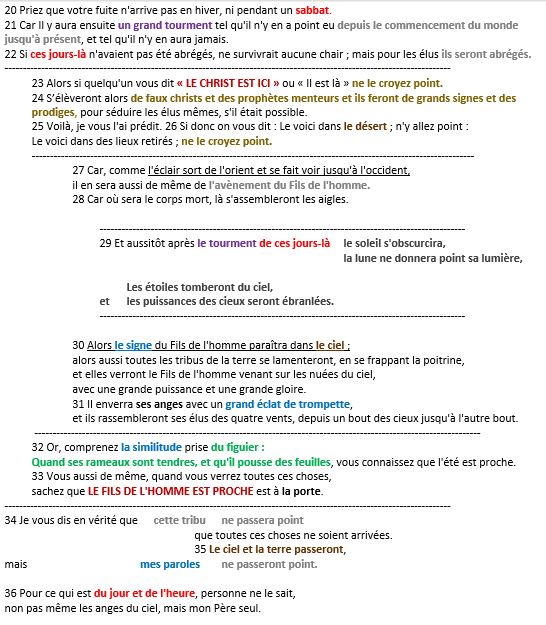
Le premier morceau situe le passage dans l’histoire du monde, depuis la création jusqu’à sa fin. Dieu intervient pour abréger sa dynamique de destruction et préserver la vie, et les élus du tourment (ou oppression[51]) qu’ils subissent. Le dernier morceau (34-36) tempère cette intervention en précisant que ce temps reste retenu, connu de Dieu seul, afin que personne ne se repose sur ce moment et que tous persévèrent (SBR, من دنسيبر, 24:13) [52]. En effet « ne passeront point » ni l’homme, ni les paroles qu’il a reçues. Se conjuguent alors l’espoir et la persévérance dans la détresse des temps difficiles. La sourate Al-Naba décrit un autre tourment celui au jour dernier du dénégateur qui avait lui refusé cette responsabilité (rendre compte) et se rend compte trop tard de ses actes.
Le second morceau s’oppose aux mensonges, les signes des prophètes menteurs et faux messies (مشيخا دجلا ونبيا دكدبوتا)[53]. Alors que le dernier morceau imposait de ne pas abandonner, celui-ci averti des faux espoirs, de ne pas chercher le Christ dans le « désert », où par définition il n’y a rien. Dans le morceau symétrique (32-33), à l’opposé du désert, l’on trouve cette parabole si fréquente de la plante vivante, qui pousse et se déploie. Figurant un temps en évolution, qui prépare l’été. C’est la reconnaissance de cette dynamique historique, et non d’un Messie, qui annonce « le fils de l’homme », dans le ciel et à la « porte ». Le texte coranique présente la même opposition entre d’un côté les mensonges et le désert et de l’autre la porte dans le ciel. Ainsi que cette figure des plantes qui marque la même évolution dynamique, vers le jardin d’Eden et du paradis, figuré chez Mathieu par « l’été ».
Ainsi cet espoir, « l’avènement du Fils de l’homme » n’est pas à chercher ici ou là sur terre, mais s’imposera « dans le ciel » en temps voulu. Son caractère immédiatement reconnaissable s’oppose en pratique à toute identification à tel ou tel prétendant. L’image des aigles se regroupant sur le cadavre interroge. Elle ne s’explique bien que par la description de René Girard sur les mécanismes de bouc émissaire, les prêtres construisant leur religion sur le tombeau des victimes. Ici les empires (« aigles, نشرا ») semblent tirer leurs idéologies du cadavre, celui de la victime émissaire. La venue du « fils de l’homme » détruit leurs prétentions symboliques, et ces empires redeviennent des tribus, simples groupes humains, terrifiés face à la réalité crue de leurs actes. La trompette joue le même rôle de pivot que dans la sourate Al-Naba, elle marque la destruction des prétentions et rétablit la séparation entre les tribus et les élus de toute la terre. On retrouvera cette opposition dans la dernière partie de la sourate, entre la parole du juste enfin entendue et le dénégateur qui fait face à ses actes.
L’obscurcissement des astres, et la chute des étoiles, occupe la place centrale du passage. Il ne s’agit pas ici de leur mouvement, mais de l’appui que prend Jésus dans les textes des prophètes apocalyptiques, dont il fait le tournant de sa réponse. Chez Daniel l’obscurcissement figure, comme la première partie du texte de Mathieu, la persécution des élus, par le roi grec Antiochus Epiphane : « 8:10 Et elle grandit jusqu’à l’armée des cieux, et elle fit tomber à terre une partie de l’armée des étoiles, et les foula aux pieds … 24 il détruira les puissants et le peuple des saints. ». Chez Esaïe, l’obscurcissement des astres figure au contraire la chute de Babylone : « 5 D’un pays éloigné, de l’extrémité des cieux, l’Éternel vient avec les instruments de son courroux, pour dévaster tout le pays. 9 Voici, le jour de l’Éternel arrive, jour cruel, jour de fureur et d’ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. 10 Car les étoiles du ciel et leurs astres ne feront pas briller leur lumière; le soleil s’obscurcira dès son lever, et la lune ne fera point luire sa clarté.11 Et je punirai la terre de sa malice, et les méchants de leur iniquité ». On comprend ce que veut dire ici le pêché : « je mettrai fin à l’orgueil des superbes, et j’abattrai l’insolence des oppresseurs ». C’est aussi la fin du diable et de son orgueil, lui « qui changeait le monde en désert » : « 12 Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant (Lucifer), fils de l’aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? 13 Tu disais en ton cœur: Je monterai aux cieux, j’élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu ». Chez Ezéchiel « 32.7 « Quand je t’éteindrai, je couvrirai les cieux, et j’obscurcirai leurs étoiles » annonce qu’un pareil sort attend pharaon et effraye les rois de la terre. Enfin cette figure de la fin des empires permet chez Jérémie le rassemblement du « reste » que se garde le Seigneur (Jérémie 50.20, comme en Mathieu 24.31). On comprend pourquoi alors pourquoi ce thème prophétique est cité par Jésus au centre de sa propre prophétie. Comme dans la sourate Al-Naba, la prophétie est l’annonce de ce moment terrible qui fait la transition entre une apparente victoire du mal dans la première partie (persécution des élus et rassemblement des rois sur leurs cadavres) et le changement attendu (terreur des nations, silence des persécuteurs et rassemblement des élus). On ne peut pas dire que ces réflexions soient absentes du Coran : exemple des cités disparues, difficultés rencontrées par les prophètes, promesse de la survie des prophètes et d’un rétablissement final. Dans les deux textes, c’est l’intervention du Seigneur qui rétablit la justice et ramène les hommes à leur humanité commune. Sa présence fait disparaitre le mensonge de la puissance sacrificielle, le meurtre qui établit des rapports hiérarchiques et des rois sur les nations.
[1] Roland Meynet, Traité de rhétorique biblique, coll. « Rhétorique sémitique 4 », Lethielleux, Paris, 2007
[2] Michel Cuypers, Le Festin. Une lecture de la sourate al-Mā’ida. Paris, Lethielleux, Rhétorique sémitique, 2007
[3] La forme VI, ‘faire ensemble ‘, du verbe « interroger » donne une notion collective, qui entre la prophétie dans le cadre du schéme prophétique du Coran ou un prophète fait face à son peuple et l’interroge.
[4] Voir “Arabic-English Dictionnary of Qur’anic usage”, Emran el-Badawy, en particulier pour C 6.67. Outre informer, le mot prend souvent le sens de divulguer, révéler, par exemple en 66.3 ou 11.49, sens possible également en 53.36. Pour C. Pennachio, c’est un mot originaire de l’hébreu biblique, prophète qui pourrait être venu à l’arabe par le biais des juifs du hijjaz. En akkadien « nabbu » proclamer. Cf. ‘’Les emprunts à l’hébreu et au judéo-araméen dans le Coran’’, Jean Maisonneuve, Paris, 2014. Le sens étant le même dans les différentes traditions religieuses du proche orient, on pourrait parler d’un terme sémitique générique, commun aux différentes langues.
[5] « 7 Et Dieu fit l’étendue (רְקִ֣יעַ), et sépara les eaux qui sont au-dessous de l’étendue, d’avec les eaux qui sont au-dessus de l’étendue ; et cela fut ainsi. 8 Et Dieu nomma l’étendue(רְקִ֣יעַ), cieux (שָּׁמַ֔יִם). » « 14 Puis Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des cieux (רְקִ֣יעַ הַשָּׁמַ֔יִם), pour séparer le jour d’avec la nuit, et qu’ils servent de signes, et pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. »
[6] Strong 4733,4731
[7] Firmament, Oxford English Dictionnary, cité par Wiktionary.org.
[8] Pour cela, et le questionnement sur les astres comme barrage au jinns, voir les réflexions proposés par Tommaso Tesei, Patricia Crone dans les discussions sur le passage 37:6–11 du Coran in The Qur’an Seminar Commentary, De Gryuter, 2016. Le point de Michael E. Pregill présente également un intérêt certain.
[9] ‘’Les emprunts à l’hébreu et au judéo-araméen dans le Coran’’, Paris, 2014. Pour « janna », p. 166, pour « sabt », p. 155. Une telle continuité entre les textes et les langues, incluant également le syriaque, nous amènerait plutôt à parler de termes sémitiques communs que d’emprunts. Voir de termes monothéistes.
[10] Exode 20:7-10. Qui marque également l’unicité divine par l’affirmation de YHWH comme Dieu sur la terre. Si le Coran reprend l’idée du 7e jour de la création, par exemple en 7.54 ‘’Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S’est établi «’istawā» sur le Trône’’, c’est en précisant que l’idée de repos, donnée dans le texte de l’Exode, ne peut s’appliquer qu’à l’homme, pas à Allah (C 30.19, 46.33).
[11] ‘’Les emprunts à l’hébreu …”, op. cit.
[12] Emran Al-BADAWI, “The Qur’an and the Aramaic Gospel Traditions”, Abingdon, ‘Routledge Studies in the Qur’an’, 2013
[13] Idée qui apparait la première fois pour le désastre du déluge, ce sont des fenêtres dans le ciel d’où s’écoulent l’eau qui remplit la terre. Et se retrouvent dans le texte de l’apocalypse de Jean, en particulier celles de la Jérusalem céleste par lesquelles entrent les justes : Ap.21.12 “Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges.“
[14] « فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي »
[15] « إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ »
[16] Faṣṣl en forme II, avec le sad redoublé signifie “explication”. Regardons 6.97 dans un contexte similaire : “Ainsi Nous détaillons Nos signes pour un peuple qui sait.” De même 10.5. 32.25 vu plus haut propose un emploi similaire de la forme I.
[17] Le verbe يُعَذِّبُ est souvent opposé à pardonner (à يَغْفِرُ en 2.284, et يَتُوبُ en 9.106), par-là prend surtout le sens de damner, condamner. Pour le nom de la même racine, en 57.13 « damnation » s’impose comme opposé de miséricorde. Parfois le verbe est l’opposé de « récompenser » (33.24), « punir ». Ici « Tourment » rend alors mieux ce lien entre les deux sens.
[18] Certains traduisent par verger. Le terme « حَدَآٮِٕقَ » dans le Coran est en effet toujours accompagné d’arbres fruitiers.
[19] Il nous parait plus adéquat de traduire par « pulpeux » ce qualificatif des houris que par « de même age », extrapolé d’un sens abstrait (« nivelé ») de TRB, la terre, poussière. C. Luxemberg, qui remet en question, entre autres, les houris du paradis, cherche à lire ici « des fruits pulpeux », ou « des coupes de jus pulpeux », sans donner toutefois de données décisives. Si les sens de fruits et des nectars sont bien présents, ils sont surtout porter par les « verres » et ne remplacent pas la référence aux houris portée par « pulpeux », même si la traduction de ce dernier terme semble judicieuse. Cf. “The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the Koran”, Prometheus, 2009. Une interprétation similaire du verset 34 est rebutée par C. Pennacchio, “Les emprunts lexicaux dans le Coran, Les problèmes de la liste d’Arthur Jeffery”. Pour une réfutation de la thèse générale de C. Luxemberg, voir “From Alphonse Mingana To Christoph Luxenberg: Arabic Script & The AllegedSyriacOrigins Of The Qur’an”, M.Saifullah, M. Ghoniem& S. Zaman, en ligne, IslamicAwareness, 3rd May 2007
[20] Voir les réflexions sur « taqwa », dans Trois découpages possibles, réponse à Rachid Benzine.
[21] Ces quelques citations sont basées sur la traduction de M. Hamidullah. L’ensemble de ces références sera étudié pour en expliciter les différents termes dans l’article Houris, à paraitre dans la section vocabulaire du site collectif-attariq.net
[22] On pensera pour comprendre « inaltérable » au parallèle du verset 20.120 entre « l’arbre de l’éternité et un royaume impérissable (شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ) ». Parmi les synonymes d’inaltérable : constant, durable, éternel, immuable, impérissable, incorruptible, indéfectible.
[23] « yeux (عِينٌ) » qualifie les houris en 52.20, 56.22 (qui reprend caché (مَكْنُونٌ)), remplacé par pulpeux (أَتْرَابٌ) en 38.52.
[24] Lire 2.267,272 et 36.47
[25] R. Meynet, À propos de la «loi du croisement au centre», disponible sur le site de la RBS : http://www.retoricabiblicaesemitica.org/Pubblicazioni/StRBS/39f.Sur_les_lois_de_la_rhetorique_biblique_CroisementCentre.pdf
[26] La première référence à des portes dans le ciel vient de l’histoire du déluge, elle-même un précurseur des textes apocalyptiques. On trouve dans le texte de la Genèse : « 7.11 En l’an six cent de la vie de Noé (…), en ce jour-là, jaillirent toutes les sources du grand abîme, et les fenêtres des cieux furent ouvertes. 12 Et la pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. »
[27] (M. Cuypers, Le Festin).
[28] Chez Marc également : « 11.23 Quiconque dira à cette montagne : Ote-toi de là et te jette dans la mer, .. ce qu’il dit lui sera accordé. » . Le texte pointe le pardon des offenses « 25.. Si vous avez quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26 Que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. »
[29] La notion de miséricorde est étrangement absente de cette sourate. Uniquement comme opposé implicite de « tourment ». Et peut-être discrètement dans l’eau qui descend des nuages, cf. 25.48 ?
[30] Dépassant les apparences morales d’un conflit abstinence/jouissance qui n’est pas ou peu présent dans le Coran. La finalité est ici le bien-être de tous. Le texte postule le mensonge de l’attitude irresponsable, qui ne permet pas la jouissance de la provision divine, mais la rend impossible.
[31] Comme « le registre manifeste » de la sourate YaSin (v. 12). Lire à ce propos l’analyse du premier passage de la sourate YaSin, https://collectif-attariq.net/wp/yasin-premier-passage/
[32] Tout comme le verset central évoque une personne qui a pris aujourd’hui refuge en Dieu. D. Masson et R. Blachère traduise ainsi le verset 39, ce qui pour nous s’applique aussi en 38c.
[33] Y-a-t-il meurtre ici ? Ou bien violence contre la parole prophétique ? René Girard verrait-il là une violence cachée ? On pense à Abraham face à son peuple. Ou Jésus. On pense alors aux prophètes ajournés des versets 11-12 de la sourate précédente. Est-ce leur parole qui est entendue ce jour-là ? Les chrétiens verraient facilement Jésus dans cette voix de tempête. Mais il n’est pas nommé dans toute l’apocalyptique coranique, ce qui pose question : le Coran étend il son rôle apocalyptique à toute parole prophétique ? Ou pas ? Voir la discussion plus loin à propos du contexte de la sourate.
[34] Evangile de Matthieu, 7, versets 24 à 27.
[35] « 35.9. Et c’est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que Nous poussons ensuite vers une contrée morte ; puis, Nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C’est ainsi que se fera la Résurrection. »
[36] Le thème est récurrent, on le retrouve par exemple encore dans le Psaume 31 : « 16 Fais luire ta face sur ton serviteur; sauve-moi par ta bonté. 17Eternel! que je ne sois pas confus, car je t’ai invoqué ! Que les méchants soient confus, qu’ils se taisent dans le shéol ! 18Qu’elles soient muettes, les lèvres menteuses qui parlent contre le juste insolemment, avec orgueil et mépris. »
[37] Une œuvre importante pour situer le monothéisme en regard des autres religions et son rôle dans l’histoire humaine. En particulier « La Violence et le sacré ».
[38] « As sabt » comme référence à sa souveraineté, puis « Seigneur » à la fin de la partie centrale et au début de la dernière partie.
[39] L’étude de la sourate YaSin, à paraitre, nous permettra de développer cette notion. Dans les grandes unités il faut chercher plus que des parallèles entre des termes, mais entre des petites unités (segment, morceaux, comme ici, voir des parties entières. Souvent des mêmes phrases terminent des unités parallèles.
[40] « 53.38. Aucun ne portera le fardeau d’autrui, 53.39. en vérité, l’homme n’obtient que de ses efforts; 53.40. et son effort, en vérité, lui sera présenté. » « 75.10. L’homme, ce jour-là, dira : « Où fuir ? » 75.11. Non ! Point de refuge ! 75.12. Vers ton Seigneur sera, ce jour-là, le retour. 75.13. L’homme sera informé ce jour-là de ce qu’il aura avancé et de ce qu’il aura remis à plus tard. 75.14. Mais l’homme sera un témoin perspicace contre lui-même, 75.15. Quand même il présenterait ses excuses. » « 99.1. Quand la terre tremblera d’un violent tremblement, 99.2. et que la terre fera sortir ses fardeaux, 99.3. Et que l’homme dira: « Qu’a-t-elle? » 99.4. Ce jour-là, elle contera son histoire, 99.5. Selon ce que ton Seigneur lui aura ordonné. 99.6. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. 99.7. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, 99.8. et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra. »
[41] Voir « Intertextualité du passage 33-44 de la sourate YaSin », collectif attariq, qui montre
[42] La voix du juste pourchassé par la foule, thème central des psaumes, se retrouve dans les histoires prophétiques du Coran, où les prophètes doivent fuir en pleine nuit ou sont tués par la foule qui refuse leur parole. La foule rejette ainsi le messager pour ne pas entendre la parole de Dieu. Voir les histoires de Noé, d’Abraham, de Lot. Le thème est développé pour la relation entre Muhammad et son peuple dans la sourate YaSin.
[43] « 38.71. Quand ton Seigneur dit aux Anges : « Je vais créer d’argile un être humain. 72. Quand Je l’aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon Esprit, jetez-vous devant lui, prosternés ». « 16.4 Il fait descendre les anges avec l’Esprit par Son ordre sur qui Il veut parmi Ses serviteurs. » L’homme est bien plus que d’argile, il porte une responsabilité devant Dieu. Plus concrètement, voir « Califat ou oumma, l’Islam comme sujet de l’histoire », Collectif at-tariq, 2019.
[44] Javier Lopez, “El encuentro de Juan de Patmos con Jesús resucitado : Ap 1,9-20”, in R. Meynet – J. Oniszczuk, “Studidel quarto convegno RBS. International Studies on Biblical & Semitic Rhetoric,” ReBibSem 5, G&B Press, Roma 2015
[45] Pour qui le septième jour figure la venue du Christ et la réalisation du royaume des cieux. Ainsi chez Iréné : « Puis ce sera le septième jour, jour du repos, au sujet duquel David dit : « C’est là mon repos, les justes y entreront » : ce septième jour est le septième millénaire, celui du royaume des justes ». Croyance forte des débuts du christianisme, qui construit des communautés et postule une réalisation rapide du royaume, le millénarisme continuera à nourrir l’imaginaire populaire et « associer volonté du changement ici et maintenant et construction de rapports sociaux débarrassés du poids des institutions ». ‘Le rôle du millénarisme dans la constitution de la théorie sociologique. Le lapsus fondateur de la science sociale.’, Lourau René, Revue des Sciences Religieuses, 1978, https://www.persee.fr/doc/rscir_0035-2217_1978_num_52_3_2834
[46] Comme pour les sept cieux, le Coran semble garder les référents du judéo christianisme, en les débarrassant des symboliques polythéistes importées. « Nous rencontrons en effet un peu partout dans le monde occidental, aux alentours de l’Ere chrétienne, une conception analogue : Aux sept âges de l’homme correspondent sept époques cosmiques. Plusieurs textes astrologiques nous exposent que l’existence de l’univers se divise en sept périodes de mille ans, subissant chacune la domination d’une planète et cette théorie que les Chaldéens répandirent dans tout l’Orient s’y est perpétuée avec une remarquable ténacité” (Cumont, La fin du monde d’après les mages occidentaux, Rev. Hist. Relig., 1931, p. 48) ». Cité depuis une reconstruction catholique, très critique : ‘La typologie millénariste de la semaine dans le Christianisme primitif’, J. Daniélou, 1948, Brill. http://www.jstor.org/stable/1582410,
[47] Jour dernier, jour du jugement, jour de la résurrection, jour de la séparation, jour de vérité, jour témoigné, jour terrible, grand jour, … la majorité des 405 occurrences du terme « jour » désignent un des aspects du jour dernier, point de repère auquel est confronté le croyant, et qui l’appel à changer et entrer par la porte « aujourd‘hui ».
[48] Y compris par la forme, en l’adjectivant.
[49] On notera que cette éthique a pour sujet l’individu, la notion d’église disparait et un niveau intermédiaire apparait entre l’individu et la communauté des croyants (oumma) : « vos père et mère, vos proches, les orphelins, les infortunés, les voisins, proches ou éloignés, le compagnon de proximité, le voyageur démuni ».
[50] Il n’est pas évident que le verset 20 face partie de ce passage ou du précédent (fuite renvoie à 24:16, mais «γαρ/ܓܝܪ/car » semble impliqué un lien entre les deux versets), seule l’analyse de toute la séquence permettra de déterminer. Cependant la référence au repos est reprise dans les textes prophétiques référencés au centre du passage (Esaïe 13.3 Et le jour où l’Éternel t’aura fait reposer de ton travail et de ton tourment, et de la dure servitude sous laquelle on t’avait asservi).
[51] Mieux détaillée un peu plus tôt : « 24:9 Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir; et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10 Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. 11 Et plusieurs faux prophètes s’élèveront, et séduiront beaucoup de gens. 12 Et parce que l’iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. 13 Mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin sera sauvé.»
[52] Cette explication est donnée dans les deux passages qui entoure le nôtre, dans les versets 24:13 et 24:44.
[53] L’adjectif syriaque « faux » pour ces prétendus prophètes et messies est « dajalan ». Il y a dans le nouveau testament une ambiguïté entre leur pluralité et la figure d’un en particulier. Voir notre rapide synthèse en ligne : https://collectif-attariq.net/wp/origine-de-lexpression-al-messie-al-dajjal/ à continuer.
YaSin – Premier passage (1-12)
Présentation synthétique des parties
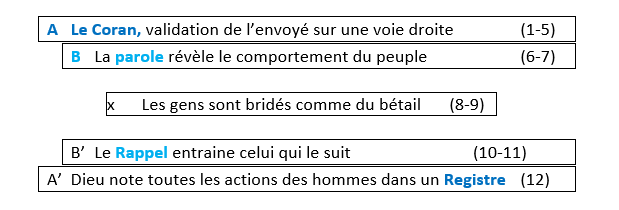
La première partie (1-7)
Premier morceau (1-4)
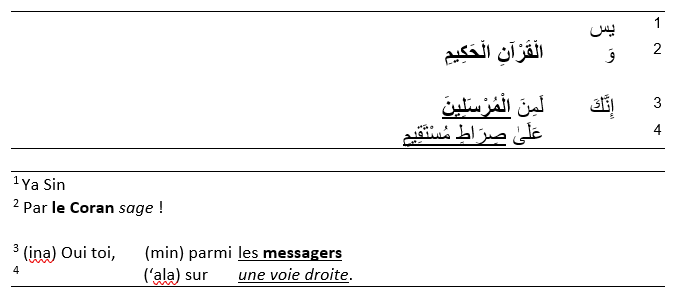
La sourate YaSin commence par les deux lettres liminaires qui lui donnent son nom. Dans le Coran, ces lettres sont toujours suivies d’une évocation de l’écrit, à l’exception de la sourate Maryam. Ici, les deux lettres YaSin et l’invocation du Coran sont réunies pour former le premier segment de la sourate. De plus ces deux membres prennent la forme des deux types d’invocations qui peuvent faire l’ouverture des sourates : les lettres liminaires (« ya sin ») et un serment introduit par ‘wa’ (« par le Coran sage »).
Le second segment confirme Muhammad en tant que messager. ‘Inak’ prend ici le sens de « certainement », de confirmation divine. Le parallèle entre les deux membres est fait sur l’idée du chemin (messager, voie), fil qui reviendra tout au long de la sourate. Muhammad est envoyé de Dieu vers l’homme, tandis que « le chemin droit » mène l’homme vers Dieu. Le Prophète avance sur cette voie dans les deux directions.
L’expression « Le Coran sage » annonce les deux membres du second segment, le « Coran » est le message apporté par le prophète, et « la sagesse » est ce qui guide l’action, donc prépare la « voie droite ». Ainsi le serment du premier segments introduit et confirment l’affirmation du second. Muhammad est bien messager car il transmet et suit la ‘voie droite’ vers Dieu, qui est l’objet du message/Coran. C’est l’unicité, entre le Coran et son porteur, le fond (la voie droite) et la forme (le Coran, le messager) qui est exprimé par la forme structurelle de ces quatre versets. Si un sens est à chercher pour les deux lettres Ya Sin, il pourrait se chercher dans cette structure. Sont-elles la forme du Coran, comme la voie droite est la forme du messager ? D’autres indices de cette énigme seront peut-être trouvés plus tard dans la structure globale du Coran.
Second morceau (5-7)

Le premier segment (5-6) décrit la finalité de la descente et donc du rôle du messager. Suivant le sens de « ma » (6a) deux sens sont possibles pour la phrase et donnent deux aspects, négatifs ou positifs, du verbe « avertir »[1]. Nous verrons plus loin comment la sourate Al Baqara donne un éclairage sur ces deux sens. Le membre 6a construit la symétrie entre le peuple et ses pères, marquée par la répétition de « avertir », verbe et complément. Cette symétrie organise le rapport avec les membres externes 5 et 6b par la logique syntaxique (5=> ‘lam’ 6a; 6b => ‘fa’ 6c ) différemment que par le sens (« descente » liée « aux pères » ; « peuple » avec « insouciants »). Elle fait de ce segment une structure très imbriquée et très cohérente, autour du pivot central (et d’un retournement au centre).
Le second segment est plus concis et plus énigmatique. 7a est aussi construit sur un verbe et son complément. Que signifie « la réalisation de la parole sur eux » ? Est-ce la cause ou la conséquence de leur incroyance ?
Le morceau est construit par la forte symétrie entre les versets 6 et 7, construits sur la même forme (verbe, complément, conséquence). La répétition de « alors », sa même ambiguïté sur la cause et la conséquence, ainsi que la rime qui relie l’insouciance et l’incroyance mettent en valeur le lien, et donc la différence entre les deux segments. Qui sera exprimée par la reprise du Coran comme terme initial de chaque segment : dans le premier la « descente » tente de remédier à l’insouciance du peuple, dans le second au contraire, cette « parole » confirme que cette insouciance est incroyance.
La différence subtile entre ces deux états donne au texte sa dynamique : l’action de la parole provoque le changement. L’état du peuple est révélé et changé dans le second. La parole opère une division : le premier segment considère le peuple comme un ensemble, incluant ‘ses pères’, le second créé une fracture entre des individus, et ne concerne plus que « la plupart d’entre eux ». Il y a donc un reste implicite, que l’on retrouvera plus loin. L’expression « s’est réalisée » implique subtilement une menace qui pourrait lier l’avertissement du peuple mecquois et les destructions des peuples précédents racontées en plusieurs passages du Coran.
Considérons la seconde traduction :
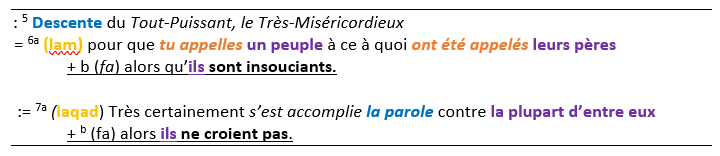
Dans cette traduction « Alors (fa) qu’ils sont insouciants » serait la raison de l’invitation, en mémoire de leurs pères. Dans ce cas ils sont insouciants malgré l’appel de ces derniers que renouvelle le Coran, qui serait alors un rappel, confirmant un avertissement reçu précédemment.[2] J. Berque dans sa traduction du verset s’étonne par exemple que « leurs pères » inclut Abraham, qui connaissant déjà Dieu. On trouve justement dans la sourate Al Baqara un appel d’Abraham :
124. Le Seigneur lui dit : Je t’ai établi pour les humains comme direction. « Et parmi ma descendance ? » demanda-t-il. Ma promesse, dit Allah, ne s’applique pas aux injustes. (…) 126. Le Seigneur dit : « Et quiconque dément, alors Je lui accorderai un peu, puis Je le contraindrai au châtiment du Feu. Et quelle mauvaise destination ! » (…) 129. Notre Seigneur ! Envoie l’un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter Tes versets, Leur enseigner le Livre et la Sagesse, et les purifier. Car c’est Toi certes le Puissant, le Sage ! »
Abraham, en comprenant que le jugement de Dieu est juste et s’applique sans préférence équitablement à tous, craint pour sa descendance et demande à Dieu de leur envoyer un messager pour leur enseigner « le Livre ». Le Coran présente Muhammad comme le prophète demandé par Abraham pour prévenir l’injustice de sa descendance. La parole qui se réalise sur eux est la menace du verset 126. Le texte établit ensuite une séparation nette entre les générations, brisant à nouveau la notion d’unité d’un même « peuple » entre les pères et les fils dans le jugement divin :
134. Cette communauté a certainement disparue. à elle, ce qu’elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Et vous ne serez pas interrogés sur ce qu’ils faisaient.
Muhammad demanderait alors à son peuple un engagement plus sérieux vers Dieu et pas seulement un mimétisme héréditaire. Les deux lectures restent possibles ensembles, suivant la reconnaissance ou non d’Abraham et d’Ismaël comme les pères des arabes, Muhammad revendiquant a minima la descendance spirituelle.
[1] « Avertir » convient très bien pour ceux qui rejettent la parole. Mais il traduit mal le côté positif également contenu dans la racine nadhara (dédier à Dieu quelque chose), « être averti », c’est « entendre l’appel » comme l’indique le parallèle avec « da’a » en 21:45. La forme IV (faire pour rendre tel) de dédier pourrait donner « convertir » ou « appeler » :
إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ
وَ لَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ
إِذَا مَا يُنْذَرُونَ
je ne fais que vous avertir (IV) par la révélation,
mais les sourds n’entendent pas l’appel
quand ils sont prévenus (I).
[2] J. Berque, Le Coran, note p. 470.
L’ensemble de la partie

La partie est constituée de deux morceaux parallèles. Le « Coran » et la « Descente » ouvrent chaque morceau, ils en sont des termes initiaux (2 et 5). Le « Coran » et « la parole » encadrent le morceau (2 et 7). « Sage », qui qualifie le Coran, fait aussi parti des noms de Dieu et pourrait renvoyer au « Tout-Puissant, le Très-Miséricordieux » dans le second morceau, une interprétation de ce parallèle serait que le Coran est sage car il vient de Dieu.
Les deux morceaux présentent l’action du prophète, son rôle d’« envoyé » par Dieu est « d’inviter » son peuple, de les tourner vers Dieu. Le parallèle entre les deux morceaux créé une tension : alors que Muhammad est « sur une voie droite » son peuple « est insouciant » et finalement « ne croit pas » à son message : le verset 4 est opposé aux membres 6b et 7b. La parole de Dieu qui confirme le messager
« se réalise » contre son peuple en révélant leur incroyance. La réception du message divin est dans le Coran et ici en particulier le critère qui distingue entre les humains (le Coran lui-même est appelé critère, « furqan »).
La 3e Partie (10-12)
1er morceau (10-11)
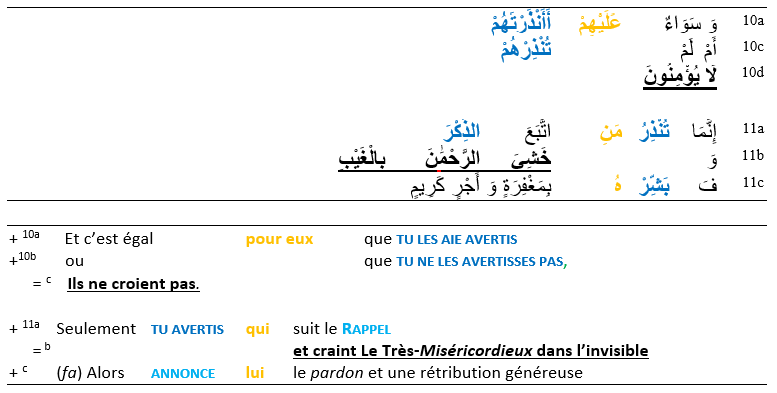
Le morceau est composé de deux segments opposés, par leur réception de l’appel. Dans le premier, le pluriel « pour eux » rassemble ceux qui ne reçoivent pas l’avertissement ; dans le second le singulier (« qui », « lui ») distingue « qui suit le rappel ».
Le premier segment est construit dans une forme AA’B. L’opposition entre les deux premiers membres forme un tout qui s’annule devant la conclusion « ils ne croient pas ». La permanence de l’incrédulité est donc indépendante de l’action du messager.
Le second segment est de forme ABA’. Le membre central suit le premier (suivre et craindre, la foi et les œuvres), et les deux ensembles décrivent le croyant. Cependant la construction et la syntaxe rassemblent les deux membres externes, avec le parallèle récurrent[3] entre « avertir » et « annoncer ». Le 3e membre n’est pas qu’une conclusion heureuse, mais la transformation du premier : l’avertissement devient bonne annonce. La foi joue le rôle de pivot, et le parallèle entre « Miséricordieux » et « pardon », résout par la confiance le paradoxe central « craindre Le Miséricordieux ».
La structure met en évidence la dynamique opposée de ces deux segments. Le premier exprime une fermeture de l’incroyance sur elle-même, tandis que dans le second la foi et l’action permettent de transformer l’avertissement en réussite. Le morceau est adressé au prophète et lui présente à lui aussi le résultat de son action. Dans le premier segment, la relation entre le messager et son peuple est brisée, car l’incrédulité finale ne dépend pas de l’avertissement initial. Alors que dans le second, il y a un rapport de causalité qui transforme la relation, montrant au prophète son importance, et l’importance de choisir à qui il s’adresse.
Intertextualité :
Le Coran reprend ici un thème de l’ancien testament, où Dieu reprend à son compte le rejet subit par le prophète. C’est d’abord une remarque de Moïse à son peuple :
« Exode 16.8 Ce n’est pas contre nous que sont vos murmures, c’est contre l’Eternel. »
Elle est redite par deux fois dans le premier Livre de Samuel où Dieu console le prophète Samuel en lui donne les raisons du rejet qu’il subit : c’est un choix par le peuple des finalités qu’il se choisit :
« 1 Samuel 8.7 L’Eternel dit à Samuel: Ecoute la voix du peuple dans tout ce qu’il te dira; car ce n’est pas toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. »
« 1 Samuel 8:8 Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d’Egypte jusqu’à ce jour; ils m’ont abandonné, pour servir d’autres dieux. »
Le prophète Ezéchiel reprend ce thème en y incluant le thème de la nuque raide[4], que l’on retrouvera plus loin : « Ézéchiel 3:7 Mais la maison d’Israël ne voudra pas t’écouter, parce qu’elle ne veut pas m’écouter; car toute la maison d’Israël a le front dur et le cœur endurci. ».
Le Coran reprend donc ce thème de l’opposition entre le prophète et son peuple, en inversant la position humaine : c’est ici parce qu’il craint Dieu que le croyant écoute le prophète : « Seulement tu avertis qui suit le rappel et craint Le Très-Miséricordieux dans l’invisible. »
[3] Remarquons que ces deux termes sont une des paires du Coran (voir 48.8 ; 35.24). Elle rassemble les deux fonctions du messager. En 2.119 : « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, », « Oui Nous t’avons envoyé avec la vérité, bonne nouvelle et avertissement ».
[4] Un front dur et un cœur raide (חִזְקֵי־מֵ֥צַח וּקְשֵׁי־לֵ֖ב), référence à l’exode קְשֵׁה־עֹ֖רֶף, un peuple à la nuque raide.
2e morceau
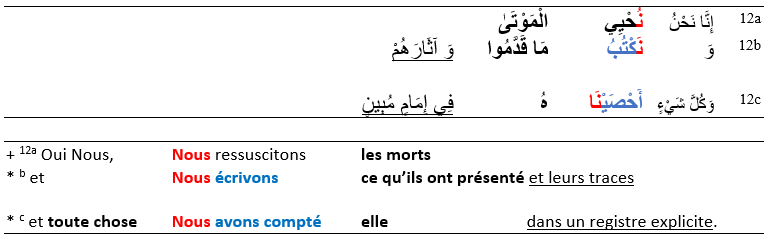
Le morceau est composé de deux segments. Tous les membres de ce morceau commencent par un verbe conjugué au « Nous divin », qui lui donnent un ton solennel. C’est une promesse énoncée par Dieu lui-même.
Le premier segment assemble deux membres parallèles, mettant en relation « les morts » (12a) et ce qu’ils ont fait de leur vivant (« ce qu’ils ont présenté et leurs traces », 12b). Dans le second membre (12b, l’opposition entre ce qu’ils ont eux-mêmes présenté et ce qu’ils laissent réellement derrière eux forme la totalité de l’action humaine. La résurrection est ainsi liée à la réalité de la vie humaine, elle semble en être la lecture[5].
Le second segment compte un seul membre (13) qui généralise le décompte : le parallèle entre « écrire » et « compter » se retrouve dans celui entre les « traces » que laissent les hommes sur le réel et le compte que laisse « toute chose » dans le « registre ». Ce parallèle place l’action humaine dans le réel, l’écriture et le décompte par Dieu rend objective l’action humaine dans la réalité. En écrivant avec tout le reste l’action humaine, Dieu rend possible la lecture du réel. Que la résurrection met en œuvre.
Ce morceau est un arrangement en fractal qui développe l’opposition entre « ce qu’ils ont présenté » et « leurs traces », entre le réel subjectif et l’écriture objective. Cette opposition se retrouve ensuite au niveau du premier segment entre la résurrection des morts et la vie humaine. Puis entre les deux segments : la résurrection des humains, et le décompte de l’univers. Au niveau du morceau entier, cette opposition formule l’énoncé suivant : Dieu, par la résurrection, rend visible les choses dans leur clarté[6].
[5] Comme l’indique ce livre ouvert devant lui à la résurrection, par exemple en 17 :13 : « Tout humain porte son sort attaché à son coup. Et nous sortirons au jour de la résurrection un livre qu’il trouvera déployé. Lis ton livre qui te suffit aujourd’hui comme décompte ».
[6] Ce morceau trouve un parallèle dans le morceau central de la sourate Al Naba qui postule le rejet de l’écriture comme un refus de rendre compte de ses actes. Voir en ligne https://collectif-attariq.net/wp/78-la-grande-prophetie-analyse-rhetorique-de-la-sourate-al-naba/
L’ensemble de la partie
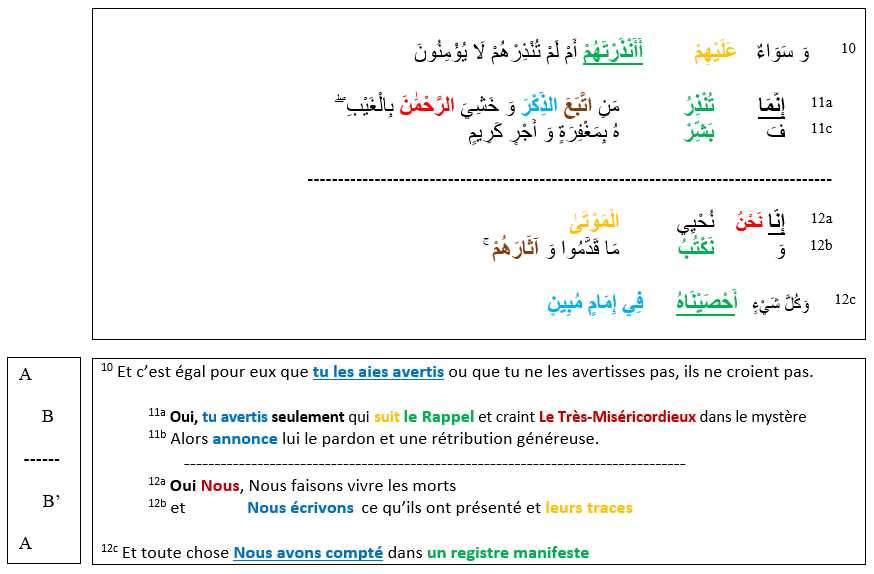
La partie est composé de deux morceaux dont les segments forment un chiasme AB-B’A’. Deux types d’écrits sont présentés en miroir. Dans le premier segment le prophète transmet le Rappel de Dieu vers son peuple (« avertir », « annoncer »). Dans le second Dieu « écrit », « compte » les actions humaines. L’écrit qui guide l’humanité, « le Rappel » est mis en miroir d’un « registre clair » (12c) qui note leurs actions.
Les deux segments AA’ (10, 12c) encadrent la partie entre deux verbes à l’accompli, de forme IV. La partie s’ouvre sur le prophète qui « avait averti » sans succès. Et se referme Dieu qui « avait compté » toute chose. Peu importe qu’ils ne croient pas, puisque toute chose est inéluctablement notée. Et par là rendue visible et compréhensible (مُبِينٍ : « clair », « manifeste »). L’opposition met en regard l’incroyance devant le texte révélé avec la clarté du registre qui « manifeste », rend visible, tout le réel.
Les segments B (11) et B’ (12ab) sont tous deux introduits par la proposition « ina » et mentionnent Dieu (« Le Très Miséricordieux », « Nous »). Ils évoquent le chemin suivit par l’homme (« suit », 11a ; « leurs traces », 12b), du point de vue de Dieu, qui conseil et observe. Le segment B termine le premier morceau par « une rétribution généreuse », que le segment B’ reprend en ouvrant le deuxième morceau par l’affirmation de « la résurrection », pivot de la partie.
C’est à la réalité que le texte fait appel comme confirmation de son message, en particulier la réalité des actions humaines. Dieu, par la résurrection, est le pivot qui place la subjectivité humaine en face de sa réalité objective. Ainsi le rappel de la résurrection, et des textes précédents, est un rappel à l’homme sur lui-même. Celui qui écoute le rappel est celui qui accepte déjà aujourd’hui de confronter ses actions à l’écrit. Le parallèle entre le « Rappel » et le « Registre » du réel explique l’opposition entre « ils ne croient pas » et «manifeste » : ils ne croient pas dans ce qui est manifesté, presque mis sous leur nez par la résurrection : leurs actions objectives. Constamment, le Coran suppose le rejet du texte comme refus de voir ses propres actions (d’où l’emploi de la racine « KFR », recouvrir).
L’écrit, le chemin et l’homme sont ici entremêlés dans un même mouvement. Dieu est à la fois celui qui écrit les actions et les révèle. L’inversion temporelle entre les deux morceaux (comment la connaissance advient avant l’observation ?) laisse imaginer un espace atemporel d’où part l’écrit et où il aboutit, les « tables préservées ». Intermédiaire nécessaire de la sagesse et de sa transmission. Le simple énoncé que l’action humaine laisse des traces, manifeste leur réalité à l’esprit du lecteur et en constitue déjà le rappel.
Tout l’enjeu de la résurrection (« Nous faisons vivre les morts », 12a), qui n’a pas de parallèle dans ce passage, est la révélation à l’homme de son écrit[7]. Seuls ceux qui écoutent le « rappel » et alignent leur pas sur la connaissance de leurs actions et de leurs conséquences se voient pardonné leurs erreurs. Et ceux qui n’y croient pas, refusent de voir leurs traces (recouvrent l’écrit qui les manifeste) sont menacés par la résurrection, qui en sera la révélation.
[7] On pensera à ces livres présentés aux hommes au jour de la résurrection, dont l’intention est bien de présenter l’écriture objective de leurs actions. Ainsi en 17.13-14 : « Nous attachons l’œuvre de chaque homme à son cou. Et le Jour de la résurrection, Nous lui montrerons son livre ouvert : Lis ton livre, tu peux faire le compte, aujourd’hui, toi-même ». On pensera également à 82 :10-12 : « Mais il y a des gardiens sur vous, de nobles scribes, ils savent ce que vous faites » (S82 : V 10 à 12) et 45 :29 : « Voici Notre Livre. Il parle contre vous avec vérité car Nous inscrivons vos actes ».
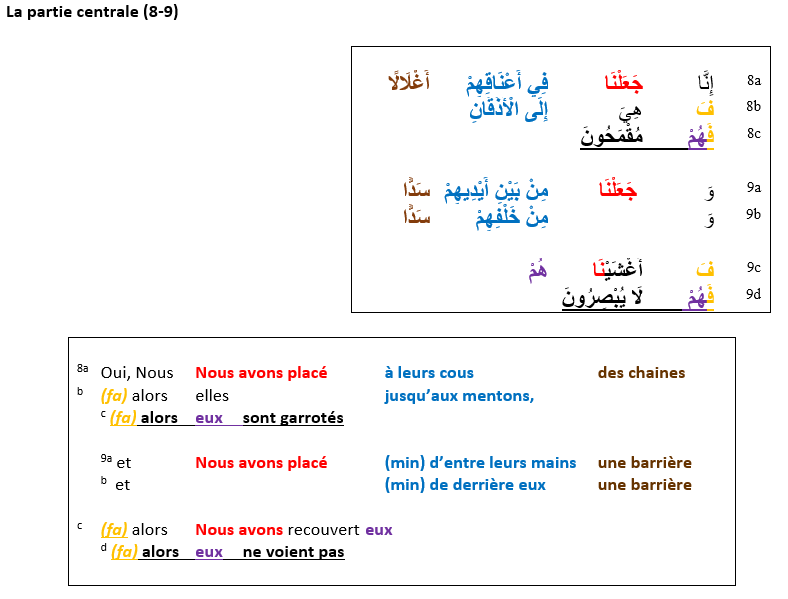
La partie est constituée d’un seul morceau de trois segments. Chaque segment est introduit par un verbe par lequel Dieu bloque les corps : la tête, puis le mouvement et les sens.
Le premier segment est fait de trois membres. Les deux premiers nomment des parties du corps. Placés sur les « cous », les chaines progressent « jusqu’aux mentons », la symétrie continue l’enchainement et le rend complet. La répétition de « fa (alors) » donne l’effet d’une progression jusqu’au troisième membre qui décrit le résultat : ils sont bloqués.
Le deuxième segment est fait de deux membres. L’opposition entre « derrière » et devant eux (« entre leurs mains ») forme une totalité : ils sont enfermés par les barrières. Il s’agit de limites au-delà d’eux-mêmes (bien que semblant venir d’eux, par la répétition de « min »), comme un enclot.
Les deux membres du troisième segment mettent en parallèle la cause et la conséquence (« recouvert », « ne voient pas »), mises sur un pied d’égalité par la répétition de « fa » et de « eux ». C’est aussi l’action divine (Nous les avons garroté) et l’action humaine (ils ne voient pas) qui sont mises en parallèles.
Les deux premiers membres reprennent le verbe « Nous avons placé « , les parties du corps et les éléments bloquants (chaine, barrière). Alors que le troisième membre semble une conséquence introduite par « fa ». Le morceau semble donc de forme AA’B. Cependant les deux morceaux externes (8 et 9cd) sont mis en parallèles par leurs derniers membres, de forme semblable et qui concluent sur le blocage des personnes mentionnées (8c, 9d). Ce qui donne une forme ABA’ au morceau. Le premier morceau joue donc un rôle particulier, liés aux deux autres. Il donne aussi la forme de l’ensemble : deux membres mentionnant le corps (comme les deux premiers segments) et une conclusion (comme le troisième segment).
Il convient enfin de noter le parallèle entre le blocage du corps et en particulier de la tête et le blocage des sens : ne pouvant agir, ils ne peuvent non plus percevoir. Comme des animaux dirigés par des œillères. Ici le terme « مُقْمَحُونَ », un hapax dans le Coran, pourrait se traduire par « maintenus », selon l’image du blé, ou plutôt « garrotés » évoquant le cou de l’animal dirigé ou de l’homme prisonnier. A moins que le terme n’ait un lien avec l’Ethiopien ቀምሐ, le bétail (ceux qui mangent le grain).
L’image rappelle par le coup bloqué « le peuple à la nuque raide »[8] de l’ancien testament vu précédemment. Dans la sourate Al Baqarah, recouvrir les sens est une référence explicite à Isaïe[9]. Comme pour les hypocrites au début de la sourate Al Baqarah, Dieu reprend à son compte leur aveuglement et leur incompréhension, traduite métaphoriquement par l’action de « recouvrir » leurs yeux et leurs oreilles. Etant « maintenus » et aveuglés, les hommes ne peuvent ni ressentir ni se diriger eux-mêmes, ils sont bridés, tels du bétail, enfermés dans un enclot. Le Coran reformule les paraboles de l’ancien testament dans une métaphore nouvelle du bétail entravé. Nous verrons que cette image prend sens à la fin de la sourate.
Il n’est pas précisé s’il s’agit d’un châtiment au jour dernier, ou bien d’une métaphore pour le peuple qui ne veut pas comprendre, reformulée à l’égard des mecquois qui rejettent la parole prophétique qui leur est adressée.
[8] Exode 33.5 : Et l’Eternel dit à Moïse: Dis aux enfants d’Israël: Vous êtes un peuple à la nuque raide; si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ote maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. 6 Les enfants d’Israël se dépouillèrent de leurs ornements, en s’éloignant du mont Horeb.
[9] Isaïe 6,10 (repris en Matthieu 13,14-15 et Jean 12,40) présente une métaphore analogue : « Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d’oreille, bouche-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n’entendent, que son cœur ne comprenne, qu’il ne se convertisse et ne soit guéri. »
L’ensemble du passage
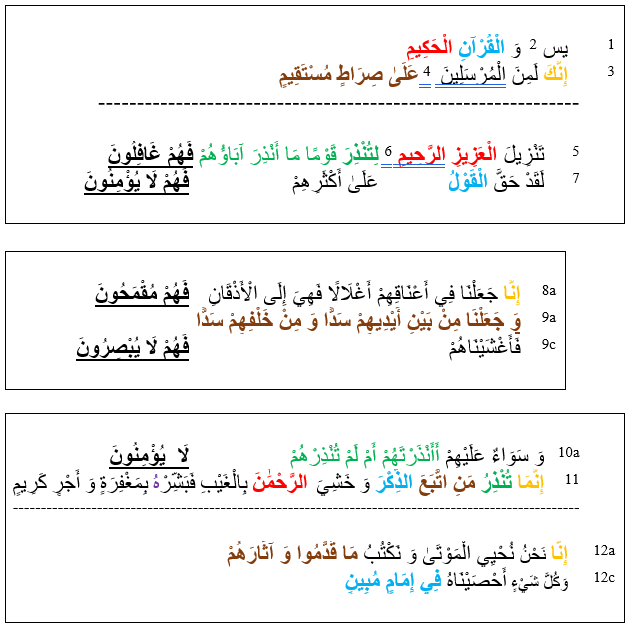
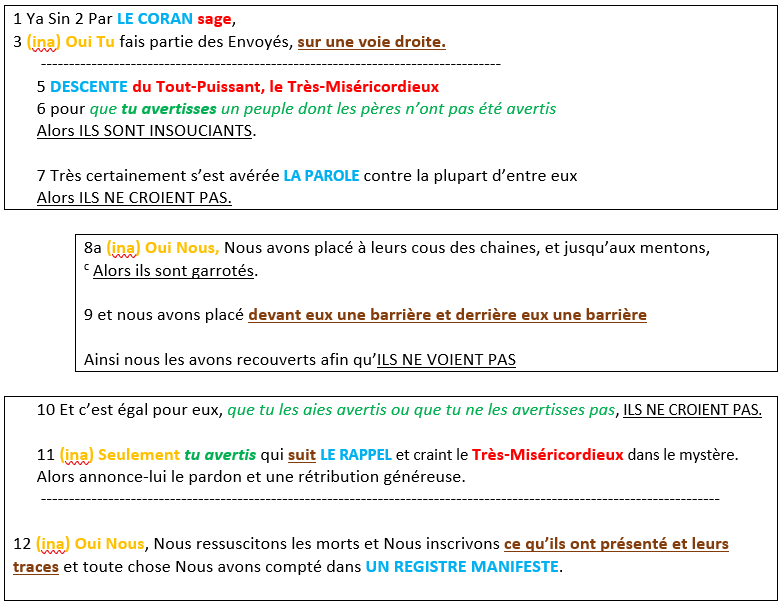
Le passage est composé de 3 parties concentriques, dont les deux parties externes forment un chiasme qui encadre la partie centrale. Ainsi les 5 morceaux forment une structure (AB) C (B’A’). Les deux parties externes forment un chiasme ABB’A’ : les morceaux A (1-3) et A’ (12) sont parallèles, de même que les morceaux B (5-7) et B’ (10-11).
Les deux morceaux A et A’ encadrent la partie par deux affirmations appuyées sur le texte : l’envoi du prophète et la résurrection. Cet envoi ouvre la métaphore du chemin, et le chemin de l’envoyé (« la voix droite », 3), présenté dans le Coran, est mis en valeur parmi tous les chemins possibles (« leurs traces », 12) notés dans le Registre. La sagesse du Coran semble puiser dans le compte de ce dernier.
Les deux morceaux B et B’ précise la mission du prophète, « avertir » son peuple, dans deux grandes phrases symétriques ou le verbe est répété avec sa négation (6, 10). « Le Très Miséricordieux », repris dans les deux morceaux (5,11) agit à travers l’écriture (« la Parole » et « le Rappel »). La conclusion sur le peuple, « ils ne croient pas », termine B et ouvre B’. Celui « qui suit le Rappel » est le reste opposé à « la plupart d’entre eux » sur qui « s’est avérée La Parole ». Cet accomplissement de la parole pourrait renvoyer au verset 7.179 : « Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes pour l’Enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les inconscients. » qui lie dans un seul morceaux le jugement de la résurrection, la citation d’Isaïe et les bestiaux de la partie centrale, et l’inconscience du peuple.
La partie centrale est une césure, dont l’énoncé rompt abruptement avec ce qui le précède. Elle illustre ceux qui ne « ne croient pas » par une métaphore filée qui se termine sur « ils ne voient pas ». Leur attitude est comparée à des entraves qui les empêchent de voir et de se déplacer par eux-mêmes, ils sont comme du bétail (inversion intéressante du rôle du berger dans le nouveau testament). Le chemin évoqué dans les parties externes est ici bloqué (« devant eux une barrière et derrière eux une barrière », 9), introduisant l’opposition devant eux et derrière eux, qui sera reprise dans la dernière partie par le visible et l’invisible des actions humaines. Cette partie cachée des actions humaines dans la dernière partie est préparée par « ils ne voient pas ».
[1] « Avertir » convient très bien pour ceux qui rejettent la parole. Mais il traduit mal le côté positif également contenu dans la racine nadhara (dédier à Dieu quelque chose), « être averti », c’est « entendre l’appel » comme l’indique le parallèle avec « da’a » en 21:45. La forme IV (faire pour rendre tel) de dédier pourrait donner « convertir » ou « appeler » :
إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ
وَ لَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ
إِذَا مَا يُنْذَرُونَ
je ne fais que vous avertir (IV) par la révélation,
mais les sourds n’entendent pas l’appel
quand ils sont prévenus (I).
[2] J. Berque, Le Coran, note p. 470.
[3] Remarquons que ces deux termes sont une des paires du Coran (voir 48.8 ; 35.24). Elle rassemble les deux fonctions du messager. En 2.119 : « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, », « Oui Nous t’avons envoyé avec la vérité, bonne nouvelle et avertissement ».
[4] Un front dur et un cœur raide (חִזְקֵי־מֵ֥צַח וּקְשֵׁי־לֵ֖ב), référence à l’exode קְשֵׁה־עֹ֖רֶף, un peuple à la nuque raide.
[5] Comme l’indique ce livre ouvert devant lui à la résurrection, par exemple en 17 :13 : « Tout humain porte son sort attaché à son coup. Et nous sortirons au jour de la résurrection un livre qu’il trouvera déployé. Lis ton livre qui te suffit aujourd’hui comme décompte ».
[6] Ce morceau trouve un parallèle dans le morceau central de la sourate Al Naba qui postule le rejet de l’écriture comme un refus de rendre compte de ses actes. Voir en ligne https://collectif-attariq.net/wp/78-la-grande-prophetie-analyse-rhetorique-de-la-sourate-al-naba/
[7] On pensera à ces livres présentés aux hommes au jour de la résurrection, dont l’intention est bien de présenter l’écriture objective de leurs actions. Ainsi en 17.13-14 : « Nous attachons l’œuvre de chaque homme à son cou. Et le Jour de la résurrection, Nous lui montrerons son livre ouvert : Lis ton livre, tu peux faire le compte, aujourd’hui, toi-même ». On pensera également à 82 :10-12 : « Mais il y a des gardiens sur vous, de nobles scribes, ils savent ce que vous faites » (S82 : V 10 à 12) et 45 :29 : « Voici Notre Livre. Il parle contre vous avec vérité car Nous inscrivons vos actes ».
[8] Isaïe 6,10 (repris en Matthieu 13,14-15 et Jean 12,40) présente une métaphore analogue : « Appesantis le cœur de ce peuple, rends-le dur d’oreille, bouche-lui les yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n’entendent, que son cœur ne comprenne, qu’il ne se convertisse et ne soit guéri. »
[9] Exode 33.5 : Et l’Eternel dit à Moïse: Dis aux enfants d’Israël: Vous êtes un peuple à la nuque raide; si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ote maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. 6 Les enfants d’Israël se dépouillèrent de leurs ornements, en s’éloignant du mont Horeb.
YaSin – Analyse de la sourate
L’étude de la sourate YaSin a commencé comme un atelier, dans un groupe ayant pour vocation d’étudier et de faire connaitre la rhétorique sémitique appliquée au Coran, appellée rhétorique coranique.
Ce groupe n’a malheureusement pas continué ni aboutit à la publication d’un livre comme ce fût le souhait au départ. A défaut, il fût décidé que chacun publierait son analyse en fonction de ses propres travaux. Ce sont donc ceux-ci que je présente dans ces pages.
La rhétorique coranique, qui inscrit la reflexion et l’analyse de texte dans la durée, se prête particulièrement à des formes d’atelier. Nous suggérons fortement à ceux qui s’intéressent de se regrouper pour découvrir et approfondir l’étude des textes.
Nous encourageons les lecteurs interessés à s’y essayer sur des sourates non encore étudiées, ou voulant proposer des remarques sur ceux publiés, à nous écrire via le site ou à l’adresse [email protected] .
An Nahl Sequence 1
Première Partie
versets 1 à 4
Allah descend les anges avec l’esprit et créé les cieux et la terre en vérité
La partie est construite de trois morceaux
concentriques selon une forme ABA’. Les deux morceaux extérieurs décrivent deux
formes d’action du Dieu, tandis que le morceau central est une adresse à
l’humanité.
Le premier morceau est également de forme concentrique. Dans les deux segments
exterieurs Allah agit, par la parole : le terme “ordre” se retrouve
dans les deux. Son autorité est renforcée par l’injonction “ne pas
précipiter” et le côté arbitraire du choix divin “sur qui Il veut”.
Une action est passée et définitive, c’est l’ordre, donné dès le début du monde
et qui concerne la fin, l’autre est une action continue, comme la pluie qui
tombe, Allah envoie constamment des anges. Ces actions sont en effet dirigées
vers le monde, comme l’indique le terme “descend”. Ainsi l’ordre et
les anges, les deux objets, sont envoyés vers le monde et l’homme, que l’on
trouve ensuite. Au centre du morceau se trouve une louange, accompagnée d’une
remarque sur la supériorité d’Allah en regard des divinités des hommes.
Le dernier morceau est composé de deux segments
bimembres, fortement parallèles. Dans leurs deux premiers membres, Allah créé,
d’abord le monde, puis l’homme. Dans leurs deux second membres, nous lisons
l’association de divinités avec Allah, puis l’aspect disputeur de l’homme. Dans
chaque segment, le parallèle entre les deux segments suggère un sens, par
parataxe [cf M. Cuypers, ] :
–
dans le premier, le parallèle entre les cieux et la
terre avec “ce à quoi ils associent” rappel que l’homme se choisit
des divinités parmi ce qu’il voit, ce qui existe. Or pour l’auteur, ceux-ci
font parti du monde créé par Allah. En ceci il leur évidement supérieur.
–
dans le second segment, la mise en paralèle entre
“d’une goutte” et “disputeur évident” tend à ramener
l’homme à sa condition et à opposer celle-ci au rôle qu’il se donne en
désignant des divinités : l’homme n’a été créé que d’une petite chose, il se
comporte pourtant comme un dieu. Ce second segment renforce l’idée du premier :
Allah qui a créé le monde et l’homme, est incomparable à ceux-ci.
Le morceau central n’a pas la même forme que les
deux autres, il y a un seul segment, trimembre. L’ordre donné aux anges
“Avertissez” dans le premier membre fait echo à l’ordre donné aux
hommes dans le dernier “Itaqou”, c’est-à-dire “soyez
pieux”. Au centre du morceau, la déclaration de l’unicité divine, ici à la
première personne.
Ce second morceau est mis en valeur par plusieurs
aspect du texte : il n’y a qu’un seul segment, trimembre, alors que la partie
est composée partout ailleurs de segments bimembre, les deux autres morceaux
décrivent une action, alors que nous avons ici un discours, Allah parle à la
première personne. Ces aspects textuels mettent en valeur le discours divin, au
centre d’une description de deux mondes distincts. Au niveau de sa place, il
fait séparation entre les deux. Mais on remarquera qu’au niveau du sens, il
créé un lien, puisque c’est un discours transmis par les anges du premier
monde, et “Ina”, presque “pour qu’ils” ici, fait
grammaticalement le lien entre le premier morceau et le morceau central. Et
c’est un discours adressé au monde du dernier morceau “devenez
pieux”. Remarquez que l’homme, qui peut être “de Ses serviteurs”
ou “un disputeur évident” est présent dans les deux morceaux, ce sont
donc “Ses serviteurs” qui comme les anges, font le lien entre les
deux mondes et transmettent le discours divin. Ce morceau joue un rôle de
centre entre les deux, par la forme il marque la séparation entre les deux
mondes. Mais il est aussi par le sens ce qui fait le lien entre les deux,
l’invitation d’Allah à le reconnaître et à la “taqwa”, descendu par
les anges vers les hommes.
Deux mondes distincts
L’existence du monde réel est ici attestée, “avérée”
: “bil haq” donne une notion de réalité. Le texte parle “des
cieux et la terre”, c’est-à-dire l’univers dans sa totalité (comme dans
l’expression “des pieds à la tête”, l’utilisation de deux opposés est
utilisé pour décrire l’ensemble) également décrite comme créée. Ainsi le
discours coranique reconnait la réalité du monde : il a été créé et existe
“bi lhaq”, c’est-à-dire en vérité, en réalité. Ainsi que l’humanité,
qui existe charnellement dans le monde.
Au dessus, un Dieu est présenté ici, qui créé, ordonne, puis agit en envoyant
ses anges vers ses serviteurs, dans le monde. Son action se fait [par, avec,
en] “esprit”. Cet “esprit” est en miroir avec
“vérité”. C’est un monde différent de la réalité observable du monde
créé. C’est celui qui donne la vérité du monde : il a été créé par Allah, qui
n’y est pas inhérent. C’est un dieu unique, et la divinité est présentée comme
surpassant l’univers, puisqu’elle l’a créé. La divinité est en dehors de
l’univers observable, à l’opposé des divinités choisies par l’homme, qui elles
en font parti.
On retrouve ici deux mondes distincts : l’univers dans sa totalité, dans lequel
l’homme évolue, la réalité, et un monde supérieur, duquel Allah, par
l’intermédiaire de ses anges, abreuve le monde réel d’esprit. Ces deux
mondes sont séparés, bien qu’une descente puisse être opérée de l’un vers
l’autre. [alors que le chemin inverse est barré par des meteores].
L’association
Le terme “youshrikoun”, de la racine
sharik, partager, décrit une action des hommes, qui “partagent”,
divisent, “associent” la divinité. Pour ceux là, la divinité est
associée à des objets pris dans le monde réel, il y a une confusion entre le
monde réél et le monde spirituel. En effet, si l’on reprend le texte du point
de vue de l’homme, il y a deux actions opposées décrites :
–
Les serviteurs de la première partie, qui réçoivent
dans la réalité l’esprit venu d’un Dieu qu’ils reconnaissent unique,
c’est-à-dire exterieur. Il y a là une transcendance qui “par
l’esprit” contemple le monde “en vérité”, et appel “à
craindre”, c’est-à-dire à devenir pieux, humble. L’univers n’est plus un
monde clos, il existe un ailleurs, qui permet de contempler l’univers pour ce
qu’il est.
–
L’homme de la seconde partie, qui élève des
choses réelles en les confondant à la divinité. Il y a là une immanence qui ne
connait pas une divinité unique, mais la partage et l’associe à des choses
materielles, qui sont idéalisées. Cet homme ne voit pas la différence entre les
deux mondes, marquée par la partie centrale, qu’il ne reconnait pas. Il vit
dans un univers clôt, duquel il choisit des idoles auquelles il confère des
pouvoirs divins.
Il y a ici une idée paradoxale et typiquement
monothéiste : la transcendance est dans l’ordre reçu par le serviteur et
l’acceptation de la réalité, alors que l’immanence est ici contestation de
l’ordre et idéalisation de la réalité. Le monde est bien réel, mais l’homme est
invité à le dépasser [n’est qu’un lieu, réel mais temporaire, il est invité à
considérer le futur des choses, voir al naba, voir Paul]. L’association, en
niant l’aspect exterieur de la divinité, créé une confusion entre le monde réel
et le monde spirituel, elle adore le monde pour lui-même, en niant un ailleurs.
C’est une vision caractéristique du monothéisme, nous verrons si la sourate
permet d’éclairer ce paradoxe, mais la partie centrale donne un indice :
l’humilité du serviteur.
Seconde Partie
versets 5 à 9
Il a créé les bestiaux pour porter vos fardeaux vers un pays
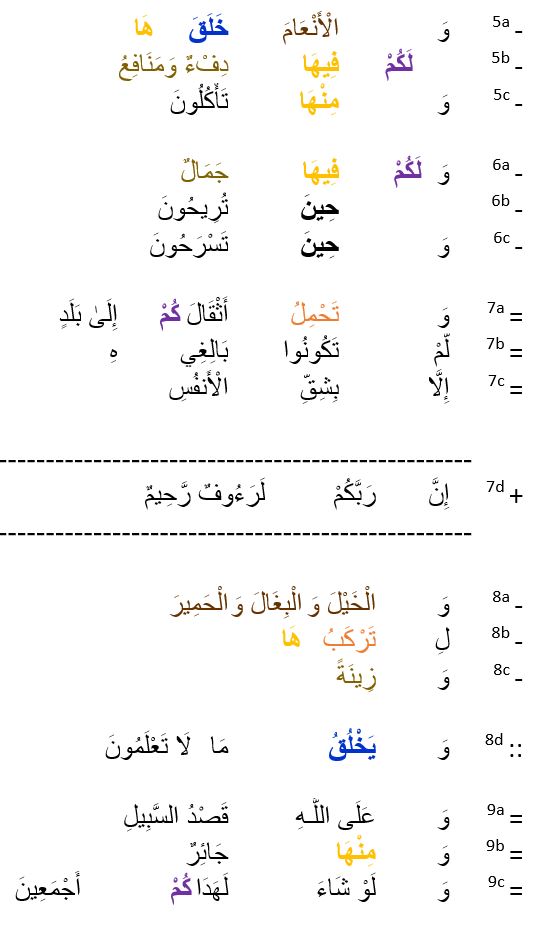
La partie se
compose de trois morceaux, deux trimembres à l’exterieur et un morceau central
unimembre. Les deux morceaux exterieurs parlent l’un des bestiaux, le betail,
l’autre des animaux que l’on peut monter. Le morceau central loue l’attention
du Seigneur.
Le premier morceau est composé de trois segments. Les deux premiers décrivent
ce que l’homme trouve dans les bestiaux, marqué par la répétition de “pour
vous” dans les deux segments et l’insistance sur “en eux” (fiha,
minha).
Les avantages
sont materiels, de la chaleur (d’eux-mêmes, et de leurs peaux ou de la laine comme
vêtments) et de la nourriture dans le premier segment.
Le deuxième
segment introduit deux choses nouvelles, à travers une parataxe très
suggestive. Le premier membre reprend une forme du premier segment, cependant
au lieu d’avantages, nous avons la beauté, tandis que les deux derniers
membres, semblable par la forme et opposés par le sens, introduisent l’idée de déplacement.
Ces deux membres évoquent l’idée du travail avec les animaux et les
déplacements dans les montagnes pour les amener paître. Jusqu’au voyage des
populations nomades ou semi nomades. La beauté devient celle des animaux et des
paysages, la contemplation, et à travers elle la satisfaction du travail
accompli, un mode de vie pastoral.
Le troisième
morceau est de forme différente, et les bestiaux deviennent sujet. Ce sont eux
qui portent les fardeaux des hommes. Les deux premiers membres mettent en
opposition les bestiaux, qui portent et les hommes qui ne pourraient pas
arriver à destination avec leur fardeaux. Fardeaux est placé dans le premier
membre, objet de l’action des bestiaux, alors qu’il n’a pas d’équivalent dans
le second membre. mais dans le troisième membre, “âme”, induisant
l’idée que ce sont ces fardeaux, trop lours pour l’homme seul, qui brisent son
âme et l’empêchent d’atteindre le pays/la ville.
Le dernier
morceau est plus hétérogène. C’est le déplacement qui le structure : le premier
segment décrit les animaux que l’on chevauche, le troisième segment parle de la
direction à suivre sur le chemin. Au centre se trouve l’inconnu, connu d’Allah
seul. C’est bien l’objet de ce passage, plutôt que l’ornement, le visible
inutile (8c), Allah déteint la clef de l’inconnu (8d), et est en conséquence le
plus apte à guider sur le chemin(9c). [Il pourrait être le gardien de cette direction,
si l’on accepte de voir un chiasme en 9a-b : “Et sur Allah / la direction
du chemin / Et de celle-ci / un protecteur”.]
Si la structure
du dernier morceau est plus relâchée, le lien entre le premier et le dernier
morceau est très structuré. Les animaux montés font echo au bétail, dans les
deux premier morceaux. La beauté des uns (6a) se retrouve dans la valeur
d’ornement des autres(8c), les premiers portent les fardeaux (7a) tandis que
les seconds portent les hommes (8b). Les deux derniers segments sont liés par
“la direction”, subliminale dans le voyage “vers” une ville
(7a), est développée dans le dernier morceau, quand Allah devient le guide.
Celui-ci est présenté en connaisseur de l’inconnu dans le segment central du
dernier morceau (8d), peut-être en lien avec le voyage évoqué par le
déplacement du second segment du premier morceau (6b-c). Enfin, si le chemin et
les fardeaux provoquent “la division”, Allah pourrait
“assembler”, restant l’enigmatique s”il voulait”, qui sera
développé au cours de la sourate.
Dans le morceau
central, la divinité est proche de l’homme, s’en occupe. C’est par sa création
qu’elle se dit perceptible. Les hommes sont invités à trouver dans leur monde
ce dont ils ont besoin, une aide, et finalement une direction vers une ville/un
pays, dont Allah connait le chemin.
Les fardeaux de
l’âme
2.286, voir
aussi la charge de la terre 99, et le sens parallèle de wezr, que l’on
retrouvera plus loin dans la sourate.
Hébreux
11;12;13 : 16 – 19
Mathieu
11:28-30 les fardeaux de l’âme.
Luc 21 19
Possédez vos âmes par votre patience. 20 Et quand vous verrez Jérusalem …

Premier Passage
versets 1 à 9
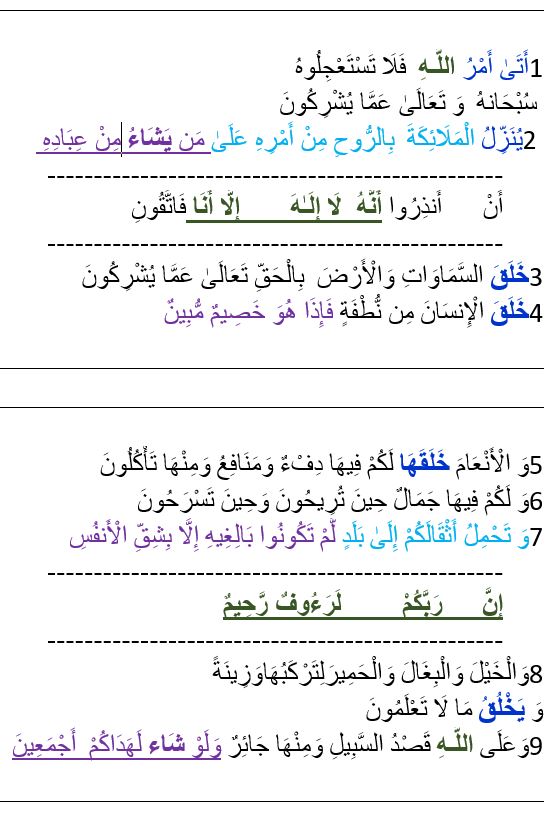
Le passage est composé de deux parties à la structure quasi identique (seul détonne le deuxième morceaux de la première partie, unique morceau bimembre). Le terme Allah fait inclusion, il se troue dans le premier et le dernier membre du passage. Il est aussi présent dans les deux morceaux centraux, d’un seul segment ; l’importance de ceux-ci est redoublée par leur parallèlisme, qui décrivent la divinité. L’action d’Allah structure les morceaux externes, avec la répétition de “Il a créé”, à l’exception du premier, où l’action par la parole, qui agit sur la création est ainsi mis een valeur.
Une autre incusion se trouve dans la répétition du verbe “yacha”, vouloir, en terme finaux des premièrs et derniers morceau du passage. La différence entre les deux membres fait deviner un choix : celui des serviteurs, choisis parmi l’ensemble. Semble alors opposé l’homme, contestataire évident, qui n’arriverai pas seul à sa destination. On trouve d’ailleurs deux mouvements. Dans la première partie il s’agit des anges, qu’Allah envoye avec l’esprit vers le monde. La mise en parallèle des deux parties y voit une réponse dans le voyage de l’homme vers une ville, destination mystérieuse. Certes, “Il créé ce que vous ne connaissez pas”.
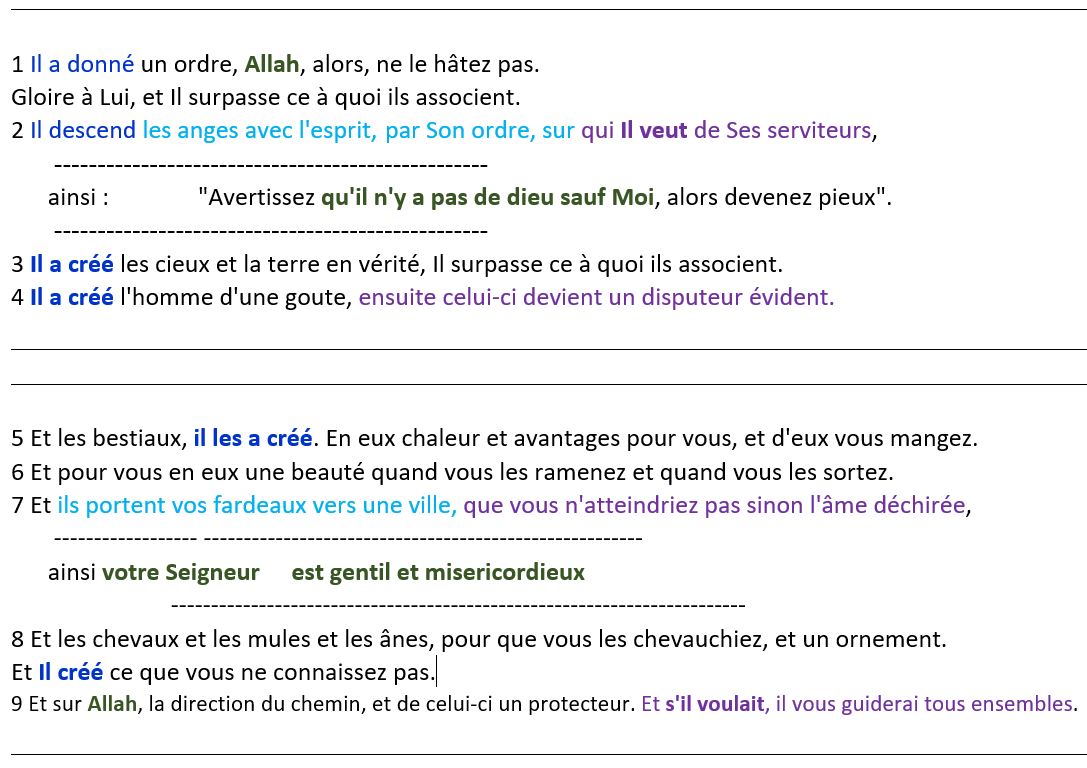
Troisième Partie
versets 10 à 13
Allah ordonne les choses pour que vous vous guidier
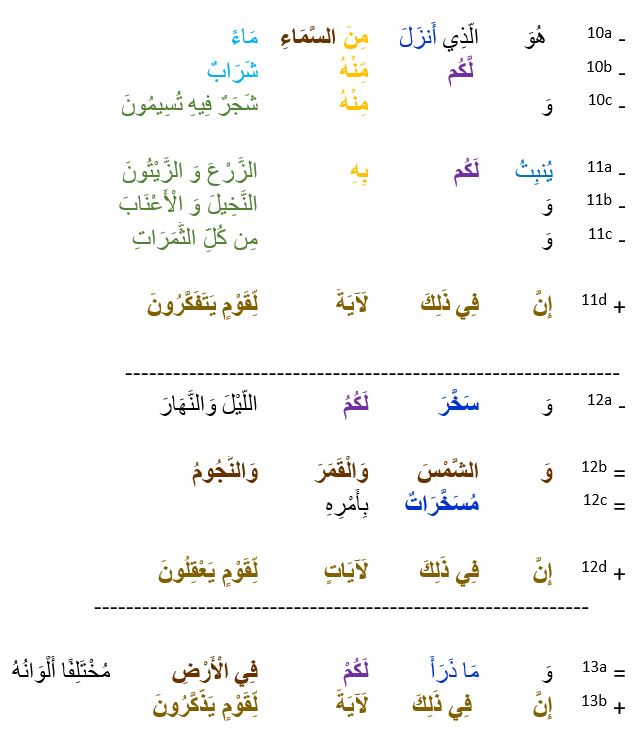
C’est une partie concentrique, en
trois morceaux. Le ciel dans le premier, puis les astres celestes dans le
second servent de termes initiaux, les signes, et le membre qui le contient
(11d, 13c, répété en 12b) servent de termes finaux. Au centre, le jour et la
nuit, phénomène astronomique.
Le premier morceau est composé de
3 segments, selon un arrangement AA’B. Les deux premiers ont pour cause l’eau,
qu’Allah fait descendre du ciel. Les deux morceaux décrivent ce qui sort
“d’elle”, “pour vous”. Outre une boisson, celle-ci produit
une végétation qui nourrit les animaux (premier morceau), puis des fruits
(second morceau). Le troisième est plus énigmatique, et invite à réfléchir pour
trouver des “signes” (“ayat”, même terme que “ayat”,
les versets) dans la description du phénomène naturelle.
Cette phrase est repris et
structure les deux segments trimembres du dernier morceau. Dans ceux-ci les
atres du ciel, puis la terre elle-même, servent de termes initiaux, et notre
phrase est reprise comme membre final des deux segments, mettant l’emphase sur
la logique, puis le rappel. L’action d’Allah est omniprésente dans l’univers
décrit, il assujetti les astres (probablement à leur course) et invite à user
de logique (à leur sujet). Il mutltiplie les choses les sur la terre, et
invite à se souvenir de leur différentes couleurs.
Différentes ses couleurs
On trouve dans ces deux mots un
sens omniprésent dans la partie. Au-delà de la nuit et du jour, qui forment une
paire (toutes choses Nous avons créé par paire), nous avons là une invitation à
contempler la multitude. Dans le ciel, les astres : au-delà du soleil et de la
lune, encore une paire, il y a la multitude des étoiles, et un astre unique
parmi eux, la terre où nous sommes. Il y a la végétation et sa multitude, les
fruits (sont-ils donnés par deux ?) et leur multitude. Tous sont différents,
notamment par leur couleur, tout comme les étoiles.
On retrouve les trois nombres de
la grammaire arabe : la multitude (la végétation, les étoiles), le duel (la
nuit et le jour, le soleil et la lune) et le singulier (la terre). Que faire de
l’eau ? Le lecteur est ainsi invité à contempler la diversité de la création,
sa multitude, et les particularités de chaque chose parmi la multitude, que
signifient les couleurs. Pour s’en rappeler. En particulier ici, la
particularité de la terre.
Des signes
L’affirmation des signes, par son
aspect énigmatique, est une invitation à chercher un sens. Celui-ci n’est pas
donné immédiatement, le lecteur est donc invité à le trouver. Nous avons
regardé ensemble celui des couleurs.
Dans le premier paragraphe, nous
sommes invités à contempler le cycle de l’eau, et comment on s’en nourrit : il
produit à boire et des fruits. Outre un pâturage indistinct pour les animaux,
il y a des fruits, que l’homme aussi peut manger. Cela nous rappelle la
distinction dans la génèse, les arbres avec leur semence en eux et ceux qui
produisent du fruit. C’est l’eau qui le nourrit, comme cet arbre du premier
psaume, repris dans le Coran. Cette eau, qui descend du ciel, qui fait vivre la
terre en faisant pousser la végétation est souvent repris, c’est le verset 7:57
qui nous paraît le plus éclairant ici : “C’est Lui qui envoie les vents
comme une annonce de Sa Miséricorde. Puis, lorsqu’ils transportent une nuée
lourde, Nous la dirigeons vers un pays mort [de sécheresse], puis Nous en
faisons descendre l’eau, ensuite Nous en faisons sortir toutes espèces de
fruits. Ainsi ferons-Nous sortir les morts. Peut-être vous
rappellerez-vous.” Non seulement il reprend l’ensemble des fonctions
que nous avons attribué à l’eau, mais ici les vents / comme annonce de Sa
miséricorde / transportent une nuée lourde, nous invitent à voir un parallèle
entre l’eau descendue et la miséricorde annoncée. N’irait-on pas chercher dans
l’esprit descendu avec les anges au début de la sourate l’explication du signe
donné ici ? L’esprit, descendu continuellement, qui fait vivre la terre, et
sortir d’elle des plantes et des fruits ? Nous avons vu dans la sourate
Al-Naba, que c’est justement la présence ou l’absence de cette eau qui fait la
différence entre la géhenne et le jardin.
Reste donc à chercher quels
signes la logique permet-elle de chercher dans les astres.

Réponse à Rachid Benzine : Trois découpages possibles
Le principe de la rhétorique sémitique est que le texte est construit, au-delà de sa grammaire, par une structure qu’il s’agit alors de révéler. L’observation de nombreux textes a permis de montrer que cette mise en forme structurelle obéit à des règles, constatées d’abord de manière empirique par de nombreux chercheurs, puis systématisées par Roland Meynet, et Michel Cuypers plus spécifiquement pour le Coran. Cette systématisation, sa régularité et sa capacité à expliquer un texte de bout à bout ont montré que ce mode de construction est intrinsèque au texte et qu’il n’y a qu’une seule structure pour un seul texte.
Les bases de la structure rhétorique sont la parataxe et la binarité : l’apposition côte à côte de deux mots ou de deux phrases construit un sens par leur mise en relation et forme une unité supérieure. La structure rhétorique est ainsi faite de mise en relation binaires ou ternaires, construites les unes sur les autres. Ce sont ces rapports d’analogie, de parallélisme ou d’opposition entre des unités de même taille qui construisent les unités de taille supérieure. Comme dans une fractale, ces appositions se font sur plusieurs niveaux successifs : deux mots ensembles (des termes dans le langage de la rhétorique sémitique), puis deux propositions (des membres), deux paragraphes (des morceaux) ou deux chapitres, … Peu importe, ce sont toujours des structures comparables dont la juxtaposition construit le texte sur des rapports logiques, qui in fine lui donnent sens. L’étude du texte ne consiste donc pas à mettre en relation des parallélismes entre des unités de sens, mais à observer les briques de constructions, qui, mise côte à côte, forment les différentes unités du texte et en produisent le sens. Pour résumé, ce qui a été observé jusqu’à présent, c’est que chaque niveau de construction, du simple terme jusqu’au livre entier, est constitué d’unités plus petites mises ensemble selon les mêmes règles, formant des structures composites régulières.
Cette construction qui sous-tend le texte est invisible au lecteur, mais il fera de lui-même certains liens subjectivement lors de sa lecture. Selon le chemin qu’il parcourt dans la structure, de nombreuses lectures sont ainsi possibles. En revanche celui qui pratique la rhétorique sémitique va chercher à systématiser tous les parallèles et s’attacher à dégager l’ensemble des unités du texte. Il s’approche de la structure du texte par des tentatives intermédiaires et notes des indices de construction qui vont s’accumuler, jusqu’à ce qu’il découvre ce qui est pour lui la structure finale, la construction du texte élaborée par l’auteur. Jusqu’à présent, nous avons toujours observé des unités régulières et cohérentes et des relations fixes entre celles-ci, de manière à ce qu’il y ait une et une seule construction sous-jacente, qu’il s’agit de découvrir.
D’expérience les approches sont multiples et les tentatives sont nombreuses jusqu’à finalement arriver à cette forme sous-jacente, ce qui peut donner lieu à plusieurs constructions que l’on compare entre elles pour avancer dans la découverte de la structure. D’expérience, donc, on compare parfois différentes tentatives de reconstitution, mais on n’observe jamais deux structures également possibles. En revanche, en revenant sur un texte, ou en relisant une structure, on note parfois des ré ajustements possibles, qui révèlent un peu plus de la structure sous-jacente du texte. Ces ré ajustements, s’ils dégagent de nouvelles symétries et révèlent des marqueurs (termes initiaux, termes finaux, …) qui n’avaient pas été remarqués, corrigent la compréhension de la structure. Comme un puzzle, dont les morceaux déjà bien en place prendraient des couleurs plus nettes. On remarquera d’une telle correction qu’elle ne permet plus de retour arrière, si ce n’est de nouvelles corrections jusqu’à une forme stable, c’est-à-dire dont on ne puisse bouger la structure sans détruire les symétries.
Rachid Benzine, en relisant Le Festin, propose 3 structures, dont celle de Michel Cuypers, pour la séquence que forment les versets 87-96. Les structures proposées, ainsi que ses remarques, sont particulièrement intéressantes. Cependant, comme il l’affirme de lui-même, son travail est porté par et pour le sens. Surtout, il affirme que ces trois structures sont trois lectures possibles de la structure du texte. A partir des remarques qu’il propose, nous reprenons ci-dessous l’analyse de la séquence et voir que que ces relectures, ces mouvements effectués sur la forme du texte, vont permettre d’améliorer la structure observée. Et permettre de dégager une construction du texte et de ses unités plus proche de la structure finale car solidement arrimée par des marqueurs précis.
Notre démarche s’inscrit en sens inverse de la sienne, nous pensons que c’est d’abord l’étude de la forme qui permet de dégager la structure. Par l’étude de ses parallélismes, c’est-à-dire dans la mise en relation des mots puis des unités plus grandes. Ce qui progressivement révèlera le sens du texte, qu’on ne peut déduire avec précision qu’à la fin du travail. Même si la compréhension nous accompagne dans le travail de lecture.
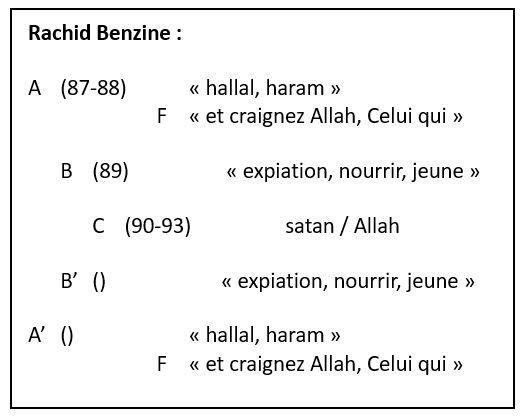
On remarquera tout d’abord que Rachid Benzine ne donne que peu d’éléments de construction, et que ceux qu’il donne fonctionnent aussi avec la construction de M. Cuypers. Nous avons néanmoins testé ses propositions et il est possible qu’elles permettent de réajuster la structure observée vers une forme plus aboutie. Nous nous intéresserons uniquement à sa première proposition, qu’il semble préférer parmi les trois. La principale modification qu’il apporte par rapport au livre Le Festin, c’est qu’il marque une séparation à la fin du verset 89, et déplace les versets 90-92 vers le verset 93, pour ne former qu’une seule partie, au centre. On obtient alors 5 parties concentriques, décrites dans son article. Cela lui permet de repérer que le découpage du Festin pouvait lui aussi être présenté sous une forme concentrique.
Il utilise principalement les termes suivants pour repères : « hallal, haram » puis « expiation, nourrir, jeune » que l’on retrouve en miroir de l’autre côté du morceau central, puis de nouveau « hallal, haram » qui encadre donc la séquence (voir encadré ci-contre). Ce sont globalement les mêmes indices utilisés par Michel Cuypers, ce qui lui laisse penser qu’avec ces mêmes indices, plusieurs constructions sont possibles. Il faudra donc mettre en œuvre plus que le parallélisme de ces termes pour départager les deux propositions. Lui même va au-delà du parallélisme et note la reprise en 88 et 96 de la même clôture : « et craignez Allah, Celui qui ». C’est un indice plus fort que de simples termes, car ce sont déjà des expressions complètes, qui de plus reviennent à la même place dans des unités similaires : en fin de partie (noté F par la suite). Elles notent la symétrie en les parties 1 et 5 de sa construction. Ainsi, en plus des parallèles de termes, la place dans les unités respectives joue un rôle dans les symétries.
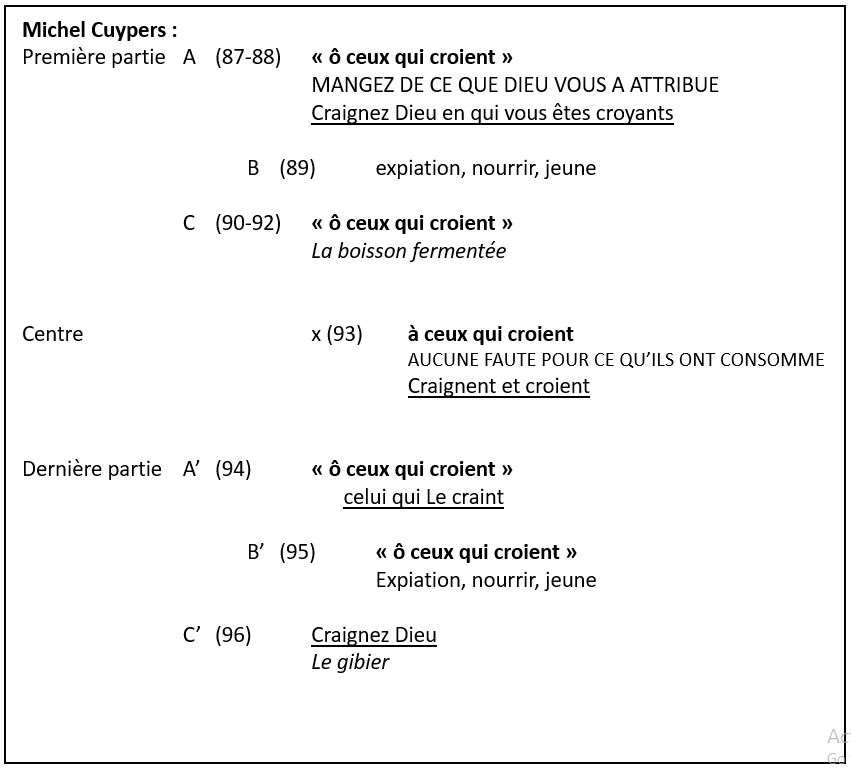
La construction observée par Michel Cuypers est plus détaillée, et n’a pas originellement la forme absolument concentrique que lui prête R. Benzine. C’est une structure avec deux passages externes similaires sans être organisés en mirroir, et un passage central. Les explications détaillées de la structure se trouvent p.298-299 du Festin. Nous en posons les principaux éléments ci-dessous, à savoir la répétition de « ceux qui croient » en début de sous parties, le retour de « Craindre Dieu » et « croire » aux extrémités et au centre du passage, les nourritures interdites en fin des parties externes, l’autorisation de la nourriture au début et au centre du texte.
Le centre est ici pensé comme une vérité à valeur générale, opposée aux contingences particulières que sont les interdictions, qui lui sont subordonnés, dans les parties extérieures.
Les indices de symétrie
En prenant bonne note de tout le travail accompli et des nombreuses observations sur la construction, nous allons tester la principale modification proposée par R. Benzine et effectuer le glissement de 90-92 vers un passage central 90-93. La structure qu’il propose, faite de 5 parties concentriques va mettre à jour plusieurs symétries.
Une fois ce décalage effectué, nous pouvons que les trois passages de la séquence commencent par le même membre, l’interpellation « ô ceux qui croient » (versets 87, 90 et 94, répétée également en 95). Cela semble valider les trois passages observés par Michel Cuypers, ainsi que le décalage proposé par Rachid Benzine : 87-89 puis 90-93 et 94-96. Ces trois passages commenceraient alors par une expression identique, le verset 90 semble donc mieux convenir que le verset 93 pour le passage central. De plus, chacune des 5 parties ainsi délimitées se termine par un segment contenant le terme Allah :
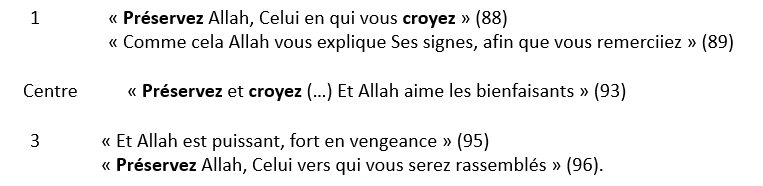
On remarquera que 3 de ces segments ont l’expression « Préservez Allah », ceux placés aux extrémités et au centre de la séquence.
Le terme Allah n’apparait que dans ces 5 segments, et dans trois autres, au début des passages externes (87, 94) et dans le passage central (90). Les deux parties externes sont ainsi encadrées par le nom divin Allah, qui clôture les deux morceaux externes du passage central. Par ailleurs la partie centrale est maintenant construite sur une opposition entre satan et Allah, qui donne alors sens aux notions de hallal et haram dans les parties externes, comme le remarque très justement R. Benzine.

Nous listerons ci-dessous les indices supplémentaires que révèle la forme de la structure proposée par R. Benzine. Ce que nous tenons à observer, qui est objectivement une amélioration, c’est qu’il ne s’agit plus de simples parallèles de termes, mais de membres entiers voir de segments, à des places précises dans la structure, la plupart du temps en début ou fin de partie (termes initiaux (I), termes finaux (F), termes extrêmes). Laissant entrevoir une construction similaire des unités de la séquences, les 5 parties organisées en 3 passages. Ce sont bien des briques semblables qui assemblées forment le tout.
Nous voyons déjà que les 3 unités obtenues sont comparables entre elles. Les deux passages externes forment un chiasme AB B’A’, dont les parties A et A’ ne sont formées que d’un seul morceau, tandis que B et B’ sont composées chacune de trois morceaux. Le passage central est une seule grande partie de 3 morceaux. Ensuite, les unités commencent et terminent par des termes similaires : on observe une symétrie et une logique dans la répétition de ceux-ci. Au niveau de la forme d’abord : l’interpellation en début de passage, les sentences impliquant la divinité en fin de chaque partie. La structure ainsi déterminée révèle le sens des symétries : l’opposition entre Satan et Allah au centre vient éclairer l’opposition entre le licite et l’illicite dans les parties externes, et le jeune et l’aumône comme expiation, intermédiaire entre la loi aux extrémités, et l’opposition centrale, déterminante pour l’ensemble.
Les passages externes
La cohérence interne du premier passage est assurée par la répétition de la racine ’MN (sûr, croire) entre les deux parties, et la transgression de la parole donnée : la parole divine dans la première partie (« ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu’Allah vous a rendues licites », v.87), humaine dans la seconde (« Il vous sanctionne pour les serments que vous aviez l’intention d’exécuter », v.89). Le dernier passage, lui, est construit autour de la nourriture, le gibier et la chasse. En miroir vis à vis de la première : la loi divine (licite, illicite) n’est donnée que dans la dernière partie alors que son application ou sa transgression par l’homme arrive dans la première.
Les deux passages externes sont ainsi liés en A et A’ par les termes hallal et haram et B et B’ par la reprise du terme « expiation » en compensation de la transgression, compensation déterminée de la même manière dans les deux cas : nourrir une famille pauvre ou jeuner. Dans ce cadre, l’opposition entre : « Allah n’aime pas les transgresseurs »(87) et « pour qu’Allah sache qui le craint en secret »(94) détermine des membres initiaux des deux passages.
Tout ceci étant posé, on peut dégager que 87-89 et 94-96 sont deux passages construits sur des formes semblables, avec des sens communs. Leurs 4 parties forment un chiasme ABB’A’. Le parallèle entre les deux exprime un discours sur le licite et l’illicite, le respect de l’engagement pris envers Dieu, et le jeune ou l’aumône en tant que peine pour « recouvrir » la transgression. Tout ceci semble construit et cohérent. Comme le note Benzine, le premier passage prend place dans le domaine quotidien, le second dans le domaine de la sacralisation, où l’engagement spirituel est délimité par un ensemble de restriction plus stricte. La chasse est proscrite au pèlerin, ne lui reste licite que la pêche.
Le passage central
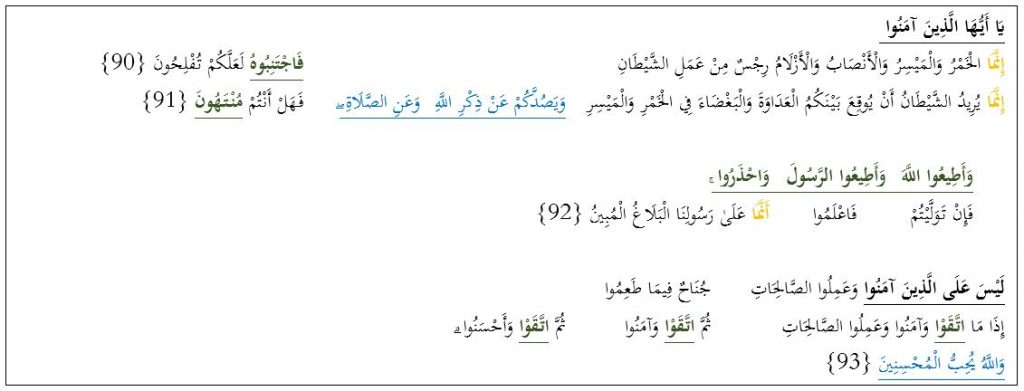

Nous avons ensuite considéré le passage 90-93 que propose R. Benzine. En s’éloignant du sens proposé, et en s’attachant à la forme, on trouve plusieurs indices de construction. La reprise de « ceux qui croient », déjà notée par M. Cuypers, trouve un meilleur agencement. Dans le verset 90 en début de passage, elle fait exactement echo à celles de 87 et 94, et dans ce passage, le parallèle avec 93a, délimite le début des deux morceaux externes. Tandis que la fin de ces mêmes morceaux est délimitée par la reprise du terme Allah en 91 et 93 dans des membres antithétiques (« vous éloigner du souvenir de Dieu et de la prière » / « et certes Dieu aime ceux qui font du mieux »). Les deux morceaux externes sont opposés : 90-91 évoque les pièges introduits par satan pour créer l’inimitié entre les gens et détourner du rappel d’Allah et de la prière, tandis que 93 évoque les croyants pratiquent les bonnes actions. On notera que cette délimitations des morceaux (ceux qui croient / Allah) délimite également les deux passages externes et leurs premières parties respective.
Le premier membre du morceau central incite à « obéir à Allah » en opposition avec « se détourner » dans le second. Les deux membres du morceau central renvoient aux deux morceaux externes (اتَّقَوْا, “préservez”, avec le dernier ; la reprise de ‘’ أَنَّمَا’’ (ainsi) qui articulait la construction des membres du premier morceau), mais dans l’ordre opposé, ce que l’on appel “un retournement au centre”.
La structure étant posée, on peut s’intéresser au parallèle entre les derniers membres du premier morceau « écartez-vous en » puis « mettez-y un terme » et la répétition de « préservez » qui revient trois fois dans le dernier morceau. Ce parallèle semble être repris également et trouver son centre dans la répétition du morceau central : « Obéissez à Allah, obéissez à l’envoyé et prenez garde (اتَّقَوْا à nouveau)». Le sens du terme « Préserver », dont le rapport entre le sens premier, matériel, préserver et son sens supposé « craindre » n’est pas évident, apparait de sa mise en relation avec les autres expressions : « Préserver » c’est se tenir à l’écart des pièges de satan, qui sème la discorde, autrement dit « prendre garde ». Il s’agit alors de préférer Allah et son messager et de préserver ce choix, cette relation, des pièges de satan. On remarquera alors la construction concentrique du membre suivant : ‘’ اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ’’ S’éloigner du mal, croire et accomplir de bonnes actions. Le rapport entre s’écarter des pièges et accomplir les actions salutaires encadre le verbe « croire ». Ainsi la traduction de «اتَّقَوْا » se trouve quelque part entre les verbes (se) préserver (93, trois fois) et respecter Allah (88,96). Le mouvement est double : se préserver du mal, c’est préserver sa relation avec Allah, c’est Le respecter. Dans ce morceau, comme dans la séquence, choisir Allah c’est choisir ce qui est bon pour l’homme. D’où à notre avis la pertinence de la traduction « se prémunir » de Jacques Berque par rapport à celle plus courante de « craindre », liée à l’abstraction « piétée », qui correspond au sens figuratif, mais perd le sens matériel contenu dans « écartez-vous en » et « prenez garde ».
Ce passage est le centre de toute la séquence. On pourra remarquer qu’il reprend à plus petite échelle la forme de celle-ci :
- Les deux expressions « préservez Allah » qui encadrent la séquence se retrouvent dans le parallèle entre s’écarter et préserver.
- Les deux morceaux externes commencent par « ô ceux qui croient ».
- Ces deux morceaux sont clôturés par le terme Allah.
- Le morceau central articule le choix à opérer par l’homme entre les deux propositions.
Construction de l’ensemble de la séquence
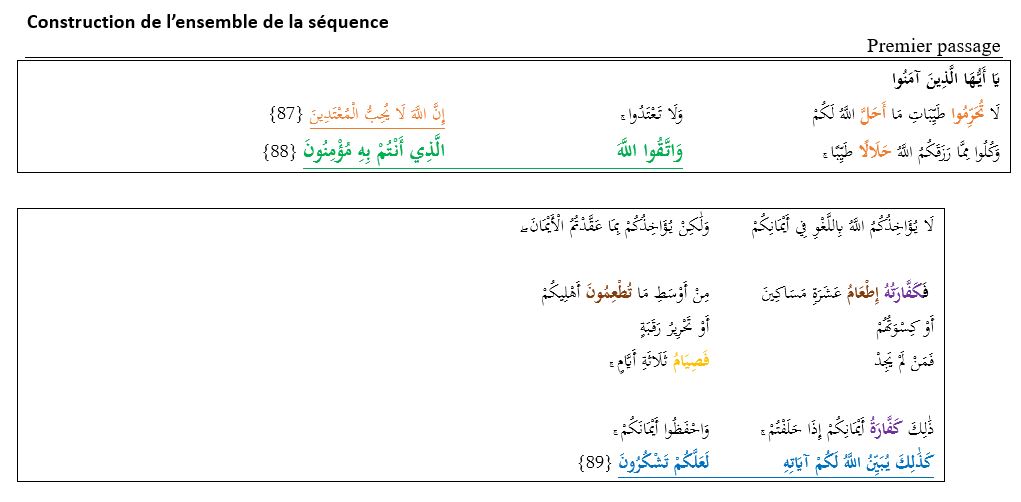
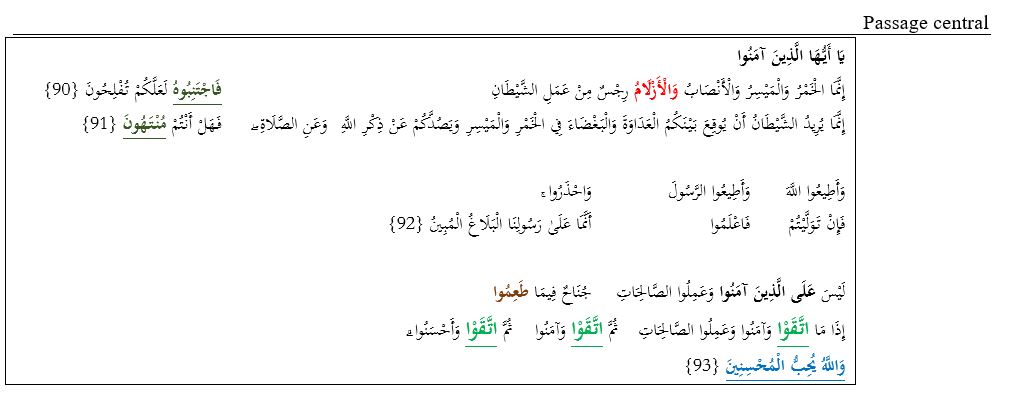
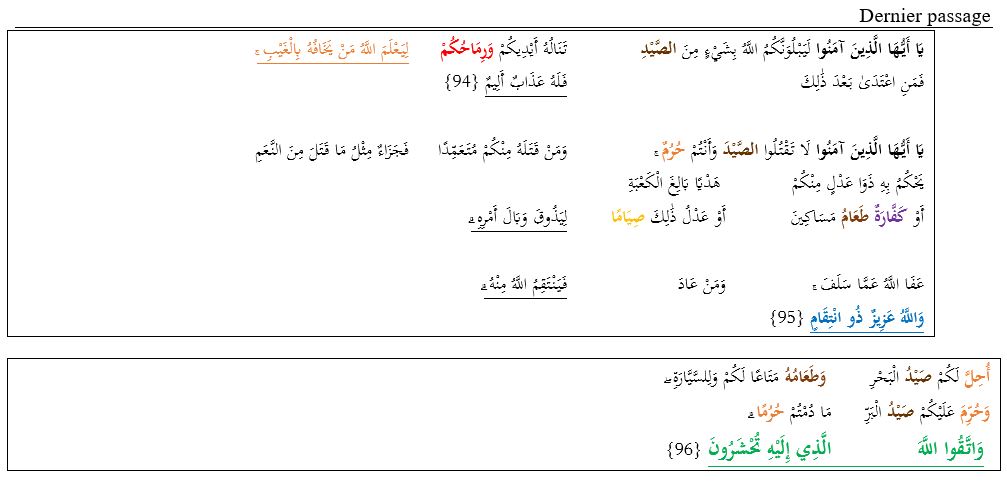

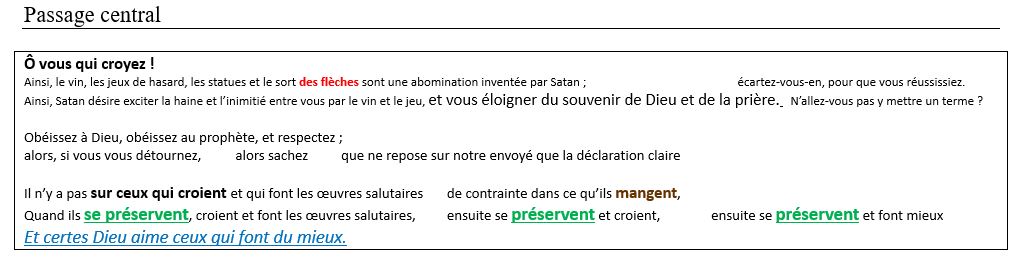
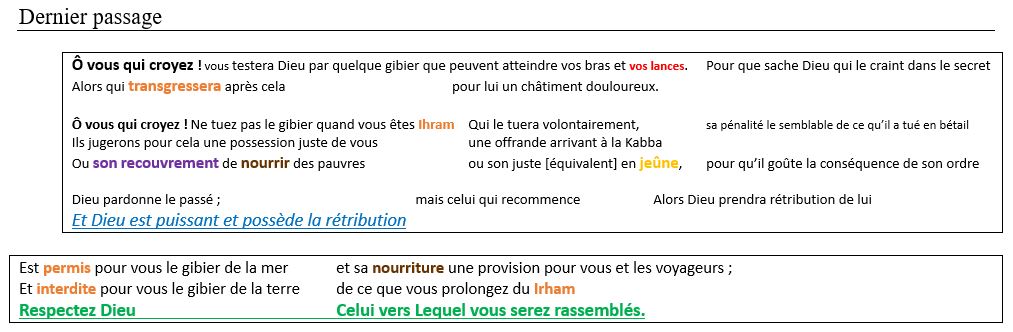
Le passage central est relié au premier par la reprise de la racine ‘MN dans son troisième morceau et la reprise de la nourriture licite déjà exprimée en 87, ainsi pour les croyants toutes les bonnes choses sont licites, c’est la provision que leur attribue Allah, il ne s’agit pas d’en interdire. A contrario, parmi les choses interdites, « Les flèches divinatoires » du premier morceau, reprises par la « lance » du dernier passage, semblent indiquer que ce n’est pas le hasard, ni l’occasion, qui doivent décider de l’action humaine. L’homme ne doit pas prendre tout ce qui vient à lui, mais respecter son engagement envers Allah et l’ordre divin. Ainsi il doit de lui-même s’écarter de ce qui sème la discorde.
Le licite et l’illicite représentent deux domaines distincts et articulent la différence entre ce qui est utile pour l’homme et ce qui provoque la haine et la discorde. Ce qui pourrait expliquer “qu’il n’y a pas de contraintes pour ceux qui croient”, qui a choisit de vivre dans ce qui est bon pour tous. Ce n’est pas la forme qui est importante, c’est le fond, ce qu’il met en jeu, comme M. Cuypers le note. Comme le licite et l’illicite s’excluent mutuellement : ainsi des bonnes actions chassent les mauvaises, et des mauvaises qui font oublier les bonnes. Au-delà de simples actions, que l’aide aux plus pauvres permet de recouvrir, c’est la direction que prend l’homme, connue d’Allah dans le secret, qui est en jeu. Il n’est pas indifférent qu’à la discorde et l’animosité provoquée par l’action satanique au centre soit opposées, non seulement la pratique religieuse au centre, mais aussi la solidarité dans les parties externes, pratique qui semble ramener l’homme dans la bonne direction en le forçant à œuvrer contre les effets de cette discorde, pour reconstruire la communauté humaine.
Conclusion
L’étude de la structure rhétorique se fait par un examen minutieux du texte à la recherche de symétries, qui sont des indices de la construction. Il est recommandé de partir des premiers niveaux, les termes et les membres pour constitués les unités de base du texte. Puis de retrouver pas à pas la construction des unités plus grandes, par leurs rapports entre elles. Une fois les unités délimitées, on peut alors observer les symétries dégagées par les ensembles plus grands. L’apparition d’indices de constructions est consolidée par leurs places précises dans les unités, qui permettent de valider la construction des unités et des rapports entre elles. En relisant les structures dégagées, en déplaçant des unités, il arrive fréquemment qu’on trouve de meilleurs arrangements, qui font apparaitre de nouveaux indices de construction. Le temps qui passe, la familiarisation progressive avec le texte, ou tout simplement le regard d’un autre, frais des résidus structurels laissés par les étapes de la découverte, permettent d’améliorer la compréhension de la structure interne. Pour paraphraser un texte célèbre, il n‘y a pas d’avis définitif en rhétorique, la vérité se distingue progressivement de son élaboration.
Nous avons vu que les recherches de Michel Cuypers ont permis de mettre à jour la composition rhétorique du Coran, et la construction générale de la sourate Le Festin. Tel un nain sur les épaules d’un géant, le lecteur peut alors parcourir la construction et suivre du regard les chemins entre les symétries du texte. En remarquant qu’il pouvait déplacer quelques vers, Rachid Benzine a proposé de nouvelles structures possibles. A notre tour, nous pensons avoir démontré, à la suite de leurs travaux, qu’il a plutôt participé à affiner la lecture de la construction. En mettant à jour le passage central, il a révélé de nouveaux indices de constructions, qui ont fini par trouver leurs places à des endroits précis de la structure, formant des unités désormais difficilement déplaçables.
La structure dégagée du passage central, et les relations qu’elle propose entre les termes, tisse un réseau autour du terme ‘’ اتَّقَوْا’’, terme clé de la séquence puisqu’il en occupe les places importantes, les extrémités et le centre. La place du mot dans la structure, comparé à ses vis-à-vis, nous a permis d’en éclairer le sens. Nous montrerons dans un autre article le rôle que peut jouer la rhétorique sémitique dans l’examen du lexique.
Nous laisserons au lecteur le plaisir de continuer à parcourir les structures de la rhétorique sémitique. Et l’encourageons vivement à s’y essayer de façon pratique. Nous pensons d’ailleurs que la longueur du travail restant pour achever la découverte de la structure du livre et la fraicheur que procure un regard neuf sur les constructions observées font de la rhétorique sémitique un lieu de rêve pour le travail collectif, comme le montrent ces relectures successives.