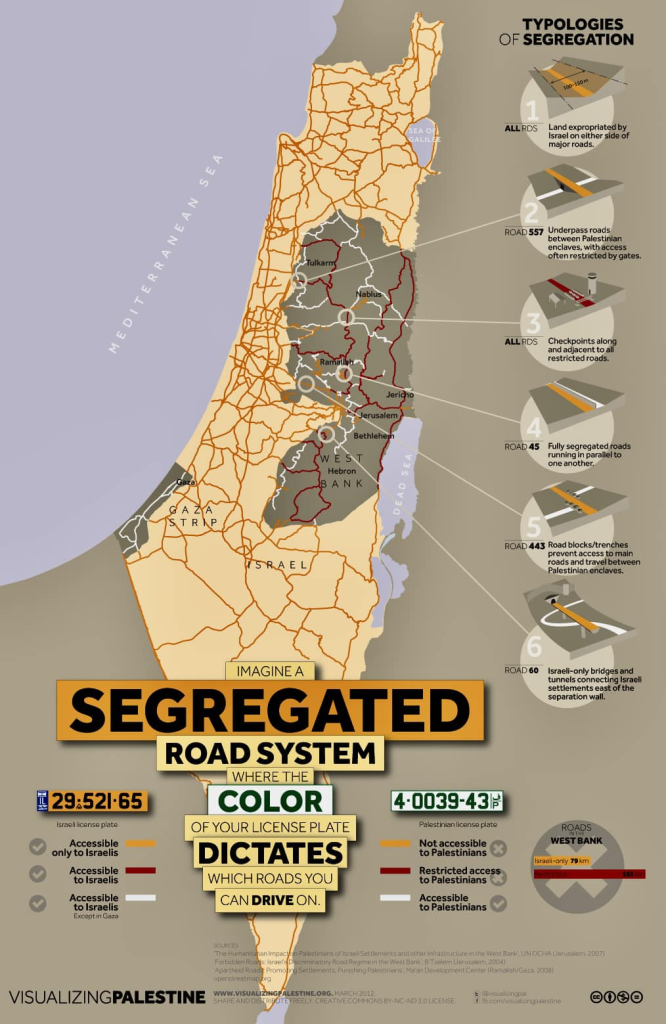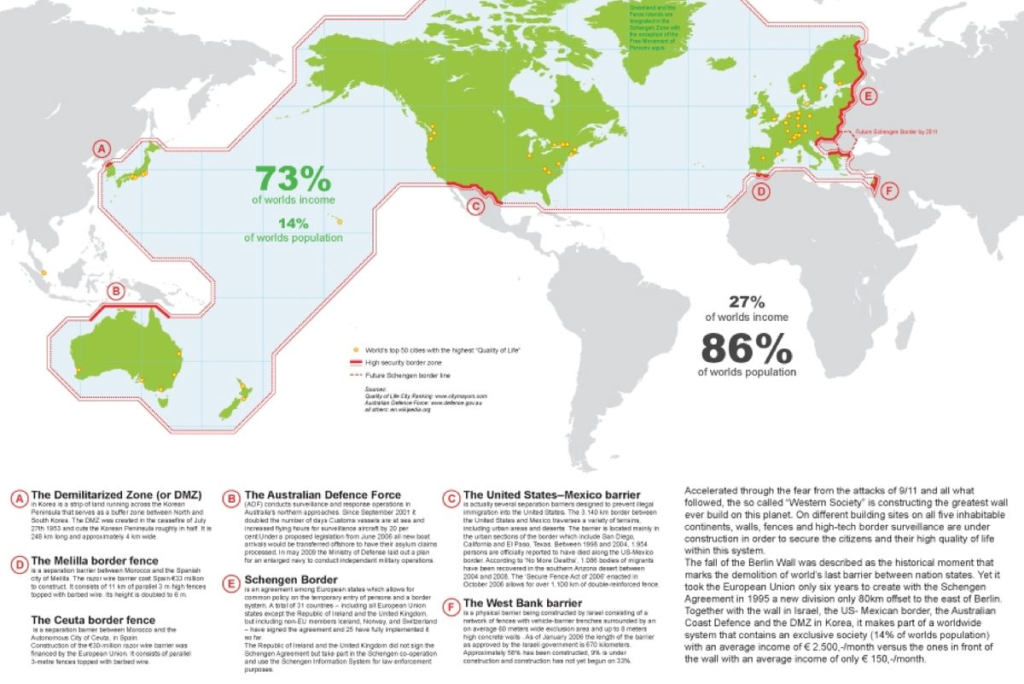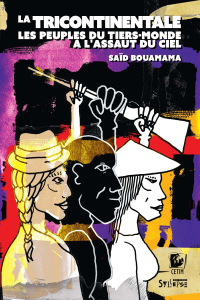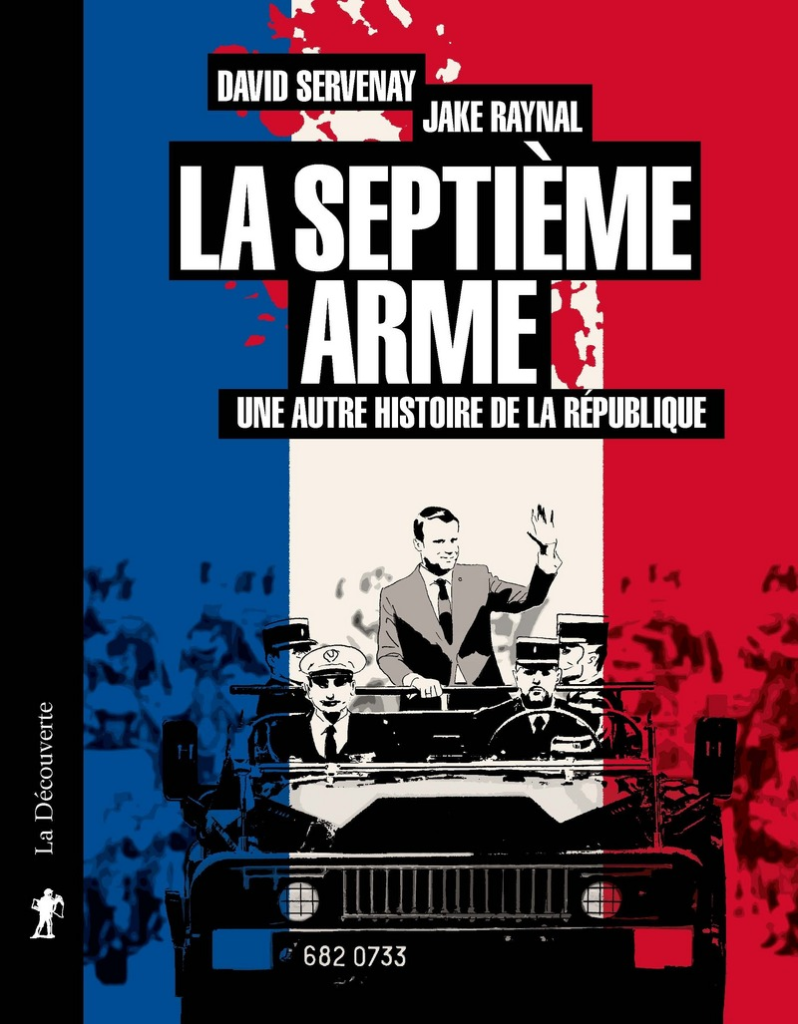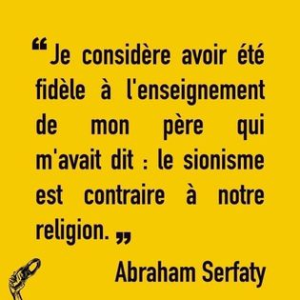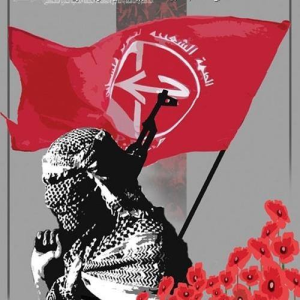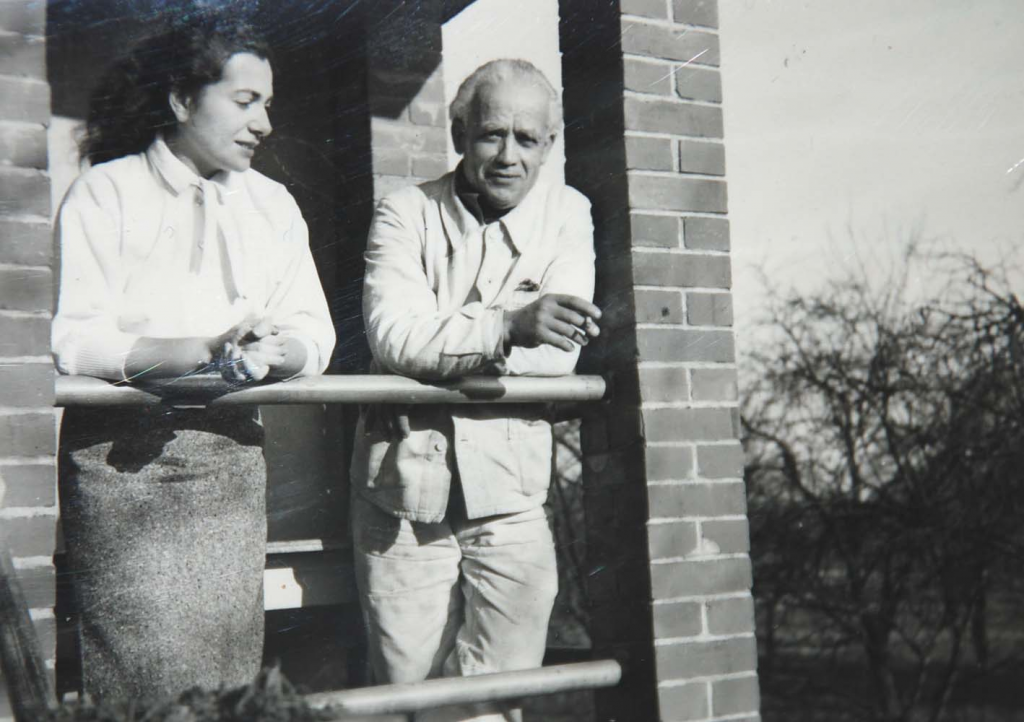Nous sommes musulmanes et musulmans, anticapitalistes, écologistes et féministes, définitivement anti-racistes. Nous sommes pleinement mobilisés depuis des mois contre le génocide qui se déroule en Palestine et nous refusons de céder à la répression, à la déshumanisation coloniale et islamophobe. Le droit ne peut d’un coup s’effondrer pour défendre un allié de l’impérialisme américain, en important ses pratiques de guerre contre les populations. Nous soutenons nos frères mis en danger par les attaques d’extrême droite, notamment celles de Livre Noir. En résonance avec tous les camarades qui subissent le même sort.
“Si l’édifice du droit international humanitaire d’après-guerre a été érigé, c’est pour que nous disposions des outils nécessaires à l’identification collective des schémas avant que l’histoire ne se répète à grande échelle” (N. Klein). Non pas l’identification ethnique des peuples, mais la reconnaissance des schémas en cours. Génocide de Gaza, menace de conflit est ouest à grande échelle, apartheid, … les dynamiques de ce début de 21e siècle rappellent les heures sombres du 20e.
Comment peut-on nier un génocide et faire l’apologie de crimes de guerre en prétendant défendre de quelconques valeurs « progressistes » ? Cette contradiction devient de plus en plus flagrante dans le débat. Pourquoi opposer antisémitisme et islamophobie ? Ces deux racismes ont l’orientalisme colonial parmi leurs racines. Les deux jettent une partie de la population en opprobre en les accusant de tous les maux du pays.
Nous musulmans et militants avertissions dès 2004 que le droit d’exception allait amener une extinction du droit pour une partie grandissante de la population, et pas seulement pour nous. C’est fait et cela va jusqu’à la disparition programmée d’Anticor : l’absence de droit contre la corruption est désormais assumée. Vingt ans après la loi contre le hijab, qui fut l’affaire Dreyfus de notre génération, nous avertissons : nous ne vivons pas seulement des « dérives sécuritaires », mais la répétition historique de la stratégie de la tension, qui conduit tout droit la France vers une situation semblable aux années de plomb en Italie.
« Islamiste fiché S ». Tout le narratif de l’enquête de Livre Noir sur l’extrême- gauche repose sur ce pivot. Urgence Palestine serait le lieu de la rencontre entre les diables absolus, les islamistes, et les damnés : féministes, antiracistes, syndicalistes, écologistes, condamnés à l’enfer pour avoir pactisé avec le mal désigné, l’homme musulman. Elias d’Imzalene et Omar Alsoumi sont érigés en têtes de gondoles déshumanisées de la promotion du torchon bizness model de l’amicale des admirateurs de Brenton Tarrant. Ils sont nos frères, comme le sont les autres musulmanes et musulmans ciblés par Livre Noir. Ils sont nos camarades, comme le sont l’ensemble des militants, élu.e.s, syndicalistes qui subissent la vindicte du fascisme, galvanisés et puissants de l’impunité que leur offre le regime.
Dans le narratif fasciste, ils jouent un rôle pivot et à travers eux tous les hommes musulmans qui ne se cachent pas de l’être y compris dans leurs combats politiques. Désignés parias et intouchables, on serait contaminés et impure si l’on franchit le cercle censé les séparer absolument du reste du monde. Ce sont aussi les hommes à abattre sans sommations, le centre de tous les maux de ce pays. Et surtout pas des êtres humains, sujets de droits et d’empathie. Islamiste fiché S ne veut rien dire en théorie et tout en pratique. C’est une classification étatique, une condamnation sans procès au bannissement dans la zone grise de l’état d’exception permanent qui co-existe en France avec la légalité ordinaire, promesse de campagne à ceux qui acceptent de subir. Qui est désigné comme « islamiste fiché S » est sorti arbitrairement du périmètre d’application du droit, qui restait en théorie le fondement universaliste des démocraties occidentales. Le fait est que la zone grise se propage peu à peu dans la société, et colonise tout : le droit, la politique, les médias.
La prétendue guerre contre la terreur se révèle pour ce qu’elle est : la terreur comme mode de gouvernance de tous les antagonismes légitimes au capitalisme, à l’écocide, à la destruction de toutes les valeurs morales et spirituelles qui peuvent faire la beauté du monde. Livre Noir propose la Dissolution Générale du beau et du bien, le programme ultime du fascisme, tentative de faire disparaître les forces positives à l’œuvre dans le monde actuellement. Celles qui en France représentent en même temps le dernier espoir et les premières Lumières lorsqu’il est minuit dans le Siècle. Livre Noir attaque le rêve en actes, celui où les réfugiés ne meurent plus aux frontières, celui où la planète n’agonise plus épuisée par le mode de production capitaliste, celui où de nouveaux rapports sociaux permettent l’émancipation des minorités pour le plus grand bien de la majorité.
Urgence Palestine a montré l’importance d’une opposition au génocide avançant avec la parole des Palestiniens. Avançant pour tous l’exemple d’une solidarité musulmane. Musulmanes et musulmans, nous continuons de croire en un Dieu de justice et de miséricorde, qui nous libère par la solidarité. Et nous n’avons nulle raison de nous en cacher, parce que nous sommes une bonne nouvelle, qui n’en exclut pas forcément d’autres.
Livre Noir fait de nous l’épreuve pour nos camarades non musulmans : soit se soumettre au narratif islamophobe fondement de la contre insurrection néo libérale, et nous exclure une nouvelle fois, soit nous accpeter en tant que tels. Face à cette perspective quasi inéluctable, ce catch 22 machiavélique, il n’y a pas de demi-mesure vis-à-vis de la perspective musulmane : ou nous sommes tous des islamistes fichés S à éradiquer, ou nous sommes un espoir pour l’humanité. Nous reconnaître comme tels est le début de la réponse à la Bête, tout comme le mouvement contre l’éradication du peuple palestinien est actuellement une des conditions de notre libération partout sur la planète.
Nous pouvons écrire ensemble pour les générations futures le livre de la résistance, celui d’une nouvelle victoire contre la Bête porteuse de la Peste brune qui contamine toujours à très grande vitesse quand on l’a laissée se développer sans y prendre garde. Et ce récit là commence par détruire radicalement le cœur du récit fasciste, celui où les leaders musulmans sont les cavaliers de l’apocalypse. Nos sœurs et nos frères sont des humains, à part entière, participant pleinement à la société, et c’est ce qu’on nous reproche.
Nous appelons tout le mouvement social à la solidarité avec nos camarades d’Urgence Palestine et de Perspectives musulmanes, directement mis en cause pour leur lutte contre le génocide qui a lieu à Gaza, Elias, menacé de mort dès qu’il s’exprime et depuis des années, Omar, pour sa défense du cortège contre une milice religieuse formée de gros bras attaquant les membres d’Urgence Palestine d’une manifestation féministe, Sari, cité nommément dans une tribune reprise par Mediapart, Rima Hassan constamment attaquée en tant que palestinienne. Anasse Kazib et Sihame Assbague inquiétés pour leur participation au mouvement contre le génocide. Et tous ceux visés soit par l’extrême droite, soit par le détournement par la macronie des instances anti-terroristes en police politique. En pleine solidarité avec les camarades sous le feu des soulèvements de la terre, des syndicats, de LFI, des gilets jaunes, et de tous ceux qui essayent d’avoir un impact sur le réel pour répondre aux urgences de l’époque, qui ouvrent en acte d’autres futurs possibles.
Collectif Attariq – Les Musulmans Anticapitalistes
Nadia Meziane, Lignes de Crêtes, fondatrice d’Urgence Afghanes
Association des musulmans végétariens de France
L’Union des Démocrates Musulmans de France
APPEL A SIGNATURES ET SOUTIENS ! via : [email protected], [email protected]
Avec le soutien de :
International Solidarity Movement (ISM-France)
Antiracisme 94
Collectif pour Respect des parents d’élèves et des élèves CRP2E
Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire (LJR) – twitter.com/LigueJ_R
La Cause du peuple, https://www.causedupeuple.org
Yasmine Ben Moussa, Association des Musulmans de France
Mohammed Ben Yakhlef , Délégué syndical CGT, ancien élu LFI
Siham Benchekroun, ex présidente du Collectif Blouses Blanches pour la Palestine
SaÏd Bouamama, sociologue et militant du Front uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP), porte-parole du comité des sans papiers 59
Aicha Zountar – CGT – militante syndicale et féministe
François Burgat , chercheur, politologue sur le monde arabe et musulman
Sara Doke, autrice
Gabriel Hagai, rabbin
Dalila Brahimi, monitrice éducatrice à Epinal
Mathieu Rigouste, chercheur en sciences sociales
Caroline Cranskens, vidéaste, militante Soulèvements de la Terre Corrèze
Jean-Christophe Grellety, racisme-social.fr
Aïcha Benabdeldjalil
Léo Genebrier, militant syndical CGT et associatif
Fathia Chaaari , éducatrice
Ghazi Dali, psychiatre
Imane Douis Réprésentante Sud Rail CSE
Nasser Derouiche El Behl, militant ANC
Salima Kidani militante décoloniale et parents d’élève
Lou Gallé, Musulmane et militante CGT Précaires et Chômeurs du Cher
Yasmine Ghallab, militante pour la Palestine
Mohammed Guellati, comédien
Faiza Hirach, syndicaliste et militante antiraciste
Mohammed Hadi Belghiti, médecin
Amal Mohammedi, formatrice activiste
Abdelhak Najib, poète, romancier, journaliste marocain
Leslie Tychsem, couturière
Skalpel (Emiliano Fernandez) Rappeur, militant , secrétaire de l’UL CGT de Melle)
Sandrine Varlet, libraire, animatrice jeunesse
Brahim Douaouda, Comité précaire et privé d’emploi CGT de Tourcoing
Nadia Zaimeddine, éducatrice spécialisée, CGT , ANC
Émilie-Zahra Bouzerda, soignante, activiste antifasciste
Zakaria Ouled Benbrahim, enseignant, syndiqué Solidaires
Nadia Belhoum, machiniste RATP CGT
Lou Cramazouk, precaire AESH, écolo radical
Sarah Grosskopf, militante associative
Amine Mechaï – développeur web, filmmaker
Behdja Kadadra, aide soignante
Nadia Belhoum machiniste ratp cgt
Mohamed Hadi Belghiri, médecin
Behdja Ladadra, Aide soignante.
Siham Benchekroun, médecin, ex-présidente du Collectif Blouses Blanches pour la Palestine
Alain Chancogne, retraité, athée, communiste, ANC
Nesrine TEDJINI BAÏLICHE militante anticoloniale
Nadia Chennoua – militante des droits de l’homme
Behdja Ladadra, Aide soignante
Maud Delanaud, pair-aidante bénévole
Sandra lima, psychologue, militante féministe, libertaire et antifasciste et une alliée en tant que blanche contre le racisme
Sabri Pierre Dauphin, militant LGBT, ancien secretaire général de ACT UP-Paris.
Claudia Chaffard: professeure d’ espagnol retraitée, militante FI
Charles Hoareau, ANC 13
Typhaine Delhaye, Travailleuse sociale
Patrick Deschene, traducteur
Marie-France Moralès, éducatrice spécialisée à la retraite, féministe
Raphaël Eskenasy. Ouvrier
Linda Forgues, antiraciste, Quebec
Manuel Ferrer, militant des droits humains, antifasciste et anarchiste
Géraldine Doriath, infirmière et solidaire
Antoine Grégoire Lignes de Crêtes
Delphine Maillet, professeure des écoles, retraitée
Thomas Guilbert, chômeur, communiste libertaire
Linda Mendy, présidente Cultures Solidaires
Sylvain Jean, Militant communiste anti-impérialiste
Patricia Panero, militante associative, LFI
Rémi Klajn, ingénieur
Sarah Clenet
Bruno Lambert, professeur de mathématiques en collège, Militant syndical
Valérie Pico , réalisatrice
Bastien LB – charpentier – sympathisant LFI
Claudine RABAHI militante anarchiste
Namasté Grands Morts , influenceur en développement collectif @namaste_grands_morts
Nicolas Padiauleau , militant anarchiste
Laurent Perlin, citoyen indépendant,
Patricia Panero, militante associative, militante LFI
Claude Rioux, Editions de la rue Dorion
Pascal Rousse, enseignant, élu CGT Éduc’action
Rachida Zenagui
Martin Rass, chercheur Indépendant depuis la retraite
Iris Kooyman, guide-conférencière
Noé Roland, enseignant, Lignes de Crêtes
Valérie Saibi, traductrice, militante anticapitaliste, féministe et antiraciste
Paul Sire, étudiant
Julie Souman, militante féministe
Martin Thioux, militant antifasciste, Liège
Mathilde Samson, citoyenne
Sari Hanafi, Professeur de Sociologie, American University of Beirut
Loic Descamps Ancia, travailleur associatif
Balthazar Gauquelin , maître de jeu
Mael Le Bars , citoyen
Kamel Daoudi, programmeur indépendant, assigné à résidence depuis 16 ans
Jacquot Faouzi, éducateur, secrétaire général CGT croix rouge 13.
Annie Kerryell Le Meur, relectrice
Christian Hivert, écrivain, communiste libertaire
Gaelle Pertel Pacheco
Ritchy Thibaut, militant contre l’antistsiganisme, porte parole PEPS, Gilet Jaune
Latifa Lakhsassi
Evelyne Franquet – enseignante chercheuse en écologie – Sud Éducation 13
Slim Mansouri
BENHARREF Elhame,militante.
Maryline Clermont
Nicolas Kieffer, assistant d’éducation, communiste et militant syndical CGT Éduc’action